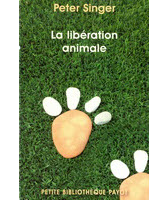1975, 1990 et 2012
La Libération animale [1]
Dans leur comportement envers les créatures, tous les hommes [sont] des nazis.
Bashevis Singer, (p. 188)
SOMMAIRE
 |
|||||
|
|
|||||
|
1975, 1990 et 2012 |
|||||
|
La Libération animale [1] Dans leur comportement envers les créatures, tous les hommes [sont] des nazis. Bashevis Singer, (p. 188) |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
p. 71. L'égalité est une idée morale, et non l'affirmation d'un fait. Il n'y a aucune raison logiquement contraignante pour supposer qu'une différence de fait dans les aptitudes de deux personnes justifie une quelconque différence dans la quantité de considération à apporter à leurs besoins et à leurs intérêts. Le principe de l'égalité des êtres humains n'est pas la description d'une hypothétique égalité de fait parmi les humains : c'est une prescription portant sur la manière dont nous devons traiter ces êtres humains. Jeremy Bentham, le réformateur politique et social qui fonda l'école utilitariste de philosophie morale, incorpora dans son système éthique le principe essentiel qui sous-tend l'égalité morale au moyen de la formule : « Que chacun compte pour un et qu'aucun ne compte pour plus d'un. » En d'autres termes, les intérêts de chaque être affecté par une action doivent être pris en compte, et cela en leur donnant le même poids qu'aux intérêts semblables de n'importe quel autre être. p. 72. [...] l'élément fondamental — la prise en compte des intérêts de l'être, quels que puissent être ces intérêts — doit, suivant le principe d'égalité, être étendu à tous les êtres, noirs ou blancs, masculins ou féminins, humains ou non. p. 73. Beaucoup de philosophes et autres auteurs ont proposé de voir dans le principe d'égalité de considération des intérêts, énoncé sous une forme ou une autre, un principe moral de base ; mais peu nombreux furent ceux d'entre eux qui reconnurent que ce principe s'applique aux membres des autres espèces aussi bien qu'à ceux de la nôtre. Jeremy Bentham fut de ce petit nombre. Dans un passage d'anticipation écrit à une époque où les esclaves noirs avaient été libérés par les Français alors que dans les possessions britanniques on les traitait encore comme nous traitons aujourd'hui les animaux, Bentham écrivit : « Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquerra ces droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours au caprice d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels, et aussi plus causants, qu'un enfant d'un jour, ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait ? La question n'est pas : peuvent-ils raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? [2] » Dans ce passage, Bentham désigne la capacité à souffrir comme étant la caractéristique déterminante qui donne à un être le droit à l'égalité de considération. La capacité à souffrir — ou plus précisément, à souffrir et/ou à éprouver le plaisir ou le bonheur — n'est pas simplement une caractéristique comme une autre comme la capacité à parler ou à comprendre les mathématiques supérieures. Ce que dit Bentham n'est pas que ceux qui tentent de marquer cette « ligne infranchissable » qui détermine si les intérêts d'un être doivent ou non être pris en considération se sont simplement trompés de caractéristique. Quand il dit que nous devons considérer les intérêts de tous les êtres capables de souffrir ou d'éprouver du plaisir, il n'exclut de façon arbitraire du bénéfice de la considération aucun intérêt du tout — contrairement à ceux qui tracent la ligne en fonction de la possession de la raison ou du langage. La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est une condition nécessaire sans laquelle un être n'a pas d'intérêts du tout, une condition qui doit être remplie pour qu'il y ait un sens à ce que nous parlions d'intérêts, Il serait absurde de dire qu'il est contraire aux intérêts d'une pierre d'être promenée le long du chemin par les coups de pied d'un écolier. Une pierre n'a pas d'intérêts parce qu'elle ne peut pas souffrir. Rien de ce que nous pouvons lui faire ne peut avoir de conséquence pour son bien-être. La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est, par contre, une condition non seulement nécessaire, mais aussi suffisante, pour dire qu'un être a des intérêts — il aura, au strict minimum, un intérêt à ne pas souffrir. Une souris, par exemple, a un intérêt à ne pas recevoir de coups de pied, parce que si elle en reçoit elle souffrira. p. 76. Si un être souffre, il ne peut y avoir aucune justification morale pour refuser de prendre en considération cette souffrance. Quelle que soit la nature d'un être, le principe d'égalité exige que sa souffrance soit prise en compte de façon égale avec toute souffrance semblable — dans la mesure où des comparaisons approximatives sont possibles — de n'importe quel autre être. Si un être n'a pas la capacité de souffrir ni de ressentir du plaisir ou du bonheur, alors il n'existe rien à prendre en compte. Ainsi, c'est le critère de la sensibilité (pour employer ce mot comme raccourci pratique, mais en toute rigueur inexact, pour désigner la capacité à souffrir et/ou à ressentir le plaisir) qui fournit la seule limite défendable à la préoccupation pour les intérêts des autres. Fixer cette limite selon une autre caractéristique comme l'intelligence ou la rationalité serait la fixer de façon arbitraire. Pourquoi ne pas choisir quelque autre caractéristique encore, comme la couleur de la peau ? Les racistes violent le principe d'égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux de membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. De façon similaire, les spécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur des intérêts supérieurs de membres d'autres espèces. Le schéma est le même dans chaque cas. |
|||||
|
p. 113. Dans un article datant de 1972, Harlow et Suomi disent que puisque la dépression chez les humains a été caractérisée comme comportant « un état d'impuissance et de désespérance, noyé au fond d'un puits de désespoir », ils avaient conçu « sur une base intuitive » un dispositif pour reproduire un tel « puits de désespoir » tant sur le plan physique que psychologique. Ils fabriquèrent une enceinte verticale dotée de parois en acier inoxydable qui s'inclinaient vers l'intérieur pour former un fond arrondi destiné à recevoir un jeune singe pendant une période pouvant aller jusqu'à quarante-cinq jours. Ils observèrent qu'après quelques jours d'un tel enfermement, les singes « passent la majeure partie de leur temps pelotonnés dans un coin de la chambre ». L'enfermement provoquait des « comportements psychopathologiques sévères et durables de nature dépressive ». Neuf mois encore après leur sortie, les singes restaient assis les bras serrés autour du corps au lieu de se mouvoir et d'explorer leur environnement comme le font les singes normaux. Mais le rapport se termine de façon peu concluante et inquiétante : « Pour ce qui est de savoir si [les résultats] sont spécifiquement liés à des variables telles que la forme ou la taille de la chambre, la durée de l'enfermement, l'âge au moment de l'enfermement ou, plus vraisemblablement, à une combinaison de variables incluant celles-ci et d'autres, cela reste l'objet de recherches supplémentaires [3].» p. 116. [...] Comme le montrent certaines des citations rapportées ci-dessus, la recherche s'alimente maintenant elle-même. Reite et ses collègues ont mené des expériences sur les chimpanzés parce que relativement peu de travail expérimental avait été fait sur les singes anthropomorphes comparativement aux autres singes. Ils ne ressentaient, semble-t-il, aucun besoin de répondre à la question de base : pourquoi nous devrions faire au départ quelque expérience que ce soit de privation maternelle sur des animaux. Quant à justifier leurs expériences en affirmant qu'elles bénéficieraient aux êtres humains, ils ne l'ont même pas tenté. Le fait que nous disposions déjà d'une vaste gamme d'observations portant sur des chimpanzés devenus orphelins dans la nature semble ne pas les avoir intéressés. Leur attitude était claire : cela a été fait aux animaux d'une espèce, mais pas à ceux d'une autre, donc faisons-le-leur. La même attitude se répète constamment partout dans les sciences psychologiques et comportementales. L'aspect le plus étonnant de l'histoire est que les contribuables ont payé pour toute cette recherche à hauteur de la coquette somme de 58 millions de dollars pour les seules études sur la privation maternelle [4]. Sous cet angle, mais pas seulement sous celui-ci, l'expérimentation animale civile n'est pas si différente de l'expérimentation militaire. p. 118. Une analyse boursière d'un des plus importants fournisseurs d'animaux de laboratoire, le Charles River Breeding Laboratory, affirma que cette société à elle seule produisait annuellement 22 millions d'animaux de laboratoire [5]. Dans son rapport de 1988, le ministère de l'Agriculture citait 140 471 chiens, 42 271 chats, 51 641 primates, 431 457 cobayes, 331 945 hamsters, 459 254 lapins et 178 249 « animaux sauvages » : soit un total de 1 635 288 utilisés en expérimentation. On se souvient que ce rapport ne prend pas la peine de compter les rats et les souris, et couvre au mieux une proportion estimée à 10 % du nombre total des animaux utilisés. Sur les plus de 1,6 million d'animaux utilisés à des fins expérimentales que cite dans son rapport le ministère de l'Agriculture, plus de 90 000 sont dits avoir subi « de la douleur ou de la détresse non soulagée ». Ici encore, il ne s'agit là probablement, au plus, que de 10 % du nombre total d'animaux qui ont subi de la douleur ou de la détresse non soulagée — et si les expérimentateurs se préoccupent moins de la douleur non soulagée qu'ils infligent aux rats et aux souris que de celle qu'ils infligent aux chiens, chats et primates, cette proportion pourrait être encore plus faible. Les autres pays développés utilisent tous un grand nombre d'animaux. Au Japon, par exemple, une enquête très partielle publiée en 1988 arriva à un total de plus de 8 millions [6]. p. 121. Puis il y a le Whole Rat Catalog. Ce catalogue, publié par Harvard Bioscience, vante sur 140 pages du matériel d'équipement pour l'expérimentation sur petits animaux, le tout dans un style publicitaire pimpant. Au sujet, par exemple, des dispositifs de contention en plastique transparent pour lapins, le catalogue nous dit : « La seule chose qui frétille c'est le museau ! » Ici et là apparaît toutefois une certaine conscience du caractère controversé du sujet ; ainsi, la description de la Valise de transport pour rongeurs suggère-t-elle : « Utilisez cette valise discrète pour transporter votre animal favori d'un endroit à l'autre sans attirer l'attention. » En plus des habituels cages, électrodes, instruments chirurgicaux et seringues, le catalogue vante les Cônes de contention pour rongeurs, les Systèmes Harvard de lanières de contention sur pivot, les Gants de protection contre les rayonnements, les Appareils implantables pour télémétrie FM, les Aliments liquides pour rats et souris pour études de l'alcool, des Appareils à décapiter pour animaux petits ou gros et même un Émulsificateur à rongeurs qui « réduira rapidement les restes d'un petit animal en une suspension homogène [7]». p. 122. L'expérimentateur qui oblige des rats à choisir entre mourir de faim et subir des chocs électriques pour voir si un ulcère s'ensuivra (la réponse est oui) le fait parce que le rat possède un système nerveux très semblable à celui d'un être humain, et ressent vraisemblablement les chocs électriques d'une façon semblable. pp. 144, 147.
|
|||||
|
p. 205. [...] L'us et abus des animaux élevés pour la nourriture dépassent de loin, par le simple nombre de ceux qui sont concernés, toute autre forme de mauvais traitement. Plus de cent millions de vaches, porcs et moutons sont élevés et abattus chaque année dans les seuls États-Unis ; et le chiffre pour la volaille atteint la valeur vertigineuse de cinq milliards. (Cela veut dire qu'environ huit mille oiseaux — des poulets, pour la plupart — auront été abattus pendant le temps qu'il vous faut pour lire cette page.) C'est ici, sur la table où nous prenons nos repas et dans la boucherie ou au supermarché du quartier, que nous entrons en contact direct avec la plus vaste exploitation d'autres espèces qui ait jamais existé. [...] En général, nous ne savons rien des mauvais traitements d'êtres vivants que recèlent les aliments que nous mangeons. L'achat de nourriture dans un magasin ou au restaurant est l'aboutissement d'un long processus, dont tout, hors le produit final, est délicatement écarté de notre vue. Nous achetons nos viandes et volailles emballées bien proprement sous plastique. Elles saignent à peine. Rien n'incite à faire le rapprochement entre ces articles emballés et un animal vivant qui respire, marche, souffre. p. 211. Le pas essentiel dans le processus qui, d'oiseaux de basse-cour, transforma les poulets en articles manufacturés fut leur confinement sous un toit. Le producteur de poulets de chair reçoit depuis les accouvoirs un lot pouvant comprendre 10 000 ou 50 000 poussins d'un jour, voire plus, qu'il place dans un long hangar sans fenêtres — habituellement à même le sol, bien que certains producteurs utilisent des cages étagées afin de loger plus d'animaux dans un bâtiment de même taille. À l'intérieur, chaque aspect de l'environnement des oiseaux est contrôlé pour qu'ils engraissent plus rapidement avec moins de nourriture. L'eau et les aliments sont distribués automatiquement par des installations suspendues du plafond. L'éclairage est ajusté selon les conseils de chercheurs agronomes : il sera par exemple intense vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la première ou les deux premières semaines, pour encourager les poussins à prendre rapidement du poids ; ensuite, il sera peut-être un peu moins fort et sera éteint et rallumé toutes les deux heures, selon l'idée que les poussins sont plus disposés à manger après une période de sommeil ; enfin, lorsque les oiseaux sont âgés d'environ six semaines et ont grossi au point d'être entassés, vient un moment où la lumière sera maintenue de façon permanente à un niveau très faible. Cette pénombre a pour but de réduire l'agressivité provoquée par l'entassement. Les poulets de chair sont tués à l'âge de sept semaines (la longévité naturelle d'un poulet est de l'ordre de sept ans). À la fin de cette brève période, leur poids atteint environ 2 kilogrammes ; mais la surface dont chacun d'entre eux dispose peut encore se réduire à 450 cm2 — soit moins que celle d'une feuille de papier à lettres standard A4. Dans ces conditions, quand les poulets sont soumis à un éclairage normal, le stress dû à l'entassement et à l'absence d'exutoire naturel pour leur énergie provoque chez eux des rixes, au cours desquelles ils s'attaquent les uns les autres à coups de bec aux plumes et parfois s'entre-tuent et s'entre-dévorent. Il a été constaté que diminuer fortement l'éclairage réduisait ce comportement, et c'est pourquoi ils ont une forte probabilité de vivre leurs dernières semaines dans une quasi-obscurité. Le « picage » (coups de bec aux plumes) et le cannibalisme sont, dans le jargon des éleveurs de poulets de chair, des « vices ». Ce ne sont pas là, pourtant, des vices naturels ; ils résultent du stress et de l'entassement que les producteurs modernes font subir à leurs oiseaux. Les poulets sont des animaux hautement sociables, et dans la basse-cour ils développent une hiérarchie, appelée « ordre des coups de bec ». p. 214. Les conditions non naturelles dans lesquelles les poulets sont maintenus sont la cause des vices, mais pour les contrôler les éleveurs doivent rendre ces conditions encore moins naturelles. Un éclairage très faible est un des moyens employés. Une mesure plus dramatique, qui n'en est pas moins aujourd'hui très largement utilisée dans l'industrie, est le « débecquage ».
p. 219. L'atmosphère dans laquelle les poulets doivent vivre représente déjà en elle-même un danger pour leur santé. Au cours des sept ou huit semaines qu'ils passent dans leur hangar, aucune mesure n'est prise pour changer leur litière ou pour enlever leurs excréments. Malgré la ventilation mécanique, l'air qu'ils respirent se charge d'ammoniac, de poussières et de micro-organismes. Des études ont montré que, comme on peut s'y attendre, la poussière, l'ammoniac et les bactéries ont des effets préjudiciables sur les poumons des poulets [8]. Le département de santé publique de l'université de Melbourne en Australie a conduit une étude sur les risques que représente cette atmosphère pour la santé des éleveurs. Les chercheurs ont trouvé que 70 % des éleveurs font état d'irritations oculaires, près de 30 % de toux chronique et près de 15 % d'asthme et de bronchite chronique. Par conséquent, l'étude met en garde les éleveurs et leur conseille de passer le moins de temps possible dans leurs hangars et de porter un masque respiratoire lorsqu'ils y entrent. Mais elle ne parle nulle part de masques respiratoires pour les poulets [9]. p. 234. Chez les poules pondeuses, qui sont gardées plus longtemps, le naturaliste texan Roy Bedichek a observé d'autres signes : « J'ai observé attentivement des poules élevées de cette façon et elles m'ont paru ne pas être heureuses [...] Les poules en batterie que j'ai observées paraissent perdre leurs esprits vers l'âge où elles auraient normalement été sevrées par leur mère pour partir dans l'herbe chasser les sauterelles pour elles-mêmes. Oui, littéralement, en fait, la batterie devient une maison de fous pour gallinacés [10]. » L'impossibilité où se trouvent les poules de construire un nid pour y pondre est pour elles une source supplémentaire de détresse. Konrad Lorenz a décrit le processus de ponte comme étant la pire torture que doit subir une poule en batterie : « Pour qui connaît un peu les animaux, il est vraiment déchirant d'observer comment une poule tente encore et encore de se glisser sous ses compagnes de cage, pour y chercher en vain un abri. Dans de telles circonstances, il ne fait aucun doute que les poules se retiendront de pondre le plus longtemps possible. Leur répugnance instinctive à pondre au milieu de la foule de leurs codétenues est certainement aussi forte que la répugnance qu'éprouvent les gens civilisés à déféquer dans une situation analogue [11]. » p. 240. Puisque la ponte est une fonction corporelle (comme l'ovulation chez une femme), les poules continuent à pondre même quand elles sont gardées dans des conditions qui vont à rencontre de tous leurs besoins comportementaux. p. 236. Les poules fournissent encore un autre type d'indication du fait qu'elles ne perdent jamais leur instinct de nidification. Plusieurs de mes amis ont adopté quelques poules pondeuses qui, arrivées à la fin de leur période de rentabilité commerciale, allaient partir pour l'abattoir. Quand ces oiseaux sont relâchés dans une arrière-cour et disposent d'un peu de paille, ils commencent immédiatement à construire un nid — même après plus d'un an passé dans une cage métallique nue. p. 239. En fin de compte, la façon la plus convaincante par laquelle une poule peut indiquer que ses conditions de vie sont inadéquates est de mourir. Un taux élevé de mortalité ne peut survenir que dans les conditions les plus extrêmes, vu que la longévité normale d'une poule dépasse de loin les dix-huit mois à deux ans que l'on accorde aux poules pondeuses. Les poules, comme les humains dans les camps de concentration, s'accrocheront obstinément à la vie dans les conditions les plus misérables. Il est pourtant courant pour un producteur d'oeufs de perdre entre 10 et 15 % de ses poules dans une année, beaucoup mourant clairement du stress causé par l'entassement et par les problèmes qui y sont liés. p. 242. Jusqu'à la fin, les producteurs d'oeufs ne permettent à aucun sentiment d'affecter leur attitude envers ces oiseaux qui leur ont pondu tant d'oeufs. Contrairement au meurtrier qui a droit à un repas spécial avant d'être pendu, les poules condamnées, elles, ne recevront peut-être rien à manger du tout. « Ne donnez plus de nourriture aux poules à réformer » : tel est le conseil que donne aux éleveurs le titre d'un article de la revue Poultry Tribune, dont le texte explique que la nourriture donnée aux poules au cours des trente heures qui précèdent l'abattage est de la nourriture gaspillée, puisque les transformateurs ne paient maintenant plus pour les aliments restés dans le tube digestif [12]. p. 220. 
Si le fait de vivre dans de longs hangars sans fenêtres, surpeuplés, remplis d'ammoniac et de poussière est stressant pour les poulets, leur premier et unique contact avec la lumière du soleil ne l'est pas moins. Les portes sont ouvertes brusquement et les oiseaux, à ce stade habitués à une demi-obscurité, sont empoignés par les pattes, portés à l'extérieur la tête en bas, et fourrés sommairement dans des caisses empilées à l'arrière d'un camion. Puis ils sont conduits à une usine de « traitement » où ils seront tués, nettoyés et transformés en articles bien propres emballés sous plastique. À leur arrivée à l'usine, ils sont sortis du camion et empilés, encore dans leurs caisses, pour attendre leur tour. Cela prendra peut-être plusieurs heures, qu'ils passeront sans boire ni manger. Enfin, ils sont extraits des caisses et suspendus la tête en bas sous la courroie de transport qui les porte vers le couteau qui lui-même mettra fin à leur existence sans joie. p. 243. Les porcs n'ont dans les fermes modernes d'élevage intensif rien d'autre à faire que manger, dormir, se mettre debout et se coucher. Ils n'ont généralement ni paille ni autre litière, parce que cela compliquerait la tâche du nettoyage. Dans ces conditions, des porcs peuvent difficilement ne pas prendre du poids, mais ils s'ennuient et sont malheureux. Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis : « La caudectomie est devenue pratique courante pour prévenir les morsures de la queue chez les porcs confinés. Tous les éleveurs de porcs à l'engrais devraient la pratiquer. Coupez les queues à 1/4 ou 1/2 pouce du corps avec un instrument émoussé telle une pince oblique. L'effet d'écrasement aide à arrêter le saignement. Certains producteurs utilisent pour la caudectomie l'appareil à débecquer les poulets, qui cautérise en même temps la surface coupée [13]. » Voilà une recommandation scandaleuse à double titre. Mais avant que je n'explique pourquoi, voici ce que pense en toute candeur un éleveur au sujet de la coupe des queues : « Ils en ont horreur ! Les porcs en ont tout simplement horreur ! Et je suppose que nous pourrions sans doute nous dispenser de la caudectomie si nous leur donnions plus d'espace, parce qu'ils ne deviennent pas aussi fous et méchants lorsqu'ils ont plus d'espace. Quand ils ont assez de place, ce sont en fait des animaux tout à fait gentils. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Ces bâtiments coûtent très cher [14]. » Il est néanmoins tout à fait typique de la mentalité du monde de la production animale moderne que la réponse tant du ministère de l'Agriculture que des éleveurs de porcs soit de mutiler les animaux au lieu de leur donner les conditions de vie dont ils ont besoin. p. 250. 
Très peu de porcs jouissent du luxe d'un enclos garni de paille, et la tendance générale va encore dans la mauvaise direction. Prenant modèle à nouveau sur l'industrie de la volaille, les éleveurs de porcs en Hollande, en Belgique et en Angleterre ont commencé à élever les porcelets en cages. Les producteurs américains en font aussi la tentative. L'emploi de cages a comme principale motivation, hormis le désir habituel d'accélérer les gains de poids en dépensant moins de nourriture et d'obtenir une viande plus tendre grâce à la restriction sur les possibilités d'exercice, de permettre un sevrage plus précoce des porcelets. La truie qui n'allaite plus cessera de faire du lait, et redeviendra fertile quelques jours plus tard. Elle sera alors fécondée à nouveau, par un verrat ou par insémination artificielle. Le sevrage précoce permet ainsi d'obtenir de chaque truie une moyenne de 2,6 portées par an au lieu du maximum de 2 quand on laisse les porcelets téter pendant la période naturelle de trois mois [15]. p. 254. Les truies font elles-mêmes clairement voir ce qu'elles pensent de cette forme de confinement. À l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, G. Cronin a obtenu son doctorat en étudiant le comportement des truies confinées. Voici, tel qu'il le décrit, leur comportement lorsqu'elles sont pour la première fois mises dans un box avec une attache : « Les truies se jetaient violemment en arrière, tirant sur l'attache. Certaines lançaient leur tête en tous sens se tordant et se tournant dans leur lutte pour se libérer. Souvent on entendait de grands cris et parfois le choc sourd du corps d'un individu qui se jetait contre les planches latérales de son box. Parfois, suite à cela, une truie s'effondrait sur le sol [16]. » Ces violentes tentatives pour s'échapper peuvent durer jusqu'à trois heures. Puis l'agitation retombe, rapporte Cronin, et les truies restent couchées immobiles pendant de longues périodes, le groin souvent enfoncé sous les barreaux, émettant de temps en temps un faible grognement ou un bruit de gémissement. Après un moment encore, elles manifestent d'autres signes de stress, rongeant par exemple les barreaux de leur box, mâchant quand il n'y a rien à mâcher, agitant la tête d'avant en arrière, et ainsi de suite. Ce genre d'activité est appelé comportement stéréotypique. Quiconque a vu dans un zoo des lions, des tigres ou des ours gardés dans des enceintes en béton brut aura déjà observé des comportements stéréotypiques — les animaux vont et viennent sans cesse le long des barrières de leurs cages. Les truies n'ont même pas cette possibilité. Comme nous l'avons vu, dans les conditions naturelles la truie est un animal très actif, consacrant plusieurs heures par jour à chercher sa nourriture, à manger et à explorer son environnement. Dans son box, le fait de ronger les barreaux constitue, comme l'a noté un vétérinaire, « une des rares expressions physiques possibles dans son environnement aride [17]. » p. 256. En 1988, après plus de vingt ans de confinement des truies, fut publiée une importante étude montrant que dans leur malheur, les verrats et truies confinés servant à la procréation subissent une autre source de détresse : ils ont en permanence faim. Les animaux engraissés pour la vente reçoivent autant de nourriture qu'ils voudront bien en manger ; mais donner aux animaux reproducteurs plus que le strict minimum nécessaire à la continuation de leur reproduction serait, du point de vue de l'éleveur, dépenser de l'argent en pure perte. L'étude montrait que les porcs qui reçoivent les rations recommandées en Grande-Bretagne par le Conseil de recherche agricole n'ont que 60 % de ce qu'ils mangeraient s'ils avaient plus de nourriture à leur disposition. De plus, leur empressement à actionner un levier pour obtenir une portion supplémentaire était pratiquement le même après qu'ils avaient consommé leur ration quotidienne qu'avant, indiquant par là qu'ils avaient encore faim immédiatement après avoir mangé [18]. p. 268. Les producteurs laitiers doivent s'assurer que leurs vaches auront un veau chaque année pour qu'elles continuent à donner du lait. Le veau est enlevé à sa mère dès sa naissance, ce qui est aussi douloureux pour elle que terrifiant pour lui. La mère exprime souvent ses sentiments sans équivoque en appelant et en beuglant sans arrêt pendant des jours après qu'on lui a enlevé son petit. [...] « Le veau né de la vache laitière est soumis régulièrement à plus d'atteintes à son développement normal que ne l'est tout autre animal d'élevage. On l'enlève à sa mère peu de temps après sa naissance, on le prive de sa nourriture naturelle, le lait entier de vache, et on le nourrit avec un des divers substituts liquides qui existent et qui reviennent moins chers [19]. » La vache laitière, malgré l'image paisible, voire idyllique, que nous gardons d'elle parcourant les collines, est maintenant une machine à lait soigneusement contrôlée et réglée avec précision. La scène bucolique de la vache laitière jouant avec son veau dans les prés n'a aucune place dans la production laitière commerciale. Beaucoup de vaches laitières sont élevées à l'intérieur. Certaines sont maintenues dans des boxes individuels avec seulement assez de place pour se lever et se coucher. Leur environnement est totalement contrôlé : elles reçoivent des quantités calculées de nourriture, la température ambiante est ajustée en vue d'une production maximale de lait, et le niveau d'éclairage est réglé artificiellement. p. 258. 
Quand ils sont petits, les veaux sont attachés par une chaîne autour du cou pour qu'ils ne puissent pas se tourner dans leur box. (On la leur enlèvera éventuellement lorsqu'ils auront assez grandi pour que l'étroitesse de leur box suffise à les empêcher de se tourner.) Ils n'ont ni paille ni autre litière, car ils risqueraient de la manger, et de gâter du coup la pâleur de leur chair. Ils ne quitteront leur box que pour être menés à l'abattoir. La nourriture qu'ils reçoivent est entièrement liquide, faite à base de lait écrémé en poudre additionné de vitamines, de minéraux et de médicaments favorisant la croissance. Telle sera alors la vie des veaux durant seize semaines. Ce qui fait le charme de ce système, du point de vue du producteur, c'est qu'à cet âge le veau pèse jusqu'à près de 200 kg au lieu des 40 qu'il peut peser à la naissance ; et comme la viande de veau rapporte un très bon prix, cette méthode d'élevage constitue une occupation rentable. Cette méthode d'élevage des veaux fut introduite aux États-Unis en 1962 par Provimi Inc., producteur d'aliments pour animaux basé à Watertown, dans le Wisconsin. p. 263. Comme si cela ne suffisait pas, le veau est délibérément maintenu anémique. Dans sa revue Stall Street Journal, Provimi explique pourquoi : « La couleur de la viande de veau est un des principaux facteurs qui contribuent à lui faire rapporter le prix le plus élevé sur les marchés exigeants du veau [...] La viande de veau "pâle" est un article de premier choix très demandé dans les meilleurs clubs, hôtels et restaurants. La "pâleur" ou couleur rosée de la viande est en partie liée à la quantité de fer contenue dans les muscles du veau [20]. » La soif insatiable de fer chez le veau anémique est une des raisons pour lesquelles l'éleveur cherche à l'empêcher de se tourner dans son box. Les veaux, comme les porcs, préfèrent normalement rester à l'écart de leur propre urine et de leurs selles ; mais l'urine contient une certaine quantité de fer. L'attrait pour le fer est assez puissant pour l'emporter sur la répugnance naturelle, de sorte que les veaux anémiques lécheront les lattes imbibées d'urine. Pour que les animaux grandissent vite, ils doivent ingérer autant de nourriture que possible, et en dépenser le moins possible pour leurs besoins quotidiens. Pour veiller à ce qu'ils mangent le plus possible, on les prive généralement d'eau. Leur seule source d'eau est leur nourriture liquide — ce riche substitut de lait à base de lait en poudre et de graisses. Comme les bâtiments où ils vivent sont chauffés, ils ont soif et consomment plus de nourriture qu'ils ne le feraient s'ils pouvaient boire de l'eau. Cette surconsommation provoque fréquemment chez les veaux des accès de transpiration, un peu comme, a-t-on dit, les accès dont souffre un cadre supérieur qui a mangé trop et trop vite [21]. En transpirant, le veau perd de l'eau, ce qui lui donne soif et l'amène à nouveau à trop manger. Selon les critères normaux, un tel processus est malsain, mais selon les critères de l'éleveur de veau dont le but est de produire le plus vite possible le veau le plus gros possible, la santé à long terme de l'animal ne compte pas, du moment qu'il survit jusqu'au moment de la vente ; ce qui fait dire à Provimi que la transpiration est signe que « le veau est en bonne santé et grandit à plein régime [22]. » p. 281. Presque tous les éleveurs de boeufs coupent les cornes à leurs animaux, les marquent au fer rouge et les castrent. Toutes ces opérations sont susceptibles de causer une douleur physique grave. On coupe les cornes aux boeufs parce que sans cela ils prennent plus de place devant leur mangeoire ou lors du transport, et qu'ils peuvent se blesser les uns les autres lorsqu'ils sont fortement entassés. Les carcasses meurtries et les cuirs abîmés rapportent moins. Les cornes ne sont pas une simple masse osseuse insensible. Leur ablation implique la section d'artères et d'autres tissus, et le sang gicle, surtout s'il ne s'agit pas d'un veau né depuis peu. La castration est pratiquée en vertu de l'idée que les boeufs castrés prennent plus de poids que les taureaux — bien qu'en fait il ne s'agisse apparemment que de graisse — et en raison de la crainte que les hormones mâles ne communiquent un mauvais goût à la chair. Les animaux castrés sont en outre plus faciles à manier. La plupart des éleveurs admettent que l'opération est cause pour l'animal de choc et de douleur. Les animaux ne sont généralement pas anesthésiés. La procédure consiste à immobiliser l'animal par terre et à inciser la peau des bourses avec un couteau, mettant les testicules à nu. Vous saisissez ensuite chaque testicule à son tour et vous tirez dessus jusqu'à rompre le cordon qui le retient ; dans le cas d'un animal plus âgé, il peut être nécessaire de couper le cordon [23]. p. 287. Tuer un animal est en soi un acte troublant. Il a été dit que s'il nous fallait tuer nous-mêmes pour obtenir notre viande nous serions tous végétariens. Ce qui est sûr c'est que très peu de gens vont visiter un jour un abattoir, et que la télévision ne se rue pas pour montrer des films portant sur les opérations qui s'y déroulent. Certains espéreront que la viande qu'ils achètent provient d'un animal dont la mort fut sans douleur ; mais ils ne tiennent pas vraiment à le savoir. Pourtant, ceux qui, par leurs achats, imposent que des animaux soient tués ne méritent pas qu'on leur cache ni cet aspect ni aucun autre de la production de la viande qu'ils achètent. La mort, bien que jamais agréable, n'est pas nécessairement douloureuse. Si tout fonctionne comme prévu, dans les pays industrialisés dotés de lois stipulant que l'abattage doit se faire humainement, la mort survient rapidement et sans douleur. Les animaux doivent être étourdis par un courant électrique ou par un pistolet d'abattage et être encore inconscients au moment où leur sera tranchée la gorge. Peut-être ressentent-ils de la terreur peu de temps avant de mourir, lorsqu'ils sont sur la rampe, aiguillonnés vers l'abattage, sentant l'odeur du sang de ceux qui sont passés avant eux ; mais le moment de la mort elle-même peut être, en théorie, complètement indolore. Malheureusement, il y a souvent une différence entre la théorie et la pratique. Un journaliste du Washington Post a récemment décrit un abattoir de l'État de Virginie géré par Smithfield, le plus gros conglomérat de conditionnement de viande de la côte est des États-Unis : Le processus de fabrication de la viande de porc se termine dans une usine dernier cri hautement automatisée où le bacon et le jambon proprement enfermés dans de petits emballages plastiques hermétiques tombent du tapis roulant. Mais elle commence dehors derrière l'usine, dans la puanteur d'un enclos à porcs boueux et sanglant. Dans l'abattoir Gwaltney of Smithfield les visiteurs ne sont autorisés que quelques minutes, de peur que la puanteur des porcs morts ne leur colle aux vêtements et à la peau encore longtemps après leur départ. Le processus débute lorsque les porcs couinants sont poussés hors de leurs enclos sur une planche en bois inclinée où un employé les étourdit d'un choc électrique au crâne. Au moment où ils tombent, un autre employé les accroche la tête en bas sous une chaîne roulante, les pattes arrière tenues dans un crampon métallique. Parfois un porc étourdi tombe de la chaîne et reprend conscience, et les employés doivent se précipiter pour le soulever et replacer ses pattes arrière dans les crampons avant qu'il ne se mette à courir sauvagement à travers la pièce. Les porcs sont tués pour de bon par un employé qui enfonce un couteau dans la veine jugulaire de l'animal étourdi, mais qui se tortille souvent encore, et laisse s'écouler la plus grande partie du sang. Les porcs fraîchement tués quittent alors l'abattoir maculé de sang pour passer dans l'eau bouillante [24]. Une bonne part de la souffrance qui survient dans les abattoirs résulte de la cadence frénétique que doit maintenir la chaîne d'abattage. La compétition économique fait que chaque abattoir s'efforce de tuer plus d'animaux par heure que ses concurrents. Entre 1981 et 1986, par exemple, dans une des grandes usines américaines, la vitesse de la chaîne est passée de 225 carcasses par heure à 275. La pression pour augmenter la cadence implique un travail moins soigneux — et il n'y a pas que les animaux gui en pâtissent. En 1988 un comité du Congrès des États-Unis rapporta qu'aucune autre industrie américaine n'a un taux plus élevé de maladies et d'accidents corporels que l'industrie de l'abattage. Les données recueillies indiquaient que 58 000 employés d'abattoir sont victimes d'accidents corporels chaque année, soit environ 160 par jour. Si les humains sont l'objet de si peu d'égards, quel doit être le sort des animaux ? Un autre problème majeur dans cette industrie est que, parce que le travail y est si peu agréable, les employés n'y restent pas longtemps, et un turn-over annuel entre 60 et 100 % est courant dans beaucoup d'établissements. Il en résulte un flot constant d'employés inexpérimentés maniant des animaux effrayés dans un environnement étrange [25]. Conclusion sur la souffrance infligée aux animaux p. 276. Thorpe concluait : « Certains faits élémentaires sont assez clairs pour justifier que l'on agisse. Tout en acceptant la nécessité de beaucoup de restriction, nous devons placer la limite quand les conditions où sont mis les animaux étouffent complètement toute ou presque toute expression des pulsions naturelles et instinctives et des besoins comportementaux qui caractérisent les actes appropriés dans le haut degré d'organisation sociale que l'on trouve chez les espèces sauvages ancestrales, et qui ont peu ou pas du tout été éliminés par sélection au cours du processus de domestication. En particulier il est clairement cruel de restreindre un animal pendant une bonne partie de sa vie d'une façon qui l'empêche de mettre en oeuvre aucun de ses modèles comportementaux locomoteurs [26]. » [...] La fausseté de l'argument selon lequel les animaux sont forcément satisfaits dès lors qu'ils sont productifs est maintenant également universellement admise parmi les scientifiques. [...] Le Dr Bill Gee, directeur fondateur du Bureau de santé animale du gouvernement australien, a déclaré : « On affirme que la productivité des animaux d'élevage est un signe direct de leur bien-être. Cette idée fausse doit être enterrée une fois pour toutes. Le "bien-être" se réfère au fait pour un animal individuel de se sentir bien, alors que la "productivité" désigne le rendement par dollar investi ou par unité de ressources [27]. » p. 283. Et enfin, quand on évalue le bien-être des animaux dans les systèmes traditionnels, il importe de se souvenir que presque toutes les méthodes comportent la séparation précoce entre la mère et son petit, ce qui occasionne aux deux une détresse considérable. Aucune forme d'élevage ne permet aux animaux de grandir et de prendre place dans une communauté d'animaux d'âges variés, comme cela se produirait dans les conditions naturelles.
|
|||||
|
p. 300. L'élevage intensif n'est rien d'autre que le résultat de l'application de la technologie à l'idée que les animaux sont des moyens pour nos fins. Nos habitudes alimentaires nous sont chères et nous n'en changeons pas facilement. Nous avons un intérêt puissant à nous convaincre nous-mêmes de ce que notre préoccupation pour les autres animaux n'exige pas que nous cessions de les manger. Quiconque est accoutumé à manger un certain animal ne peut être complètement objectif quand il juge si les conditions dans lesquelles cet animal est élevé le font souffrir. Il n'est pas possible dans la pratique d'élever les animaux pour la consommation sur une grande échelle sans leur infliger une quantité considérable de souffrance. Même sans les méthodes intensives, l'élevage traditionnel comporte la castration, la séparation de la mère et de ses petits, la rupture des groupes sociaux, le marquage au fer rouge, le transport jusqu'à l'abattoir, et enfin l'abattage lui-même. Il est difficile d'imaginer comment on pourrait élever des animaux pour la nourriture sans leur infliger ces formes de souffrance. Peut-être cela serait-il possible sur une petite échelle, mais nous ne pourrions jamais nourrir les énormes populations urbaines actuelles avec de la viande produite de cette façon. La chair animale produite sans souffrance serait, si tant est qu'elle puisse exister, considérablement plus chère que n'est la viande aujourd'hui — alors que l'élevage est déjà une méthode coûteuse et inefficace pour produire des protéines. La chair d'animaux qui auraient été élevés et tués en accordant l'égalité de considération à leur bien-être pendant leur vie serait un article de luxe à la portée des seuls riches. p. 303. Ceux qui tirent profit de l'exploitation de nombreux animaux n'ont pas besoin de notre approbation. Ils ont besoin de notre argent. L'achat du cadavre des animaux qu'ils élèvent représente la principale forme de soutien que les éleveurs industriels demandent au public (l'autre forme étant, dans beaucoup de pays, les importantes subventions que leur verse le gouvernement). Ils emploieront les méthodes intensives aussi longtemps qu'ils pourront en vendre les produits ; ils auront les ressources qui leur permettront de s'opposer à la réforme au niveau politique ; et ils seront en position de se défendre contre la critique en répondant qu'ils ne font que fournir au public ce qu'il leur demande. De là la nécessité pour chacun d'entre nous de cesser d'acheter les produits de l'élevage moderne — même si nous ne sommes pas convaincus qu'il serait mal de manger des animaux qui auraient vécu des vies agréables et qui seraient morts sans douleur. Le végétarisme est une forme de boycott. [...] Tant que nous ne boycottons pas la viande, ainsi que tous les autres produits de l'élevage industriel, chacun de nous, individuellement, contribue à la perpétuation, à la prospérité et à la croissance de l'élevage industriel et de toutes les autres pratiques cruelles qui sont utilisées pour élever les animaux pour la nourriture. Pour rendre le végétarisme en tant que boycott encore plus efficace, nous ne devons pas nous montrer timides dans notre refus de manger de la chair animale. Les végétariens vivant dans des sociétés omnivores se voient sans cesse demander les raisons de leur étrange régime. Cela peut être agaçant, voire gênant, mais donne aussi l'occasion de parler aux gens de cruautés dont ils peuvent ignorer l'existence. [...] George Bernard Shaw disait que seraient présents à son enterrement les nombreux moutons, vaches, boeufs, porcs et poulets, ainsi qu'un banc entier de poissons, tous reconnaissants d'avoir été épargnés de l'abattage et de la mort grâce à son alimentation végétarienne. p. 308. Quelle proportion de protéines que le veau reçoit pans sa ration brûle-t-il pour lui-même, et quelle proportion garde-t-il disponible pour les êtres humains ? La réponse est surprenante. Il faut donner 21 kg de protéines à un veau pour produire un seul kilogramme de protéines animales pour les humains. Nous récupérons moins de 5 % de ce que nous avons investi. Il n'est pas étonnant que Frances Moore Lappé ait qualifié ce genre d'agriculture d'« usine à détruire les protéines [28] » ! Nous pouvons envisager la question sous un autre angle. Supposons que nous disposions d'un hectare de terre fertile. Nous pouvons utiliser cette surface pour cultiver une plante comestible à haut rendement en protéines, par exemple des petits pois ou des haricots. Nous obtiendrons alors de notre hectare entre 300 et 550 kg de protéines. À l'inverse, nous pouvons consacrer cette surface à des cultures dont nous nourrirons des animaux, et ensuite tuer et manger ces animaux. De notre hectare nous tirerons alors en fin de compte entre 45 et 60 kg de protéines. Il est intéressant de noter que, même si la plupart des animaux convertissent les protéines végétales en protéines animales plus efficacement que ne le font les bovins — le porc, par exemple, exige 8 kg « seulement » de protéines pour produire 1 kg pour les humains — cet avantage disparaît presque entièrement quand nous considérons la quantité de protéines produite par hectare, parce que les bovins peuvent mettre à profit des sources de protéines que les porcs ne digèrent pas. Ainsi la plupart des estimations concluent-elles que la nourriture végétale apporte environ dix fois plus de protéines par hectare que ne le fait la viande, bien que les estimations puissent varier, le rapport allant parfois jusqu'à vingt [29]. Si au lieu de tuer les animaux pour manger leur chair nous les utilisons pour obtenir du lait ou des oeufs, notre rendement s'améliore considérablement. Cependant, les animaux devront encore consommer des protéines pour leurs propres besoins, et les formes de production de lait ou d'oeufs les plus efficaces ne fournissent en protéines par hectare pas plus que le quart de ce que peuvent fournir les plantes comestibles. Les protéines ne sont évidemment qu'un des nombreux nutriments qui nous sont nécessaires. Si nous comparons la nourriture végétale à la nourriture animale du point de vue du nombre total de calories que nous en obtenons, le résultat est encore entièrement en faveur des plantes. L'examen de l'apport en calories d'un hectare planté d'avoine ou de brocolis, ou de plantes fourragères pour produire du lait ou de la viande de porc, de poulet ou de boeuf, montre qu'avec de l'avoine on obtient six fois plus de calories par hectare qu'avec la viande de porc, qui est la plus efficace de ces productions animales de ce point de vue. Avec les brocolis on obtient près de trois fois plus de calories par hectare qu'avec la viande de porc. L'avoine produit plus de vingt-cinq fois plus de calories par hectare que le boeuf. L'examen de la situation concernant quelques autres nutriments détruit encore d'autres mythes entretenus par les industries de la viande et des produits laitiers. Par exemple, un hectare de brocolis produit vingt-quatre fois plus de fer que ne le fait un hectare utilisé pour la viande de boeuf, et un hectare d'avoine seize fois plus. Bien qu'à l'inverse le lait fournisse plus de calcium par hectare que ne le fait l'avoine, les brocolis font encore mieux, donnant cinq fois plus de calcium que le lait [30]. p. 311. La production de viande pèse également lourdement sur d'autres ressources. Alan Durning, chercheur dans un groupe de réflexion environnemental basé à Washington, le Worldwatch Institute, calcula que 100 grammes de bifteck venant d'un boeuf élevé en parc d'engraissage coûtent 500 grammes de céréales, 2 000 litres d'eau, l'équivalent en énergie de près d'un litre d'essence, et l'érosion d'environ 3,5 kilogrammes de terre arable. Plus d'un tiers de l'Amérique du Nord est consacré au pâturage, et près de la moitié de la surface cultivée aux États-Unis produit de la nourriture pour les animaux d'élevage, lesquels reçoivent plus de la moitié de toute l'eau consommée dans ce pays [31]. De tous ces points de vue, les aliments végétaux sont bien moins exigeants pour nos ressources et notre environnement. p. 313. Les statistiques du British Water Authorities Association (association des services publics de l'eau) relèvent en 1985 plus de 3 500 cas de pollution de l'eau dus aux élevages. En voici un seul exemple pour cette année-là : suite à la rupture d'un réservoir dans un élevage de porcs, un quart de million de litres d'excréments de porcs se sont déversés dans une rivière, le Perry, provoquant la mort de 110 000 poissons. Plus de la moitié des poursuites intentées aujourd'hui par les services de l'eau pour pollution grave des rivières le sont contre des agriculteurs [32]. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'une modeste usine à oeufs de 60 000 poules produit 82 tonnes d'excréments chaque semaine, et 2 000 porcs excrètent sur la même période 27 tonnes de fumier et 32 tonnes d'urine. Les fermes hollandaises produisent 94 millions de tonnes de fumier chaque année, dont seulement 50 millions peuvent sans risques être absorbées par le sol. L'excédent remplirait, a-t-on calculé, un train de marchandises de 16 000 kilomètres de long s'étendant d'Amsterdam jusqu'aux rives les plus éloignées du Canada. Mais cet excédent n'est pas expédié au loin ; il est simplement déversé sur le sol où il pollue les réserves d'eau et tue ce qui reste de végétation naturelle dans les régions agricoles des Pays-Bas [33]. Aux États-Unis, les animaux d'élevage produisent 2 milliards de tonnes de fumier chaque année — soit à peu près dix fois plus que la population humaine — et la moitié de cette masse provient d'animaux élevés de façon intensive, dont les excréments ne retournent pas de façon naturelle à la terre [34]. Comme l'a dit un éleveur de porcs : « Tant que l'engrais que j'achète ne coûte pas plus cher que la main-d'oeuvre, ces déchets n'auront pour moi que très peu de valeur [35]. » Ainsi le fumier qui devrait redonner leur fertilité à nos terres se retrouve en train de polluer nos ruisseaux et nos rivières. Ce sera toutefois la dilapidation des forêts qui restera comme la plus grande de toutes les folies qu'aura causée notre demande pour la viande. Historiquement, ce fut le désir d'obtenir des pâturages pour les animaux qui représenta la principale motivation poussant à la déforestation. Cela reste vrai aujourd'hui. Au Costa Rica, en Colombie, au Brésil, en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie, les forêts tropicales sont abattues pour faire place à des pâturages pour le bétail. [...] Au cours des vingt dernières années, près de la moitié des forêts tropicales d'Amérique centrale ont été détruites, en grande partie pour approvisionner en viande de boeuf l'Amérique du Nord. 90 % peut-être des espèces végétales et animales de cette planète vivent sous les tropiques, beaucoup d'entre elles restant encore non répertoriées par les scientifiques [36]. Si la déforestation se poursuit à son rythme actuel, ces espèces sont vouées à disparaître. De plus, le déboisement accroît l'érosion, augmente le ruissellement, provoque de ce fait des inondations, prive les paysans du bois qui leur sert de combustible, et diminue peut-être les précipitations [37]. Nous sommes en train de perdre ces forêts au moment même où nous commençons à comprendre à quel point elles sont d'une importance vitale pour nous. Depuis la sécheresse nord-américaine de 1988, beaucoup de gens ont entendu parler de l'effet de serre et de la menace qu'il pose à notre planète. [...] La destruction d'une forêt relâche dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique le carbone qui y était contenu. À l'inverse, une nouvelle forêt, au cours de sa croissance, absorbe du gaz carbonique de l'atmosphère et en emprisonne le carbone dans sa matière vivante. La destruction des forêts existantes amplifiera l'effet de serre ; c'est dans un reboisement massif, ajouté à d'autres mesures pour réduire les émissions de gaz carbonique, que se trouve le seul espoir que nous avons de l'atténuer [38]. p. 316. Les raisons qui rendent nécessaire une rupture radicale dans nos habitudes alimentaires sont claires ; mais ne devons-nous manger que des aliments végétaux ? Où exactement faut-il tracer la ligne ? [...] Vous devez décider pour vous-même où vous allez tracer la ligne, et votre décision ne coïncidera pas forcément exactement avec la mienne. Cela n'est pas très grave. On peut distinguer les hommes chauves des hommes qui ne le sont pas sans avoir à se prononcer sur chaque cas limite. Ce qui importe, c'est l'accord sur les questions fondamentales. J'espère que tout lecteur arrivé à ce point de ce livre reconnaîtra la nécessité morale de refuser d'acheter ou de manger la chair et les autres produits provenant d'animaux gardés dans les conditions de l'élevage industriel moderne. Ce cas est le plus clair de tous, il représente le minimum absolu que quiconque possède la capacité de voir au-delà des limites étroites de la considération de ses propres intérêts devrait pouvoir accepter. p. 318. Nous en arrivons alors à d'autres questions plus difficiles. Jusqu'où devons-nous descendre dans l'échelle de l'évolution ? Devons-nous cesser de manger les poissons ? Qu'en est-il des crevettes ? Et des huîtres ? [...] Si un être souffre, il ne peut y avoir de justification morale pour ne pas prendre en compte cette souffrance, ou pour refuser de lui donner autant de poids qu'à une souffrance semblable ressentie par un autre être. Mais la réciproque également est vraie. Si un être n'est pas capable de souffrir, ni de ressentir le plaisir, il n'y a rien à prendre en compte. [...] Chez les reptiles et les poissons, le système nerveux diffère de celui des mammifères par certains aspects importants, mais partage avec lui sa structure fondamentale basée sur des voies nerveuses à organisation centrale. Les poissons et les reptiles manifestent la plupart des mêmes comportements face à la douleur que les mammifères. Chez la plupart des espèces il existe même des vocalisations, qui sont toutefois inaudibles pour nos oreilles. Les poissons, par exemple, émettent des sons vibratoires, et des chercheurs ont pu distinguer divers « appels », comprenant des sons d'« alarme » et d'« irritation ».[39] Ainsi, par souci tant des poissons que des êtres humains, nous devons éviter de manger du poisson. Il est certain que les personnes qui continuent à en manger tout en refusant de consommer d'autres animaux ont fait un grand pas les éloignant du spécisme ; celles qui s'abstiennent aussi du poisson ont fait un pas de plus. p. 323. Les animaux comme les huîtres, les moules, les palourdes et les coquilles Saint-Jacques sont des mollusques, lesquels sont en général des organismes très simples. (Il y a une exception : les poulpes, seiches et calmars sont des mollusques beaucoup plus évolués, et sans doute plus sensibles, que leurs lointains cousins.) Les doutes qui existent concernant la capacité d'êtres comme les huîtres à ressentir la douleur sont considérables ; et dans la première édition de ce livre je suggérai que quelque part entre les crevettes et les huîtres pouvait bien être un endroit aussi valable qu'un autre pour tracer la ligne. En conséquence, je continuai à manger occasionnellement les huîtres, coquilles Saint-Jacques et moules pendant quelque temps après que je fus devenu, sous tous autres rapports, végétarien. Néanmoins, tout comme on ne peut dire avec quelque confiance que ces êtres ressentent la douleur, de même est-il tout aussi peu sûr qu'ils ne la ressentent pas. De plus, si de fait ces animaux sont sensibles, un repas d'huîtres ou de moules fera souffrir un nombre considérable d'êtres. Puisqu'il est si facile d'éviter de les manger, aujourd'hui je considère préférable de m'en abstenir [40]. p. 327. Par contre, la stratégie suivante est, sinon idéale, du moins raisonnable et praticable :
p. 330. [...] S'habituer à des menus sans plat central en chair animale peut prendre du temps, mais une fois l'habitude prise, vous vous trouverez face à l'obligation de choisir entre un si grand nombre de nouveaux plats intéressants que vous vous demanderez pourquoi vous n'avez jamais pensé qu'il vous serait difficile de vous passer de viande. p. 330. En plus de se préoccuper de la saveur de leurs repas, les gens qui envisagent de devenir végétariens risquent aussi de se demander si leur régime sera adéquat du point de vue nutritionnel. De telles inquiétudes sont tout à fait sans fondement. Dans de nombreuses régions du monde il existe des populations de culture végétarienne dont les membres jouissent d'une santé aussi bonne, voire meilleure, que les non-végétariens de régions comparables. Les hindous de stricte obédience sont végétariens depuis plus de deux mille ans. Gandhi, qui fut végétarien toute sa vie, avait près de quatre-vingts ans quand la balle d'un assassin mit un terme à son active existence. En Grande-Bretagne, où depuis maintenant plus de cent quarante ans existe un mouvement végétarien officiel, on trouve des végétariens de troisième et de quatrième génération. De nombreux végétariens éminents, tels Léonard de Vinci, Léon Tolstoï et George Bernard Shaw, ont vécu de longues vies immensément créatives. On peut même dire que la plupart des gens qui ont vécu une vie exceptionnellement longue ont mangé peu ou pas de viande. Les habitants de la vallée de Vilcabamba, en Équateur, deviennent souvent centenaires, et les scientifiques y ont même trouvé des hommes âgés de 123 et de 142 ans ; ces gens mangent moins de cinq grammes de viande par jour. Une étude portant sur tous les centenaires vivants en Hongrie a trouvé qu'ils étaient largement végétariens [41]. Le fait que la viande n'est pas nécessaire à l'endurance physique est attesté par la longue liste des athlètes de haut niveau qui n'en mangent pas, au nombre desquels on trouve Murray Rose, champion olympique de nage à longue distance ; Paavo Nurmi, célèbre coureur de fond finlandais ; Bill Walton, champion de basket ; le triathlète Dave Scott surnommé « l'homme de fer » ; et Edwin Moses, champion olympique du 400 mètres haies. Beaucoup de végétariens disent se sentir plus en forme, en meilleure santé et plus vifs qu'à l'époque où ils mangeaient de la viande. Une masse de données récentes soutient ces affirmations. p. 333. Les spécialistes de la nutrition ne débattent plus entre eux pour savoir si la chair animale est indispensable ; aujourd'hui ils s'accordent pour dire qu'elle ne l'est pas. Si les gens ordinaires ont encore des doutes à ce sujet, ceux-ci sont fondés sur l'ignorance. La plupart du temps, cette ignorance porte sur la question des protéines. On nous dit souvent que les protéines représentent un élément important dans un régime équilibré, et que la viande en contient beaucoup. Ces deux énoncés sont vrais, mais il y a deux autres choses qu'on nous dit moins souvent. La première est que l'Américain moyen mange trop de protéines. Son apport en protéines dépasse de 45 % les recommandations déjà larges faites à ce sujet par l'Académie nationale des sciences. Selon d'autres estimations la plupart des Américains consomment de deux à quatre fois plus de viande que ne peut en utiliser leur corps. Les protéines en excès ne peuvent être stockées. Une partie est éliminée, et une autre convertie par l'organisme en glucides, ce qui représente une façon onéreuse d'augmenter son apport en glucides [42]. |
|||||
|
[1] Peter Singer, La libération animale, Peter Singer © 1975, 1990 et 2012 (Payot & Rivages © 2012). [2] Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, chapitre 17. [3] Journal of Comparative and Physiological Psychology, n° 80 (1), 1972, p. 11. [4] Les chiffres cités concernant la recherche furent compilés par Martin Stephens, Ph. D., et rapportés dans Maternal Deprivation Experiments in Psychology : A Critique of Animal Models, rapport préparé pour l'American Anti-Vivisection Society, la National Anti-Vivisection Society et la New England Anti-Vivisection Society (Boston, 1986). [5] Experimental Animals, n° 37, 1988, p. 35. [6] Nature, n° 334, 4 août 1988, p. 445. [7] Rapport du Littlewood Committee, p. 53 et 166 ; cité par Richard Ryder, « Experiments on Animals », in Stanley et Roslind Godlovitch, John Harris (dir.), Animals, Men, and Morals, New York, Taplinger, 1972, p. 43. [8] G. Carpenter et al., « Effect of internal air filtration on the performance of broilers and the aerial concentrations of dust and bacteria », British Poultry Journal, n° 27, 1986, p. 471-480. [9] « Air in your shed a risk to your health », Poultry Digest, décembre 1987-janvier 1988. [10] Roy Bedichek, Adventures with a Naturalist, cité par Ruth Harrison, Animal Machines, op. cit., p. 154. [11] Der Spiegel, n° 47, 1980, p. 264 ; cité in Intensive Egg and Chicken Production, Huddersfield, RU, Chickens' Lib. [12] Poultry Tribuen, mars 1974. [13] US Department of Agriculture, Fact Sheet : Swine Management, AFS-3-8-12, Department of Agriculture, Office of Governmental and Public Affairs, Washington, DC. [14] F. Butler, cité in John Robbins, Se nourrir sans faire souffrir, Montréal, Stanké, 1990, p. 94. [15] Farm Journal, mars 1973. [16] G. Cronin, « The development and significance of abnormal stereotyped behaviour in tethered sow », thèse de doctorat, Université de Wageningen, Pays-Bas, p. 85. [17] Roger Ewbank, « The trouble with being a farm animal », New Scientist, 18 octobre 1973. [18] A. Lawrence, M. Appleby, H. MacLeod, « Measuring hunger in the pig using opérant conditioning : The effect of food restriction », Animal Production, n° 47, 1988. [19] J. Webster, « Health and welfare of animais in modem husbandry Systems — Dairy cade », In Practice, mai 1986, p. 85. [20] The Stall Street Journal, novembre 1973. [21] Former and Stockbreeder, 13 septembre 1960, cité par Ruth Harrison, Animal Machines, op. cit., p. 70. [22] The Stall Street Journal, avril 1973. [23] Dehorning, Castrating, Branding, Vaccinating Cattle, publication n° 384 du Mississippi State University Extension Service, en collaboration avec le USDA ; voir aussi BeefCattle : Dehorning, Castrating, Branding and Marking, USDA, Farmers' Bulletin, n° 2141, septembre 1972. [24] The Washington Post, 30 septembre 1987. [25] Colman McCarthy, « Those who eat meat share in die guilt », The Washington Post, 16 avril 1988. [26] W. H. Thorpe, (directeur du département de comportement animal de l'université de Cambridge) Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animais Kept Under Intensive Livestock Husbandry Systems, appendix. [27] B. Gee, The 1985 Muresk Lecture, Muresk Agricultural Collège, Western Australian Institute of Technology, p. 8. [28]
Frances Moore Lappé, Diet for a Small Planet, New York, Friends of the Earth/Ballantine 1971, p. 4-11.
[en français :
Sans viande et sans regrets, Éditions l'Étincelle, Montréal © 1976,
p. 18.] [29] Le chiffre le plus élevé est de Folke Dovring, dans « Soy-beans », Scientific American, février 1974. Keith Akers présente un autre ensemble de chiffes dans A Vegetarian Sourcebook, New York, Putnam, 1983, chapitre X. Ses tables comparent le rendement nutritif à l'hectare de l'avoine, des brocolis, du porc, du lait, de la volaille et du boeuf. Bien que l'avoine et les brocolis ne soient pas des aliments hautement protéinés, aucun des aliments animaux ne donnait même seulement la moitié des protéines que donnent les aliments végétaux. Les sources originales utilisées par Akers sont : US Department of Agriculture, Agricultural Statistics, 1979 ; US Department of Agriculture, Nutritive Value of American Foods, Washington, DC, US Government Printing Office, 1975 ; et C. W. Cook, « Use of rangelands for future meat production », Journal of Animal Science, n° 45, 1977, p. 1476. [30] Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook, op. cit., p. 90 et 91, selon les sources précitées. [31] Science News, 5 mars 1988, p. 153, qui citait Worldwatch, janvier-février 1988. [32] Fred Pearce, « A green unpleasant land », New Scientist, 24 juillet 1986, p. 26. [33] Sue Armstrong, « Marooned in a mountain of manure », New Scientist, 26 novembre 1988. [34] J. Mason, P. Singer, Animal Factories, New York, Crown, 1980, p. 84, citant R. C. Loehr, Pollution Implications of Animal Wastes — A Forward Oriented Review, Water Pollution Control Research Series, US Environmental Protection Agency, Washington, DC, 1968, p. 26 et 27 ; H. A. Jasiorowski, « Intensive Systems of animal production », in R. L. Reid (dir.), Proceedings of the II World Conference on Animal Production, Sydney, Sydney University Press, 1975, p. 384 ; et J. W. Robbins, Environmental Impact Resulting from Unconfined Animal Production, Cincinnati, Environmental Research Information Center, US. Environmental Protection Agency, 1978, p. 9. [35] « Handling waste disposai problems », Hog Farm Management, avril 1978, p. 17, cité in J. Mason, P. Singer, Animal Factories, op. cit., p. 88. [36] E. O. Williams, Biophilia, Cambridge, Harvard University Press, 1984, p. 137. [37] Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook, op. cit., p. 99 et p. 100 ; basé sur H. W. Anderson et al., Forests and Water : Effects of Forest Management on Floods, Sedimentation and Water Supply, US Department of Agriculture Forest Service General Technical Report PSW-18/1976 ; et J. Kittridge, « The influence of the forest on the weather and other environmental factors », in Forest Influences, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 1962. [38] Fred Pearce, « Planting trees for a cooler world », New Scientist, 15 octobre 1988, p. 21. [39] L. Milne, M. Milne, The Senses of Men and Animals, Middlesex et Baltimore, Penguin Books, 1965, chapitre V. [40] Mon changement d'avis concernant les mollusques fait suite à des conversations avec R. J. Sikora. [41] David Davies, « A Shangri-La in Ecuador », New Scientist, 1er février 1973. Se fondant sur d'autres études, Ralph Nelson de la Mayo Médical School a suggéré qu'une consommation élevée de protéines nous amènerait à « augmenter le rythme de notre moteur métabolique » (Médical World News, 8 novembre 1974, p. 106). Cela pourrait expliquer la corrélation entre longévité et consommation faible ou nulle de viande. [42] Frances Moore Lappé, Diet for a Small Planet, op. cit., p. 28 et 29 [en français : Sans viande et sans regrets, op. cit., p. 31 et 59] voir aussi The New York Times, 25 octobre 1974 ; Médical World News, 8 novembre 1974, p. 106.
|
|||||