
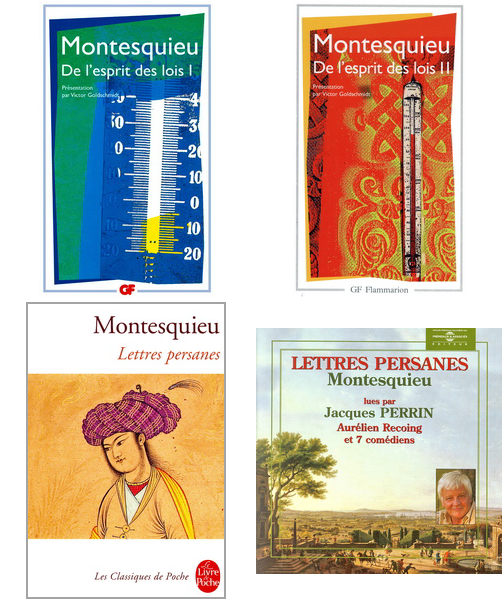
1748 et 1721
Les Pouvoirs
 |
|
||||
|
|
|||||
|
1748 et 1721 |
|||||
|
Les Pouvoirs |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
De la nature des trois divers gouvernements [1] Il y a trois espèces de gouvernements : 1. le Républicain, 2. le Monarchique et 3. le Despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l'un que le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple a la souveraine puissance ; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Voilà ce que j'appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature, et qui par conséquent sont les premières lois fondamentales.
1. Démocratie Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque ; à certains autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner. Libanius dit que à Athènes un étranger qui se mêlait dans l'assemblée du peuple, était puni de mort. C'est qu'un tel homme usurpait le droit de souveraineté. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. À Lacédémone, il fallait dix mille citoyens. À Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur ; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n'avait point fixé ce nombre ; et ce fut une des grandes causes de sa ruine. Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Ses ministres ne sont point à lui s'il ne les nomme : c'est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat. Mais, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres ; soit qu'il les choisisse lui-même, comme à Athènes ; ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions. Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tels ou tels succès ; il est donc très capable d'élire un général. Il sait qu'un juge est assidu ; que beaucoup de gens se retirent de son tribunal content de lui ; qu'on ne l'a pas convaincu de corruption ; en voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d'un citoyen ; cela suffit pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique, qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ? Non : il ne le saura pas. Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains ; ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard. On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire ; et quoiqu'à Athènes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon, que le bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire. Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour être élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même. [...]
Aristocratie Dans l'aristocratie, la souveraine puissance est entre les mains d'un certain nombre de personnes. Ce sont elles qui font les lois et qui les font exécuter ; et le reste du peuple n'est tout au plus à leur égard que, comme dans une monarchie, les sujets sont à l'égard du monarque. On n'y doit point donner le suffrage par sort ; on n'en aurait que les inconvénients. En effet, dans un gouvernement qui a déjà établi les distinctions les plus affligeantes, quand on serait choisi par le sort, on n'en serait pas moins odieux : c'est le noble qu'on envie, et non pas le magistrat. Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui règle les affaires que le corps des nobles ne saurait décider, et qui prépare celles dont il décide. Dans ce cas, on peut dire que l'aristocratie est en quelque sorte dans le sénat, la démocratie dans le corps des nobles, et que le peuple n'est rien. [...]
2. Monarchie Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J'ai dit les pouvoirs, intermédiaires, subordonnés et dépendants : en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pourvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a dans l'État que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale. Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l'essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque ; mais on a un despote. Il y a des gens qui avoient imaginé, dans quelques États en Europe, d'abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyaient pas qu'ils voulaient faire ce que le parlement d'Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes ; vous aurez bientôt un État populaire, ou bien un État despotique. [...]
3. Despotisme Il résulte de la nature du pouvoir despotique que l'homme seul qui l'exerce le fasse de même exercer par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires. Mais, s'il les confiait à plusieurs, il y aurait des disputes entre eux ; on ferait des brigues pour être le premier esclave ; le prince serait obligé de rentrer dans l'administration. Il est donc plus simple qu'il l'abandonne à un vizir qui aura d'abord la même puissance que lui. L'établissement d'un vizir est, dans cet État, une loi fondamentale. On dit qu'un pape, à son élection, pénétré de son incapacité, fit d'abord des difficultés infinies. Il accepta enfin, et livra à son neveu toutes les affaires. Il était dans l'admiration, et disait : « Je n'aurais jamais cru que cela eût été si aisé. » Il en est de même des princes d'Orient. Lorsque de cette prison, où des eunuques leur ont affaibli le coeur et l'esprit, et souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire pour les placer sur le trône, ils sont d'abord étonnés ; mais, quand ils ont fait un vizir, et que dans leur sérail ils se sont livrés aux passions les plus brutales ; lorsqu'au milieu d'une cour abattue ils ont suivi leurs caprices les plus stupides, ils n'auraient jamais cru que cela eût été si aisé. Plus l'empire est étendu, plus le sérail s'agrandit, et plus, par conséquent, le prince est enivré de plaisirs. Ainsi, dans ces États, plus le prince a de peuples à gouverner, moins il pense au gouvernement ; plus les affaires y sont grandes, et moins on y délibère sur les affaires. [...] |
|||||
|
La séparation des pouvoirs Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois [1. ministre] pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté [2. armée], prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes [3. juge], ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État. La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger [juge] n'est pas séparée de la puissance législative [ministre] et de l'exécutrice [roi (police, armée)]. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de 1. faire des lois, celui 2. d'exécuter les résolutions publiques, et celui de 3. juger les crimes ou les différends des particuliers. Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. |
|||||
|
Les 9 ordres de lois Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois ; par le 1. droit naturel ; par le 2. droit divin, qui est celui de la religion ; par le 3. droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le 4. droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le 5. droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes les sociétés ; par le 6. droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le 7. droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu, ou a dû faire violence à un autre ; par le 8. droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens et sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le 9. droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles, qui ont besoin d'un gouvernement particulier. Il y a donc différents ordres de lois ; et la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes. |
|||||
|
Le pouvoir des femmes J'ai vu le jeune monarque. Sa vie est bien précieuse à ses sujets. Elle ne l'est pas moins à toute l'Europe, par les grands troubles que sa mort pourrait produire. Mais les rois sont comme les dieux, et, pendant qu'ils vivent, on doit les croire immortels. Sa physionomie est majestueuse, mais charmante ; une belle éducation semble concourir avec un heureux naturel, et promet déjà un grand prince. On dit que l'on ne peut jamais connaître le caractère des rois d'Occident jusqu'à se qu'ils aient passé par les deux grandes épreuves, de leur maîtresse, et de leur confesseur. On verra bientôt l'un et l'autre travailler à se saisir de l'esprit de celui-ci, et il se livrera pour cela de grands combats : car, sous un jeune prince, ces deux puissances sont toujours rivales ; mais elles se concilient et se réunissent sous un vieux. Sous un jeune prince, le dervis a un rôle bien difficile à soutenir : la force du roi fait sa faiblesse ; mais l'autre triomphe également de sa faiblesse et de sa force. Lorsque j'arrivai en France, je trouvai le feu roi absolument gouverné par les femmes, et, cependant, dans l'âge où il était, je crois que c'était le monarque de la terre qui en avait le moins de besoin. J'entendis un jour une femme qui disait : « Il faut que l'on fasse quelque chose pour ce jeune colonel : sa valeur m'est connue ; j'en parlerai au ministre. » Une autre disait : « Il est surprenant que ce jeune abbé ait été oublié ; il faut qu'il soit évêque : il est homme de naissance, et je pourrais répondre de ses moeurs ». Il ne faut pas pourtant que tu t'imagines que celles qui tenaient ces discours fussent des favorites du prince ; elles ne lui avaient peut-être pas parlé deux fois en leur vie : chose pourtant très facile à faire chez les princes européens. Mais c'est qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la Cour, dans Paris ou dans les provinces, qui n'ait une femme par les mains de laquelle passent toutes les grâces et quelquefois les injustices qu'il peut faire. Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres, et forment une espèce de république, dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement : c'est comme un nouvel État dans l'État ; et celui qui est à la cour, à Paris, dans les provinces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des prélats, s'il ne connaît les femmes qui les gouvernent, est comme un homme qui voit bien une machine qui joue, mais qui n'en connaît point les ressorts. Crois-tu, Ibben, qu'une femme s'avise d'être la maîtresse d'un ministre pour coucher avec lui ? Quelle idée ! c'est pour lui présenter cinq ou six placets tous les matins, et la bonté de leur naturel paraît dans l'empressement qu'elles ont de faire du bien à une infinité de gens malheureux qui leur procurent cent mille livres de rente. On se plaint, en Perse, de ce que le royaume est gouverné par deux ou trois femmes. C'est bien pis en France, où les femmes en général gouvernent, et non seulement prennent en gros, mais même se partagent en détail, toute l'autorité. De Paris, le dernier de la lune de Chalval, 1717. |
|||||
|
[1] Montesquieu, De l'Esprit des lois 1, (1748), Folio #275 - Gallimard © 1995, Livre deuxième, p. 99-113. [2] Ibid., Livre onzième, Ch. VI, p. 327-328. [3] Montesquieu, De l'Esprit des lois 2, (1748), GF #326 © 1979, Livre XXVI, Ch. I, p. 177.
[4]
Montesquieu,
Lettres persanes, (Lues par Jacques Perrin), Frémeaux et Associés © 2006, CD3-01.
|
|||||