
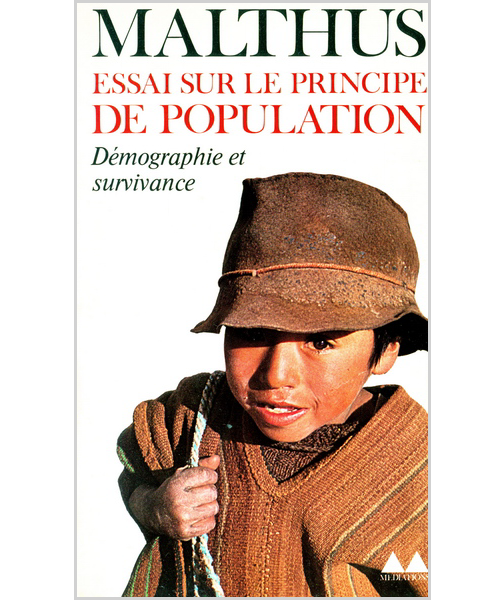
1803
Essai sur le principe de population
Démographie et survivance [1]
 |
|
||||
|
|
|||||
|
1803 |
|||||
|
Essai sur le principe de population |
|||||
|
2. p. 24 On peut conclure de ce qui précède que l'obstacle primordial à l'augmentation de la population est le manque de nourriture, qui provient lui-même de la différence entre les rythmes d'accroissement respectifs de la population et de la production. Mais cet obstacle n'agit de manière immédiate que dans les cas où la famine exerce ses ravages. Des obstacles immédiats sont constitués par les coutumes et les maladies que fait naître la rareté des moyens de subsistance, ainsi que par toutes les autres causes physiques et morales qui tendent à ravir prématurément la vie. Ces obstacles agissent avec plus ou moins de force dans toutes les sociétés humaines pour y maintenir constamment le nombre des individus au niveau des moyens de subsistance. Ils peuvent être rangés sous deux chefs : les uns agissent en prévenant l'accroissement de la population ; les autres, en la détruisant à mesure qu'elle se forme. La somme des premiers forme ce qu'on peut appeler l'obstacle préventif ; celle des seconds, l'obstacle destructif. Dans la mesure où il est volontaire, l'obstacle préventif est propre à l'espèce humaine et découle d'une faculté qui la distingue des animaux : celle de prévoir et d'apprécier des conséquences éloignées. Les obstacles qui s'opposent à l'accroissement indéfini des plantes et des animaux sont tous de nature destructive ; ou s'ils sont préventifs, ils n'ont rien de volontaire. Mais il suffit que l'homme regarde autour de lui pour qu'il soit frappé par le spectacle offert par les familles nombreuses : en comparant ses moyens personnels de subsistance (qui n'excèdent guère la mesure de ses besoins) avec le nombre des individus entre lesquels il devra en faire le partage (et ce nombre peut fort bien s'élever jusqu'à sept ou huit sans que ses moyens soient fort accrus), il éprouve la crainte de ne pouvoir nourrir les enfants qu'il aura fait naître. Tel serait du moins l'objet de son inquiétude dans une société fondée sur un système d'égalité, si toutefois il peut en exister une. Mais dans la situation actuelle, d'autres considérations interviennent. Ne court-il pas le risque de perdre son rang et d'être forcé de renoncer à des habitudes qui lui sont chères ? Quelle occupation, quel emploi sera à sa portée ? Ne devra-t-il pas s'imposer des travaux plus pénibles ou se jeter dans des entreprises plus difficiles ? Pourra-t-il procurer à ses enfants les avantages d'éducation dont il a joui lui-même ? Si leur nombre grandit encore, est-il assuré que ses efforts suffiront à les mettre à l'abri de la misère et du mépris qui l'accompagne ? Enfin, ne devra-t-il pas renoncer à l'indépendance dont il est fier, pour avoir recours à une charité toujours insuffisante ? Dans toute société civilisée, des réflexions de ce genre sont bien faites pour prévenir, et préviennent en effet, un grand nombre de mariages précoces, et s'opposent à cet égard à la tendance naturelle. Une contrainte imposée à nos penchants, et surtout à l'un de ceux qui ont sur nous le plus d'empire, produit un sentiment pénible. Mais s'il n'en résulte pas de vices, c'est encore là le moindre des maux produits par le Principe de Population. Mais que cette contrainte vienne à engendrer le vice et le cortège de maux qui l'accompagnent frappe tous les regards. Le dérèglement des moeurs (lorsqu'il est porté au point d'empêcher la naissance des enfants) avilit la nature humaine et lui ravit sa dignité. Voilà son effet sur les hommes : mais combien il est encore plus dégradant pour les femmes ! De toutes les personnes touchées par le malheur, il n'y en a pas qui soient plongées dans une misère plus affreuse que les déplorables victimes de la prostitution, si communes dans les grandes villes. Lorsque la corruption devient générale et s'étend à toutes les classes de la société, elle a pour effet inévitable d'empoisonner la source du bonheur domestique et d'affaiblir les liens d'affection qui unissent les époux, ou qui attachent les parents aux enfants : elle nuit enfin à l'éducation. Telles sont les causes actives qui diminuent le bonheur de la société et portent à la vertu une fâcheuse atteinte. En particulier, ces maux sont le résultat des artifices qu'exige la conduite d'une intrigue, et des moyens employés pour en cacher les suites. Les obstacles destructifs qui s'opposent à l'accroissement de la population sont très variés. Ils englobent tous les phénomènes qui tendent à abréger, par le vice ou le malheur, la durée naturelle de la vie humaine. On peut ainsi ranger sous ce chef les métiers malsains ; les travaux rudes, pénibles ou exposant à l'inclémence des saisons ; l'extrême pauvreté ; la mauvaise nourriture des enfants ; l'insalubrité des grandes villes ; les excès de tous genres ; enfin les maladies et épidémies, la guerre, la peste et la famine. Si on examine maintenant tous les obstacles à l'accroissement de la population que j'ai classés sous deux chefs généraux (c'est-à-dire les obstacles préventifs et destructifs), on voit qu'ils peuvent être réduits à trois éléments : la contrainte morale, le vice, et les souffrances. Parmi les obstacles préventifs, le fait de s'abstenir du mariage et la chasteté forment ce que j'appelle la contrainte morale [2]. Le libertinage, les passions contraires à la nature, la profanation du lit nuptial et tous les artifices employés pour cacher les suites des liaisons criminelles ou irrégulières, sont des obstacles préventifs qui appartiennent manifestement à la classe des vices. Parmi les obstacles destructifs, je désigne par le mot de malheur ceux qui se présentent comme une suite inévitable des lois de la nature. Au contraire, ceux que nous faisons naître nous-mêmes (comme les guerres, les excès et plusieurs autres sortes de maux évitables) sont d'une nature mixte : c'est le vice qui les suscite, et ils amènent à leur suite le malheur. La somme de tous les obstacles préventifs et destructifs forme ce que j'appelle l'obstacle immédiat à l'accroissement de la population. Dans un pays où celle-ci ne peut pas croître indéfiniment, les obstacles préventifs et destructifs doivent être en raison inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire que, dans les pays malsains ou sujets à une grande mortalité (quelle qu'en soit la cause), l'obstacle préventif aura peu d'influence ; dans ceux qui jouissent au contraire d'une grande salubrité, et où l'obstacle préventif agit avec force, l'obstacle destructif agira faiblement et la mortalité sera très faible. En tout pays, certains des obstacles que j'ai énumérés agissent avec plus ou moins de force, mais d'une manière constante. Or, malgré cette influence permanente, rares sont les pays où la population ne montre pas une tendance constante à s'accroître au-delà des possibilités de subsistance. Cette tendance constante plonge dans la détresse les classes inférieures de la société et s'oppose à toute amélioration de leur sort. Le mode d'action de ces obstacles, dans l'état actuel de la société, mérite de retenir l'attention. Supposons un pays dans lequel les moyens de subsistance sont suffisants pour nourrir la population. La tendance de celle-ci à s'accroître (même dans les sociétés les plus vicieuses, cette tendance ne cesse jamais d'exercer une certaine pression) fait que le nombre des humains s'accroît plus vite que les possibilités de subsistance. Par suite, le pauvre vit plus difficilement : certains même se voient réduits aux plus dures extrémités. Le nombre des ouvriers s'accroissant d'autre part plus vite que la quantité d'ouvrage à faire, le prix du travail tombe, et comme le prix de la nourriture augmente en même temps, il arrivera fatalement que, pour vivre comme auparavant, l'ouvrier soit obligé de travailler davantage. Pendant cette période de misère, les mariages sont tellement découragés et les embarras de famille si fortement accrus que la population s'arrête et devient stationnaire. À ce moment, le prix du travail très bas, l'abondance des ouvriers et la nécessité pour eux d'augmenter leur travail, encouragent les cultivateurs à mieux travailler la terre, à défricher les terres incultes et à fumer ou améliorer celles qui sont en culture, ceci jusqu'à ce que les moyens de subsistance soient remontés au point où ils étaient au départ. Alors la situation de l'ouvrier redevient moins pénible et l'obstacle à l'accroissement de la population cesse. Après une courte période d'équilibre, les mêmes mécanismes de régression, puis de progression se répéteront de nouveau. L'une des principales raisons pour lesquelles on n'a guère remarqué ces oscillations est que les historiens ne s'occupent généralement que des classes les plus élevées de la société. Il n'existe pas beaucoup d'ouvrages consacrés aux usages et à la manière de vivre des classes inférieures. Or c'est justement dans ces classes-là que les fluctuations dont j'ai parlé se font sentir le plus. Une autre cause a souvent masqué ces oscillations : c'est la différence entre le prix réel du travail et son prix nominal. Le prix du travail baisse rarement partout à la fois ; souvent aussi il reste le même, tandis que le prix des subsistances hausse graduellement, ce qui correspond à une baisse réelle du prix du travail ; et tant que dure cette hausse graduelle des subsistances, le sort des classes inférieures empire. Au contraire, grâce au bas prix du travail, les fermiers et les capitalistes s'enrichissent, accroissent leurs capitaux et peuvent employer un plus grand nombre d'ouvriers. Il est évident que pendant ce temps la difficulté qu'on éprouve à entretenir une famille s'est accrue : la population diminue donc. Au bout d'un certain temps, la demande de travail est devenue plus grande que l'offre : par conséquent, le prix réel du travail augmente (si rien n'empêche que ce prix se mette à son niveau). Tel est le mécanisme par lequel les salaires, et à travers eux la condition des classes inférieures, éprouvent des baisses et des hausses, c'est-à-dire des mouvements de régression et de progrès, bien que le prix nominal du travail ne baisse pas. Les primitifs, chez qui le travail n'a pas de prix défini, n'en sont pas moins exposés à des oscillations identiques. Lorsque leur population a atteint le niveau qu'elle ne peut dépasser, tous les obstacles qui empêchent son accroissement et ceux qui la détruisent se manifestent intensément. Les habitudes vicieuses se multiplient, l'abandon des enfants se généralise, les guerres et les épidémies deviennent plus fréquentes et plus meurtrières. Ces causes continuent à se manifester jusqu'à ce que la population soit réduite au niveau compatible avec les moyens de subsistance. Alors, le retour à une relative abondance provoque un nouvel accroissement de population, qui sera à son tour freiné quelque temps après par les mêmes causes que je viens d'énumérer. Je n'entreprendrai pas de suivre dans les différents pays ces mouvements alternativement rétrogrades et progressifs... et je me bornerai à énoncer les propositions suivantes : 1. Le niveau de la population est nécessairement limité par les moyens de subsistance. 2. La population s'accroît partout où croissent les moyens de subsistance, à moins que des obstacles puissants ne l'arrêtent. 3. Ces obstacles particuliers, et tous ceux qui freinent l'accroissement de la population et la forcent à se réduire constamment au niveau des moyens de subsistance, peuvent tous se rapporter à trois chefs : la contrainte morale, le vice et le malheur. La première de ces propositions n'a certainement pas besoin d'être appuyée de preuves. Quant aux deux autres, elles seront prouvées par l'examen auquel nous allons nous livrer de la situation des peuples anciens et modernes, que nous étudierons sous cet aspect spécial. C'est l'objet des chapitres suivants. |
|||||
|
p. 60 En Europe, le taux moyen des naissances par rapport aux mariages est à peu près de 4 à 1. [...] Dans les mémoires de la Société de Philadelphie, dans un rapport intitulé Observations sur la probabilité de vie aux États-Unis, M. Barton donne comme proportion des mariages par rapport aux naissances le taux de 1 pour 4 ½ (l'auteur dit 6 ½, mais les nombres dont il tire cette conclusion ne donnent que 4 ½). Cependant, comme il s'agit principalement des villes, il est probable que le nombre des naissances est trop petit et je pense qu'on ne risque pas de l'évaluer trop haut en retenant le taux de 1 pour 5, pour la moyenne des villes et de la campagne. [...] [...] En Angleterre, le taux moyen des mariages par rapport aux naissances paraît avoir été ces dernières années de 100 pour 350. J'ai estimé à 1/6 les omissions dans le compte des naissances et des morts ; mais je ne les imputerai ici que pour 1/7, afin de tenir compte des naissances qui ne résultent pas de mariages, c'est-à-dire des naissances illégitimes. Ainsi, le rapport des mariages aux naissances sera de 1 pour 4, et le rapport des mariages aux décès de 1 pour 3. En tenant compte des secondes et troisièmes noces, le rapport des mariages aux décès deviendra 1 pour 3,6. Trois causes agissent efficacement pour produire un excédent des naissances par rapport aux décès : 1° la fécondité des mariages ; 2° la proportion des nouveau-nés qui parviennent à l'état du mariage ; 3° la précocité des mariages par comparaison avec la durée moyenne de la vie, en d'autres termes, la brièveté de la durée qui sépare la naissance du mariage, comparée à la durée moyenne de la vie. TABLE I
Soit un pays comprenant 100 000 habitants |
| Si le taux des décès par rapport aux naissances est de : | En ce cas, l'excès des naissances sera de : | L'excès des naissances sur les décès par rapport à l'ensemble de la population sera de : | Et par conséquent la période de doublement sera de : | |
| 10 pour{ | 11 | 277 | 1/360e |
250 ans |
| 12 | 555 | 1/180e |
125 " |
|
| 13 | 833 | 1/120e |
83 1/2 |
|
| 14 | 1 110 | 1/90e |
62 3/4 |
|
| 15 | 1 388 | 1/72e |
50 1/4 |
|
| 16 | 1 666 | 1/60e |
42 |
|
| 17 | 1 943 | 1/51e |
35 3/4 |
|
| 18 | 2 221 | 1/45e |
31 2/3 |
|
| 19 | 2 499 | 1/40e |
28 |
|
| 20 | 2 777 | 1/36e |
25 3/10 |
|
| 22 | 3 332 | 1/30e |
21 1/8 |
|
| 25 | 4 165 | 1/24e |
17 |
|
| 30 | 5 554 | 1/18e |
12 4/5 |
|
|
|
|
9. p. 81 Le dernier recensement donne pour les États-Unis une population de 5 172 312 habitants [3]. Or il ne semble pas que l'émigration des fondateurs de ces États ait produit une diminution sensible dans la population de la Grande-Bretagne. Au contraire, une émigration modérée favorise le peuplement de la mère patrie : ainsi, on a remarqué que les provinces d'Espagne qui ont le plus fourni de colons à l'Amérique sont celles dont la population s'est accrue. Considérons maintenant le nombre primitif de ces émigrants venus de Grande-Bretagne, qui ont produit en Amérique du Nord une population aussi prolifique, et demandons-nous pourquoi ils n'en ont point autant produit dans leur pays d'origine. La raison de cette différence n'est autre que le manque d'aliments. Les grands fléaux, comme la guerre et les épidémies, causent des pertes d'hommes très vite réparées ; ils laissent le pays qu'ils ravagent dans une situation assez semblable à celle des colonies nouvelles. Si le travail des habitants s'est maintenu, leurs moyens de subsistance croissent au-delà de leurs besoins et la population se met bientôt au niveau de ces moyens. [...] Comme l'accroissement de la population est graduel et que l'homme ne peut pas vivre sans manger, le principe de population ne peut pas produire directement la famine : mais il la prépare en forçant les classes pauvres à se contenter du strict nécessaire. Dès lors, il suffit d'une mauvaise récolte pour qu'elles soient réduites à toute extrémité. Le Docteur Short place parmi les causes favorisantes de la disette une ou plusieurs années d'abondance : en effet, l'abondance favorise les mariages et amène une population excédentaire, à laquelle les ressources d'une année commune ne suffisent plus. La petite vérole, épidémie la plus généralement répandue et la plus destructive parmi celles qui affligent de nos jours l'Europe, est peut-être aussi une des plus inexplicables, bien qu'elle marque en certains lieux des retours périodiques réguliers. Aucun exemple ne prouve que cette maladie apparaisse indifféremment chez les personnes de tout état. Je ne veux pas dire que la petite vérole ne soit pas favorisée par la misère et l'entassement dans les maisons : mais dans les endroits où elle revient périodiquement et régulièrement et où elle exerce de grands ravages parmi les enfants, surtout ceux du peuple, on peut être sûr que la misère et l'entassement précèdent ou accompagnent son apparition. C'est-à-dire, que depuis la précédente épidémie, le nombre moyen des enfants a augmenté : par suite, les habitants sont devenus plus pauvres, et leurs habitations surpeuplées, jusqu'à ce qu'une nouvelle épidémie vienne enlever la population excédentaire. Dans tous ces cas, si le principe de population ne peut produire immédiatement des maladies, il exerce sans conteste une influence pour disposer l'organisme à recevoir la contagion, pour répandre le mal et l'aggraver. [...] [...] On peut en conclure que les pays où les subsistances augmentent assez pour encourager la population, mais pas assez pour satisfaire à toute sa demande, sont plus sujets aux épidémies périodiques que ceux où l'accroissement de la population reste proportionnel à la production moyenne. [...] [...] Si en un lieu donné, le taux des naissances par rapport aux décès indique un accroissement de population qui dépasse beaucoup le niveau des moyens de subsistance, nous pouvons affirmer avec certitude qu'à moins d'émigration les décès excéderont bientôt les naissances, et que le taux que nous venons d'observer ne sera nullement constant. Si l'obstacle préventif (qui prévient l'accroissement excessif de la population) venait à disparaître ou seulement à ralentir sa pression, et si les causes destructrices étaient supprimées, tous les pays seraient périodiquement ravagés par des épidémies et des famines. Le seul critère certain d'un accroissement réel et permanent de la population est donc l'augmentation des moyens de subsistance. Mais ce critère est lui-même sujet à de légères variations, d'ailleurs faciles à observer. Il y a des pays où la population semble avoir été « forcée ». Le peuple est habitué à se contenter du minimum de nourriture compatible avec la survie : cette habitude a été contractée peu à peu, dans des périodes où la population augmentait insensiblement sans que les subsistances fassent de progrès. La Chine, l'Inde, les territoires des Arabes Bédouins, répondent (comme on l'a vu) à cette situation. Le produit moyen de ces pays suffit tout juste aux besoins de leurs habitants ; la moindre diminution provenant d'une mauvaise récolte y a donc les effets les plus funestes. Ces peuples ne peuvent échapper aux famines. En Amérique, où le travail est si bien payé, les classes inférieures peuvent facilement diminuer leur consommation dans les années de pénurie, sans éprouver de souffrance ; aussi une famine paraît-elle à peu près impossible. Mais il viendra un temps où les ouvriers se ressentiront de l'accroissement de la population et seront moins bien payés parce que les moyens de subsistance n'auront pas suivi le taux de multiplication des habitants. [...] On peut d'ailleurs dire que les différents pays sont peuplés en proportion de la quantité d'aliments qu'ils produisent ou qu'on peut s'y procurer ; et que le bonheur existe en fonction de la facilité avec laquelle on y peut distribuer les aliments, ou en d'autres termes en raison de la quantité d'aliments que l'ouvrier peut acheter avec le salaire d'une journée de travail. Les pays à blé sont plus peuplés que les pays de pâturages ; et les pays à riz sont plus peuplés que les pays à blé. Mais le bonheur de ces différents pays ne dépend ni du nombre de leurs habitants, ni de leur richesse, ni de leur ancienneté : il dépend de l'équilibre existant entre leur population et la quantité des aliments qu'on y trouve. Ce rapport est en général très favorable dans les colonies nouvelles : là, l'intelligence et le labeur d'un peuple ancien s'appliquent à d'immenses terres neuves et vacantes. [...] [...] Ainsi, en examinant l'histoire du genre humain, à toutes les époques et dans toutes les situations où l'homme a vécu et vit encore, on peut admettre que : — l'accroissement de la population est nécessairement limité par les moyens de subsistance ; — la population augmente en même temps que les moyens de subsistance, à moins que cet accroissement ne soit empêché par des obstacles puissants et faciles à déceler ; — ces obstacles, et tous ceux qui ramènent la population au niveau des subsistances sont la contrainte morale, le vice et la misère. D'après tout ce qui précède, on voit assez clairement que, dans l'Europe moderne, les obstacles destructifs ont moins de force pour arrêter la population ; au contraire, les obstacles préventifs ont plus de force qu'autrefois, ou qu'ils en ont chez les peuples moins civilisés. La guerre, cause principale de dépopulation chez les peuples sauvages, est aujourd'hui moins destructrice, même si l'on tient compte des dernières et malheureuses guerres révolutionnaires. Depuis que l'hygiène est devenue plus répandue, que les villes sont mieux bâties et les rues mieux percées, depuis qu'une économie politique mieux comprise permet une distribution plus équitable des produits de la terre, les épidémies, les maladies violentes, les famines sont certainement plus rares et moins terribles. Quant aux obstacles préventifs, ce que nous appelons « contrainte morale » n'a pas beaucoup d'influence sur la fraction mâle de la société ; mais je suis persuadé que son influence est encore plus grande dans les États civilisés que dans ceux qui sont restés à l'état sauvage. Quant aux femmes, le nombre de celles qui pratiquent cette vertu est bien supérieur de notre temps dans cette partie du monde à ce qu'il était autrefois, ou à ce qu'il est actuellement chez les peuples moins civilisés. Mais quoiqu'il en soit, si, indépendamment des conséquences morales, on examine dans son ensemble la contrainte qu'on s'impose à l'égard du mariage, en y comprenant tous les actes où les mariages sont arrêtés par la crainte des charges de famille, on peut dire que cet obstacle est celui qui, dans l'Europe moderne, agit avec le plus de force pour maintenir la population au niveau des moyens de subsistance. |
|||||
|
p. 113 Pour remédier à la fréquente détresse des pauvres, on a établi des lois instituant un système de secours, et l'Angleterre s'est particulièrement distinguée en cette matière. Mais il est à craindre que si on a diminué par ce procédé les misères individuelles, on a par contre beaucoup étendu la pauvreté générale. On s'étonne dans le pays que malgré les sommes immenses collectées annuellement pour soulager les pauvres, leur détresse soit encore si grande. Certains émettent le soupçon que les fonds destinés à cet usage sont détournés ; d'autres accusent les marguilliers et les contrôleurs d'en engloutir la majeure part en festins. Tous s'accordent à penser que, d'une manière ou d'une autre, l'administration en est bien mauvaise. En bref, le fait que, même avant la cherté excessive de ces derniers temps, on levait annuellement trois millions de sterling pour les pauvres sans que pour autant la misère fût soulagée est un sujet continuel d'étonnement. Mais un homme qui pousse l'observation plus loin que les apparences serait bien plus étonné si les choses étaient autrement. Et même si, au lieu d'un impôt de quatre shillings par livre, on l'élevait à dix-huit shillings, il n'en résulterait aucun changement essentiel. Supposons que grâce à une souscription imposée aux riches, on arrive à donner à l'ouvrier cinq shillings par jour pour prix de son travail, au lieu de dix-huit pence ou deux shillings, comme actuellement, on pourrait peut-être s'imaginer que grâce à cette augmentation tous vivraient dans l'aisance et pourraient acheter tous les jours de la viande pour leur dîner. On se tromperait pourtant. En effet, le fait de donner trois shillings de plus à chaque ouvrier n'augmenterait nullement la quantité de viande qui existe dans le pays ; or il n'y en a pas assez actuellement pour que chaque habitant en ait sur sa table. Qu'arriverait-il donc ? La concurrence des acheteurs sur le marché ferait bientôt monter les prix ; alors qu'à présent la livre de viande coûte un peu moins d'un demi-shilling, elle en coûterait deux ou trois. En définitive, toute la production du pays ne serait pas répartie entre un plus grand nombre de personnes qu'actuellement. Quand une marchandise est rare et ne peut être distribuée à tous, elle va au plus offrant. Supposons maintenant que la concurrence pour la viande se maintienne entre les acheteurs assez longtemps pour inciter les paysans à augmenter leurs troupeaux et à intensifier l'élevage : ce ne pourrait être qu'au préjudice de la récolte de grain. Or cet échange serait très désavantageux. Il est évident que le pays ne pourrait plus nourrir la même population. Il s'ensuit que lorsque les subsistances sont rares par rapport au nombre des habitants, il importe peu que les gens des classes inférieures aient à dépenser deux shillings par jour ou cinq. Quelle que soit leur condition financière, ils n'en seront pas moins réduits à se contenter de la portion congrue. On avancera peut-être que l'accroissement du nombre des acheteurs donnera un nouvel essor à l'industrie et accroîtra la production totale du pays ? Mais cet essor sera plus que compensé par l'accroissement de population provoqué par ces richesses imaginaires. La production croissante devra alors être répartie entre un plus grand nombre de personnes, et leur accroissement sera sans doute plus rapide que celui de la production. Un impôt sur les riches atteignant 18 shillings par livre, même s'il était redistribué de la façon la plus judicieuse, aurait le même effet. Aucun sacrifice de la part des riches, surtout s'il est consenti en argent, ne peut prévenir de façon durable le retour de la misère dans les classes inférieures. On peut imaginer de grands changements dans les fortunes : les riches peuvent devenir pauvres, et certains pauvres riches ; mais tant que le rapport des subsistances à la population restera le même, il arrivera nécessairement que certains habitants auront beaucoup de peine à se nourrir, eux et leurs familles, et cette difficulté touchera toujours les plus pauvres. [...] Les lois anglaises en faveur des pauvres [4] conjuguent leur action pour empirer dans ces deux sens le sort du pauvre. D'abord, elles tendent manifestement à accroître la population, sans rien ajouter aux moyens de subsistance. Un pauvre peut se marier bien qu'il ait peu ou même pas du tout de possibilités de nourrir sa famille en dehors des secours paroissiaux : ainsi, ces lois créent les pauvres qu'elles assistent. Le résultat de ces institutions secourables est que les subsistances doivent être réparties en parts plus petites, ce qui fait que le travail de ceux qui ne sont pas assistés permet d'acheter une quantité de nourriture moindre qu'auparavant : et le nombre de ceux qui ont recours à l'assistance augmente sans cesse. En second lieu, la quantité d'aliments consommés dans les asiles et distribués à une partie de la société que l'on peut considérer comme la moins intéressante diminue d'autant la part des membres les plus laborieux et les plus dignes de récompense. Par ce mécanisme, les lois forcent donc un plus grand nombre d'individus à retomber à la charge de la collectivité. Et si les pauvres occupés dans les asiles y étaient encore mieux nourris et entretenus, cette nouvelle distribution d'argent empirerait le sort de ceux qui travaillent au-dehors en faisant monter encore plus sûrement le prix des subsistances. [...] Les lois sur les pauvres, telles qu'elles existent en Angleterre, ont contribué à faire monter le prix des subsistances et à abaisser le véritable prix du travail. Elles ont donc contribué à appauvrir la classe des travailleurs. [...] Le vice radical de tous les systèmes de ce genre est d'empirer le sort de ceux qui ne sont pas assistés et de créer par suite un plus grand nombre de pauvres. En effet, si on examine quelques-uns des statuts anglais relatifs à cet objet et si on les compare aux conséquences inévitables du principe de population, on verra qu'ils prescrivent ce qui est absolument impossible à réaliser. De telle sorte que nous ne saurions nous étonner s'ils manquent constamment leur but. |
|||||
|
20. p. 175 Si les principes que nous avons proposés résistent à l'examen et si nous sentons la nécessité d'y conformer notre conduite, il reste à examiner comment nous devrons procéder pour agir en pratique. Le premier obstacle important que nous rencontrons en Angleterre, est le système de Lois en faveur des Pauvres ; et si lourde que soit la dette nationale, les Lois en faveur des Pauvres sont encore plus catastrophiques. La rapidité avec laquelle la taxe des pauvres s'est accrue ces dernières années est telle qu'elle évoque un nombre de pauvres absolument incroyable dans une nation où fleurissent cependant les arts, l'agriculture et le commerce, et où le gouvernement a généralement été reconnu comme le meilleur parmi ceux qui ont affronté jusqu'ici l'épreuve des faits. [...] [...] lire une courte instruction dans laquelle on rappellerait : l'obligation stricte que tout homme a de nourrir ses enfants ; l'inconvenance et même l'immoralité qu'il y a à se marier sans avoir l'assurance de pouvoir remplir ce devoir ; les maux qui accablent les pauvres eux-mêmes lorsqu'on tente de faire assurer par des institutions collectives les fonctions que la nature a confiées aux seuls parents ; enfin la nécessité où l'on s'est trouvé d'abandonner ces institutions, en raison des effets qu'elles avaient produits et qui étaient directement opposés aux buts envisagés. [...] L'obligation imposée à chaque homme de pourvoir à l'entretien de ses enfants, légitimes ou illégitimes, est si évidente et impérieuse qu'il serait juste d'armer la société de tout le pouvoir nécessaire pour atteindre ce but. Mais je crois que, si rigoureux soit-il, le pouvoir civil ne dispose d'aucun moyen plus efficace — et de loin ! — que le fait d'avoir inculqué aux gens qu'à l'avenir les enfants seront entretenus uniquement par leurs parents, et que si ceux-ci les abandonnent, ils seront abandonnés aux hasards de la charité. [...] |
|||||
|
[1]
Malthus, Essai sur le principe de population, Ed. Seghers, Paris © 1963
(Traduction Dr Pierre Theil). [2] J'emploie ici le mot « moral » dans son sens le plus limité. J'entends par « contrainte morale » celle qu'un homme s'impose à l'égard du mariage pour un motif de prudence et lorsque sa conduite pendant tout ce temps est strictement morale. Je me suis appliqué, dans cet ouvrage, à ne jamais m'écarter de ce sens. Lorsque j'ai voulu parler de la contrainte qu'on s'impose à l'égard du mariage (sans parler des suites d'une telle contrainte) je l'ai appelée tantôt « contrainte prudente », tantôt « une partie de l'obstacle préventif » dont elle est sans contredit le constituant principal. On m'a objecté qu'en étudiant les différentes périodes de la société, je n'avais pas donné assez d'importance à l'effet préventif de la contrainte morale et à l'influence qu'il exerce pour prévenir l'accroissement de la population. Mais si on se réfère au sens limité que je viens d'indiquer, on découvrira que j'ai eu raison de donner à cette cause un rôle aussi peu actif que je l'ai fait. J'aimerais apprendre que je me suis trompé sur ce point. [3] D'après l'édition de 1925, la population des É.-U. était en 1820 de 7 861 710 habitants. N.D.T. [4]
À titre d'exemple de « lois sur les pauvres », voici l'une des plus célèbres,
l'Édit de la 43e année d'Elisabeth :
|
|||||