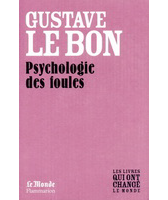1895
Psychologie des foules [1]
 |
|||||
|
|
|||||
|
1895 |
|||||
|
Psychologie des foules [1] |
|||||
|
[...] Les foules organisées ont toujours joué un rôle considérable dans la vie des peuples ; mais ce rôle n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. L'action inconsciente des foules se substituant à l'activité consciente des individus est une des principales caractéristiques de l'âge actuel. [...] |
|
[...] L'époque actuelle constitue un de ces moments critiques où la pensée des hommes est en voie de transformation. [...] [...] Alors que nos antiques croyances chancellent et disparaissent, que les vieilles colonnes des sociétés s'effondrent tour à tour, l'action des foules est l'unique force que rien ne menace et dont le prestige grandisse toujours. L'âge où nous entrons sera véritablement l'ère des foules. [...] Ce n'est plus dans les conseils des princes, mais dans l'âme des foules que se préparent les destinées des nations. [...] Peu aptes au raisonnement, les foules se montrent, au contraire, très aptes à l'action. L'organisation actuelle rend leur force immense. Les dogmes que nous voyons naître auront bientôt acquis la puissance des vieux dogmes, c'est-à-dire la force tyrannique et souveraine qui met à l'abri de la discussion. Le droit divin des foules va remplacer le droit divin des rois. |
|||||
|
LIVRE 1 - Chapitre 1 [...] Le fait le plus frappant présenté par une foule psychologique est le suivant : quels que soient les individus qui la composent, quelque semblables ou dissemblables que puissent être leur genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le seul fait qu'ils sont transformés en foule les dote d'une sorte d'âme collective. Cette âme les fait sentir, penser et agir d'une façon tout à fait différente de celle dont sentirait, penserait et agirait chacun d'eux isolément. Certaines idées, certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en foule. La foule psychologique est un être provisoire, formé d'éléments hétérogènes qui pour un instant soudés, absolument comme les cellules d'un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. [...] On constate aisément combien l'individu en foule diffère de l'individu isolé ; mais d'une pareille différence les causes sont moins faciles à découvrir. Pour arriver à les entrevoir, il faut se rappeler d'abord cette observation de la psychologie moderne : que ce n'est pas seulement dans la vie organique, mais encore dans le fonctionnement de l'intelligence que les phénomènes inconscients jouent un rôle prépondérant. La vie consciente de l'esprit ne représente qu'une très faible part auprès de sa vie inconsciente. L'analyste le plus subtil, l'observateur le plus pénétrant, n'arrive à découvrir qu'un bien petit nombre des mobiles inconscients qui le mènent. Nos actes conscients dérivent d'un substratum inconscient formé surtout d'influences héréditaires. Ce substratum renferme les innombrables résidus ancestraux qui constituent l'âme de la race.[2] Derrière les causes avouées de nos actes, se trouvent des causes secrètes ignorées de nous. La plupart de nos actions journalières sont l'effet de mobiles cachés qui nous échappent. C'est surtout par les éléments inconscients composant l'âme d'une race que se ressemblent tous les individus de cette race. C'est par les éléments conscients, fruits de l'éducation mais surtout d'une hérédité exceptionnelle, qu'ils diffèrent. Les hommes les plus dissemblables par leur intelligence ont des instincts, des passions, des sentiments parfois identiques. Dans tout ce qui est matière de sentiment : religion, politique, morale, affections, antipathies, etc., les hommes les plus éminents ne dépassent que bien rarement le niveau des individus ordinaires. Entre un célèbre mathématicien et son bottier, un abîme peut exister sous le rapport intellectuel, mais au point de vue du caractère et des croyances la différence est souvent nulle ou très faible. Or ces qualités générales du caractère, régies par l'inconscient et possédées à peu près au même degré par la plupart des individus normaux d'une race, sont précisément celles qui, chez les foules, se trouvent mises en commun. Dans l'âme collective, les aptitudes intellectuelles des hommes, et par conséquent leur individualité, s'effacent. L'hétérogène se noie dans l'homogène, et les qualités inconscientes dominent. Cette mise en commun de qualités ordinaires nous explique pourquoi les foules ne sauraient accomplir d'actes exigeant une intelligence élevée. Les décisions d'intérêt général prises par une assemblée d'hommes distingués, mais de spécialités différentes, ne sont pas sensiblement supérieures aux décisions que prendrait une réunion d'imbéciles. Ils peuvent seulement associer en effet ces qualités médiocres que tout le monde possède. Les foules accumulent non l'intelligence mais la médiocrité. Ce n'est pas tout le monde, comme on le répète si souvent, qui a plus d'esprit que Voltaire. Voltaire a certainement plus d'esprit que tout le monde, si « tout le monde » représente les foules. Mais si les individus en foule se bornaient à fusionner leurs qualités ordinaires, il y aurait simplement moyenne, et non, comme nous l'avons dit, création de caractères nouveaux. De quelle façon s'établissent ces caractères ? Recherchons-le maintenant. Diverses causes déterminent l'apparition des caractères spéciaux aux foules. La première est que l'individu en foule acquiert, par le fait seul du nombre, un sentiment de puissance invincible lui permettant de céder à des instincts, que, seul, il eût forcément refrénés. Il y cédera d'autant plus volontiers que, la foule étant anonyme, et par conséquent irresponsable, le sentiment de la responsabilité, qui retient toujours les individus, disparaît entièrement. Une seconde cause, la contagion mentale, intervient également pour déterminer chez les foules la manifestation de caractères spéciaux et en même temps leur orientation. La contagion est un phénomène aisé à constater, mais non expliqué encore, et qu'il faut rattacher aux phénomènes d'ordre hypnotique que nous étudierons dans un instant. Chez une foule, tout sentiment, tout acte est contagieux, et contagieux à ce point que l'individu sacrifie très facilement son intérêt personnel à l'intérêt collectif. C'est là une aptitude contraire à sa nature, et dont l'homme ne devient guère capable que lorsqu'il fait partie d'une foule. Une troisième cause, et de beaucoup la plus importante, détermine dans les individus en foule des caractères spéciaux parfois fort opposés à ceux de l'individu isolé. Je veux parler de la suggestibilité, dont la contagion mentionnée plus haut n'est d'ailleurs qu'un effet. Pour comprendre ce phénomène, il faut avoir présentes à l'esprit certaines découvertes récentes de la physiologie. Nous savons aujourd'hui qu'un individu peut être placé dans un état tel, qu'ayant perdu sa personnalité consciente, il obéisse à toutes les suggestions de l'opérateur qui la lui a fait perdre, et commette les actes les plus contraires à son caractère et à ses habitudes. Or des observations attentives paraissent prouver que l'individu plongé depuis quelque temps au sein d'une foule agissante tombe bientôt — par suite des effluves qui s'en dégagent, ou pour toute autre cause encore ignorée — dans un état particulier, se rapprochant beaucoup de l'état de fascination de l'hypnotisé entre les mains de son hypnotiseur. La vie du cerveau étant paralysée chez le sujet hypnotisé, celui-ci devient l'esclave de toutes ses activités inconscientes, que l'hypnotiseur dirige à son gré. La personnalité consciente est évanouie, la volonté et le discernement abolis. Sentiments et pensées sont alors orientés dans le sens déterminé par l'hypnotiseur. Tel est à peu près l'état de l'individu faisant partie d'une foule. Il n'est plus conscient de ses actes. Chez lui, comme chez l'hypnotisé, tandis que certaines facultés sont détruites, d'autres peuvent être amenées à un degré d'exaltation extrême. L'influence d'une suggestion le lancera avec une irrésistible impétuosité vers l'accomplissement de certains actes. Impétuosité plus irrésistible encore dans les foules que chez le sujet hypnotisé, car la suggestion, étant la même pour tous les individus, s'exagère en devenant réciproque. Les unités d'une foule qui posséderaient une personnalité assez forte pour résister à la suggestion sont en nombre trop faible et le courant les entraîne. Tout au plus pourront-elles tenter une diversion par une suggestion différente. Un mot heureux, une image évoquée à propos ont parfois détourné les foules des actes les plus sanguinaires. Donc, évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens, tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées, tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il n'est plus lui-même, mais un automate que sa volonté est devenue impuissante à guider. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'était peut-être un individu cultivé, en foule c'est un instinctif, par conséquent un barbare. Il a la spontanéité, la violence, la férocité, et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs. Il s'en rapproche encore par sa facilité à se laisser impressionner par des mots, des images, et conduire à des actes lésant ses intérêts les plus évidents. L'individu en foule est un grain de sable au milieu d'autres grains de sable que le vent soulève à son gré. Et c'est ainsi qu'on voit des jurys rendre des verdicts que désapprouverait chaque juré individuellement, des assemblées parlementaires adopter des lois et des mesures que réprouverait en particulier chacun des membres qui les composent. Pris séparément, les hommes de la Convention étaient des bourgeois, aux habitudes pacifiques. Réunis en foule, ils n'hésitèrent pas, sous l'influence de quelques meneurs, à envoyer à la guillotine les individus les plus manifestement innocents ; et contrairement à tous leurs intérêts, ils renoncèrent à leur inviolabilité et se décimèrent eux-mêmes. Ce n'est pas seulement par les actes que l'individu en foule diffère de son moi normal. Avant même d'avoir perdu toute indépendance, ses idées et ses sentiments se sont transformés, au point de pouvoir changer l'avare en prodigue, le sceptique en croyant, l'honnête homme en criminel, le poltron en héros. La renonciation à tous ses privilèges votée par la noblesse dans un moment d'enthousiasme pendant la fameuse nuit du 4 août 1789 n'eût certes jamais été acceptée par aucun de ses membres pris isolément. Concluons des observations précédentes que la foule est toujours intellectuellement inférieure à l'homme isolé. Mais au point de vue des sentiments et des actes que ces sentiments provoquent, elle peut, suivant les circonstances, être meilleure ou pire. Tout dépend de la façon dont on la suggestionne. C'est là ce qu'ont méconnu les écrivains n'ayant étudié les foules qu'au point de vue criminel. Criminelles, les foules le sont souvent, certes, mais, souvent aussi, héroïques. On les amène aisément à se faire tuer pour le triomphe d'une croyance ou d'une idée, on les enthousiasme pour la gloire et l'honneur, on les entraîne presque sans pain et sans armes comme pendant les croisades, pour délivrer de l'infidèle le tombeau d'un Dieu, ou, comme en 93, pour défendre le sol de la patrie. Héroïsmes évidemment un peu inconscients, mais c'est avec de tels héroïsmes que se fait l'histoire. S'il ne fallait mettre à l'actif des peuples que les grandes actions froidement raisonnées, les annales du monde en enregistreraient bien peu. |
|||||
|
LIVRE 1 - Chapitre 2 [...] Plusieurs caractères spéciaux des foules, tels que l'impulsivité, l'irritabilité, l'incapacité de raisonner, l'absence de jugement et d'esprit critique, l'exagération des sentiments, et d'autres encore, sont observables également chez les êtres appartenant à des formes inférieures d'évolution, comme le sauvage et l'enfant. [...] Aussi, errant constamment sur les limites de l'inconscience, subissant toutes les suggestions, animée de la violence de sentiments propre aux êtres qui ne peuvent faire appel à des influences rationnelles, dépourvue d'esprit critique, la foule ne peut que se montrer d'une crédulité excessive. L'invraisemblable n'existe pas pour elle, et il faut bien se le rappeler pour comprendre la facilité avec laquelle se créent et se propagent les légendes et les récits les plus extravagants. [...] Les déformations qu'une foule fait subir à un événement quelconque dont elle est le témoin devraient, semble-t-il, être innombrables et de sens divers, puisque les hommes qui la composent sont de tempéraments fort variés. Mais il n'en est rien. Par suite de la contagion, les déformations sont de même nature et de même sens pour tous les individus de la collectivité. La première déformation perçue par l'un d'eux forme le noyau de la suggestion contagieuse. Avant d'apparaître sur les murs de Jérusalem à tous les croisés, saint Georges ne fut certainement vu que d'un des assistants. Par voie de suggestion et de contagion, le miracle signalé fut immédiatement accepté par tous. Tel est le mécanisme de ces hallucinations collectives si fréquentes dans l'histoire, et qui semblent avoir tous les caractères classiques de l'authenticité, puisqu'il s'agit de phénomènes constatés par des milliers de personnes. [...] [...] les observations collectives sont les plus erronées de toutes et représentent le plus souvent la simple illusion d'un individu ayant, par voie de contagion, suggestionné les autres. D'innombrables faits prouvent la complète défiance qu'il faut avoir du témoignage des foules. Des milliers d'hommes assistèrent à la célèbre charge de cavalerie de la bataille de Sedan, et pourtant il est impossible, en présence des témoignages visuels les plus contradictoires, de savoir par qui elle fut commandée. Dans un livre récent, le général anglais Wolseley a prouvé que jusqu'ici les plus graves erreurs avaient été commises sur les faits les plus considérables de la bataille de Waterloo, faits attestés cependant par des centaines de témoins [3]. Tous ces exemples montrent, je le répète, ce que vaut le témoignage des foules. Les traités de logique font rentrer l'unanimité de nombreux témoins dans la catégorie des preuves les plus probantes de l'exactitude d'un fait. Mais ce que nous savons de la psychologie des foules montre combien ils s'illusionnent sur ce point. Les événements les plus douteux sont certainement ceux qui ont été observés par le plus grand nombre de personnes. Dire qu'un fait a été simultanément constaté par des milliers de témoins, c'est dire que le fait réel est en général fort différent du récit adopté. Il découle clairement de ce
qui précède qu'on doit considérer les livres d'histoire comme des
ouvrages d'imagination pure. Ce sont des récits fantaisistes de
faits mal observés, accompagnés d'explications forgées après coup.
Si le passé ne nous avait pas légué ses œuvres littéraires,
artistiques et monumentales, nous n'en connaîtrions rien de réel.
Savons-nous un seul mot de vrai sur la vie des grands hommes qui
jouèrent les rôles prépondérants dans l'humanité, tels qu'Hercule,
Bouddha, Jésus ou Mahomet ? Très probablement non. Au fond,
d'ailleurs, leur vie exacte nous importe peu. Les êtres qui ont
impressionné les foules furent des héros légendaires, et non des
héros réels. [...] [...] Dans la foule, l'exagération d'un sentiment est fortifiée par le fait que, se propageant très vite par voie de suggestion et de contagion, l'approbation dont il devient l'objet accroît considérablement sa force. La simplicité et l'exagération des sentiments des foules les préservent du doute et de l'incertitude. Comme les femmes, elles vont tout de suite aux extrêmes. Le soupçon énoncé se transforme aussitôt en évidence indiscutable. Un commencement d'antipathie ou de désapprobation, qui, chez l'individu isolé, resterait peu accentué, devient aussitôt une haine féroce chez l'individu en foule. La violence des sentiments des foules est encore exagérée, dans les foules hétérogènes surtout, par l'absence de responsabilité. La certitude de l'impunité, d'autant plus forte que la foule est plus nombreuse, et la notion d'un pouvoir momentané considérable dû au nombre, rendent possibles à la collectivité des sentiments et des actes impossibles à l'individu isolé. Dans les foules, l'imbécile, l'ignorant et l'envieux sont libérés du sentiment de leur nullité et de leur impuissance, que remplace la notion d'une force brutale, passagère, mais immense. [...] La foule n'étant impressionnée que par des sentiments excessifs, l'orateur qui veut la séduire doit abuser des affirmations violentes. Exagérer, affirmer, répéter, et ne jamais tenter de rien démontrer par un raisonnement, sont les procédés d'argumentation familiers aux orateurs des réunions populaires. La foule réclame encore la même exagération dans les sentiments de ses héros. Leurs qualités et leurs vertus apparentes doivent toujours être amplifiées. Au théâtre, la foule exige du héros de la pièce des vertus, un courage, une moralité, qui ne sont jamais pratiqués dans la vie. [...]. |
|||||
|
LIVRE 1 - Chapitre 3 [...] Quelles que soient les idées suggérées aux foules, elles ne peuvent devenir dominantes qu'à la condition de revêtir une forme très simple et d'être représentées dans leur esprit sous l'aspect d'images. Aucun lien logique d'analogie ou de succession ne rattachant entre elles ces idées-images, elles peuvent se substituer l'une à l'autre comme les verres de la lanterne magique que l'opérateur retire de la boîte où ils étaient superposés. On peut donc voir dans les foules se succéder les idées les plus contradictoires. Suivant les hasards du moment, la foule sera placée sous l'influence de l'une des idées diverses emmagasinées dans son entendement, et commettra par conséquent les actes les plus dissemblables. Son absence complète d'esprit critique ne lui permet pas d'en percevoir les contradictions. [...] Les idées n'étant accessibles aux foules qu'après avoir revêtu une forme très simple, doivent, pour devenir populaires, subir souvent les plus complètes transformations. Quand il s'agit d'idées philosophiques ou scientifiques un peu élevées, on peut constater la profondeur des modifications qui leur sont nécessaires pour descendre de couche en couche jusqu'au niveau des foules. [...] Par le fait seul qu'une idée parvient aux foules et peut les émouvoir, elle est dépouillée de presque tout ce qui faisait son élévation et sa grandeur. La valeur hiérarchique d'une idée est d'ailleurs sans importance. Seuls sont à considérer les effets qu'elle produit. Les idées chrétiennes du Moyen Âge, les idées démocratiques du siècle dernier, les idées sociales d'aujourd'hui ne sont certes pas très élevées. On peut philosophiquement les considérer comme d'assez pauvres erreurs. Cependant leur rôle a été et sera immense, et elles compteront longtemps parmi les plus essentiels facteurs de la conduite des États. Alors même que l'idée a subi des modifications qui la rendent accessible aux foules, elle n'agit que quand, par des procédés divers qui seront étudiés ailleurs, elle pénètre dans l'inconscient et devient un sentiment. Cette transformation est généralement fort longue. Il ne faut pas croire du reste que c'est parce que la justesse d'une idée est démontrée qu'elle peut produire ses effets, même chez les esprits cultivés. On s'en rend compte en voyant combien la démonstration la plus claire a peu d'influence sur la majorité des hommes. L'évidence éclatante pourra être reconnue par un auditeur instruit ; mais il sera vite ramené par son inconscience à ses conceptions primitives. Revoyez-le au bout de quelques jours, et il vous servira de nouveau ses anciens arguments, exactement dans les mêmes termes. Il est, en effet, sous l'influence d'idées antérieures devenues des sentiments ; or celles-là seules agissent sur les mobiles profonds de nos actes et de nos discours. Lorsque, par des procédés divers, une idée a fini par s'incruster dans l'âme des foules, elle acquiert une puissance irrésistible et déroule toute une série de conséquences. Les idées philosophiques qui aboutirent à la Révolution française mirent longtemps à s'implanter dans l'âme populaire. On sait leur irrésistible force lorsqu'elles y furent établies. L'élan d'un peuple entier vers la conquête de l'égalité sociale, vers la réalisation de droits abstraits et de libertés idéales fit chanceler tous les trônes et bouleversa profondément le monde occidental. Pendant vingt ans, les peuples se précipitèrent les uns sur les autres, et l'Europe connut des hécatombes comparables à celles de Gengiskhan et de Tamerlan. Jamais n'apparut aussi clairement ce que peut produire le déchaînement d'idées capables de changer l'orientation des sentiments. [...] |
|||||
|
LIVRE 1 - Chapitre 4 [...] En examinant de près les convictions des foules, aussi bien aux époques de foi que dans les grands soulèvements politiques, comme ceux du dernier siècle, on constate qu'elles présentent toujours une forme spéciale, que je ne puis mieux déterminer qu'en lui donnant le nom de sentiment religieux. Ce sentiment a des caractéristiques très simples : adoration d'un être supposé supérieur, crainte de la puissance qu'on lui attribue, soumission aveugle à ses commandements, impossibilité de discuter ses dogmes, désir de les répandre, tendance à considérer comme ennemis tous ceux qui refusent de les admettre. Qu'un tel sentiment s'applique à un Dieu invisible, à une idole de pierre, à un héros ou à une idée politique, il reste toujours d'essence religieuse. Le surnaturel et le miraculeux s'y retrouvent également. Les foules revêtent d'une même puissance mystérieuse la formule politique ou le chef victorieux qui les fanatise momentanément. On n'est pas religieux seulement quand on adore une divinité, mais quand on met toutes les ressources de son esprit, toutes les soumissions de sa volonté, toutes les ardeurs du fanatisme au service d'une cause ou d'un être devenu le but et le guide des sentiments et des actions. L'intolérance et le fanatisme constituent l'accompagnement ordinaire d'un sentiment religieux. Ils sont inévitables chez ceux qui croient posséder le secret du bonheur terrestre ou éternel. Ces deux traits se retrouvent dans tous les hommes en groupe lorsqu'une conviction quelconque les soulève. Les Jacobins de la Terreur étaient aussi foncièrement religieux que les catholiques de l'Inquisition, et leur cruelle ardeur dérivait de la même source. [...] Aujourd'hui la plupart des grands conquérants d'âmes ne possèdent plus d'autels, mais ils ont des statues ou des images, et le culte qu'on leur rend n'est pas notablement différent de celui de jadis. On n'arrive à comprendre un peu la philosophie de l'histoire qu'après avoir bien pénétré ce point fondamental de la psychologie des foules : il faut être Dieu pour elles ou ne rien être. Ce ne sont pas là des superstitions d'un autre âge chassées définitivement par la raison. Dans sa lutte éternelle contre la raison, le sentiment n'a jamais été vaincu. Les foules ne veulent plus entendre les mots de divinité et de religion qui les ont si longtemps dominées ; mais aucune époque ne les vit élever autant de statues et d'autels que depuis un siècle. [...] [...] Aussi est-ce une bien inutile banalité de répéter qu'il faut une religion aux foules. Les croyances politiques, divines et sociales ne s'établissent chez elles qu'à la condition de revêtir toujours la forme religieuse, qui les met à l'abri de la discussion. L'athéisme, s'il était possible de le faire accepter aux foules, aurait toute l'ardeur intolérante d'un sentiment religieux, et, dans ses formes extérieures, deviendrait rapidement un culte. L'évolution de la petite secte positiviste nous en fournit une preuve curieuse. Elle ressemble à ce nihiliste, dont le profond Dostoïevski nous rapporte l'histoire. Éclairé un jour par les lumières de la raison, il brisa les images des divinités et des saints qui ornaient l'autel de sa petite chapelle, éteignit les cierges, et, sans perdre un instant, remplaça les images détruites par les ouvrages de quelques philosophes athées, puis ralluma pieusement les cierges. L'objet de ses croyances religieuses s'était transformé, mais ses sentiments religieux, peut-on dire vraiment qu'ils avaient changé ? [...] |
|||||
|
LIVRE 2 - Chapitre 1 5. L'instruction et l'éducation Au premier rang des idées dominantes de notre époque se trouve aujourd'hui celle-ci : l'instruction a pour résultat certain d'améliorer les hommes et même de les rendre égaux. Par le fait seul de la répétition, cette assertion a fini par devenir un des dogmes les plus inébranlables de la démocratie. Il serait aussi difficile d'y toucher maintenant qu'il l'eût été jadis de toucher à ceux de l'Église. Mais sur ce point comme sur bien d'autres, les idées démocratiques se trouvent en profond désaccord avec les données de la psychologie et de l'expérience. Plusieurs philosophes éminents, Herbert Spencer notamment, eurent peu de peine à montrer que l'instruction ne rend l'homme ni plus moral ni plus heureux, qu'elle ne change pas ses instincts et ses passions héréditaires et peut, mal dirigée, devenir beaucoup plus pernicieuse qu'utile. Les statisticiens sont venus confirmer ces vues en nous disant que la criminalité augmente avec la généralisation de l'instruction, ou tout au moins d'une certaine instruction ; que les pires ennemis de la société, les anarchistes, se recrutent souvent parmi les lauréats des écoles. Un magistrat distingué, M. Adolphe Guillot, faisait remarquer qu'on compte actuellement trois mille criminels lettrés contre mille illettrés, et que, en cinquante ans, la criminalité est passée de deux cent vingt-sept pour cent mille habitants à cinq cent cinquante-deux, soit une augmentation de 133 %. Il a noté aussi avec ses collègues que la criminalité progresse principalement chez les jeunes gens pour lesquels l'école gratuite a remplacé le patronat. Personne, certes, n'a jamais soutenu que l'instruction bien dirigée ne puisse donner des résultats pratiques fort utiles, sinon pour élever la moralité, au moins pour développer les capacités professionnelles. Malheureusement les peuples latins, surtout depuis une trentaine d'années, ont basé leur système d'instruction sur des principes très défectueux, et, malgré les observations d'esprits éminents, ils persistent dans leurs lamentables erreurs. J'ai moi-même, en divers ouvrages (Psychologie du socialisme et Psychologie de l'éducation), montré que notre éducation actuelle transforme en ennemis de la société un grand nombre de ceux qui l'ont reçue, et recrute beaucoup de disciples pour les pires formes du socialisme. Le premier danger de cette éducation — très justement qualifiée de latine — est de reposer sur une erreur psychologique fondamentale : s'imaginer que la récitation des manuels développe l'intelligence. Dès lors, on tâche d'en apprendre le plus possible ; et, de l'école primaire au doctorat ou à l'agrégation, le jeune homme ne fait qu'ingurgiter le contenu des livres, sans exercer jamais son jugement et son initiative. L'instruction, pour lui, consiste à réciter et à obéir. « Apprendre des leçons, savoir par cœur une grammaire ou un abrégé, bien répéter, bien imiter, voilà, écrivait un ancien ministre de l'Instruction publique, M. Jules Simon, une plaisante éducation où tout effort est un acte de foi devant l'infaillibilité du maître, et n'aboutit qu'à nous diminuer et nous rendre impuissants. » Si cette éducation n'était qu'inutile, on pourrait se borner à plaindre les malheureux enfants auxquels, à la place de tant de choses nécessaires, on préfère enseigner la généalogie des fils de Clotaire, les luttes de la Neustrie et de l'Austrasie, ou des classifications zoologiques ; mais elle présente le danger beaucoup plus sérieux d'inspirer à celui qui l'a reçue un dégoût violent de la condition où il est né, et l'intense désir d'en sortir. L'ouvrier ne veut plus rester ouvrier, le paysan ne veut plus être paysan, et le dernier des bourgeois ne voit pour ses fils d'autre carrière possible que les fonctions salariées par l'État. Au lieu de préparer des hommes pour la vie, l'école ne les prépare qu'à des fonctions publiques où la réussite n'exige aucune lueur d'initiative. En bas de l'échelle sociale, elle crée ces armées de prolétaires mécontents de leur sort et toujours prêts à la révolte ; en haut, notre bourgeoisie frivole, à la fois sceptique et crédule, imprégnée d'une confiance superstitieuse dans l'État providence, que cependant elle fronde sans cesse, inculpant toujours le gouvernement de ses propres fautes et incapable de rien entreprendre sans l'intervention de l'autorité. L'État, qui fabrique à coups de manuels tous ces diplômés, ne peut en utiliser qu'un petit nombre et laisse forcément les autres sans emploi. Il lui faut donc se résigner à nourrir les premiers et à avoir pour ennemis les seconds. Du haut en bas de la pyramide sociale, la masse formidable des diplômés assiège aujourd'hui les carrières. Un négociant peut très difficilement trouver un agent pour aller le représenter dans les colonies, mais c'est par des milliers de candidats que les plus modestes places officielles sont sollicitées. Le département de la Seine compte à lui seul vingt mille instituteurs et institutrices sans emploi, et qui, méprisant les champs et l'atelier, s'adressent à l'État pour vivre. Le nombre des élus étant restreint, celui des mécontents est forcément immense. Ces derniers sont prêts pour toutes les révolutions, quels qu'en soient les chefs et le but poursuivi. L'acquisition de connaissances inutilisables est un moyen sûr de transformer l'homme en révolté [4]. Il est évidemment trop tard pour remonter un tel courant. Seule l'expérience, dernière éducatrice des peuples, se chargera de nous dévoiler notre erreur. Seule elle saura prouver la nécessité de remplacer nos odieux manuels, nos pitoyables concours par une instruction professionnelle capable de ramener la jeunesse vers les champs, les ateliers, les entreprises coloniales, aujourd'hui délaissés. Cette instruction professionnelle réclamée maintenant par tous les esprits éclairés fut celle que reçurent jadis nos pères, et que les peuples actuellement dominateurs du monde par leur volonté, leur initiative, leur esprit d'entreprise, ont su conserver. Dans des pages remarquables, dont je produirai plus loin les passages essentiels, Taine a montré nettement que notre éducation d'autrefois était à peu près ce qu'est aujourd'hui l'éducation anglaise ou américaine, et, dans un remarquable parallèle entre le système latin et le système anglo-saxon, il fait voir clairement les conséquences des deux méthodes. Peut-être pourrait-on accepter tous les inconvénients de notre éducation classique, alors même qu'elle ne ferait que des déclassés et des mécontents, si l'acquisition superficielle de tant de connaissances, la récitation parfaite de tant de manuels élevaient le niveau de l'intelligence. Mais atteint-elle réellement ce résultat ? Non, hélas ! Le jugement, l'expérience, l'initiative, le caractère sont les conditions de succès dans la vie, et ce n'est pas dans les livres qu'on les apprend. Les livres sont des dictionnaires utiles à consulter, mais dont il est parfaitement superflu d'emmagasiner dans la tête de longs fragments. Comment l'instruction professionnelle peut-elle développer l'intelligence dans une mesure qui échappe tout à fait à l'instruction classique, Taine l'a fort bien montré dans les lignes suivantes : Les idées ne se forment que dans leur milieu naturel et normal ; ce qui fait végéter leur germe, ce sont les innombrables impressions sensibles que le jeune homme reçoit tous les jours à l'atelier, dans la mine, au tribunal, à l'étude, sur le chantier, à l'hôpital, au spectacle des outils, des matériaux et des opérations, en présence des clients, des ouvriers, du travail, de l'ouvrage bien ou mal fait, dispendieux ou lucratif : voilà les petites perceptions particulières des yeux, de l'oreille, des mains et même de l'odorat, qui, involontairement recueillies et sourdement élaborées, s'organisent en lui pour lui suggérer tôt ou tard telle combinaison nouvelle, simplification, économie, perfectionnement ou invention. De tous ces contacts précieux, de tous ces éléments assimilables et indispensables, le jeune Français est privé, et justement pendant l'âge fécond : sept ou huit années durant, il est séquestré dans une école, loin de l'expérience directe et personnelle qui lui aurait donné la notion exacte et vive des choses, des hommes et des diverses façons de les manier. [...] Au moins neuf sur dix ont perdu leur temps et leur peine, plusieurs années de leur vie, et des années efficaces, importantes ou même décisives : comptez d'abord la moitié ou les deux tiers de ceux qui se présentent à l'examen, je veux dire les refusés ; ensuite, parmi les admis, gradés, brevetés et diplômés, encore la moitié ou les deux tiers, je veux dire les surmenés. On leur a demandé trop en exigeant que tel jour, sur une chaise ou devant un tableau, ils fussent, deux heures durant et pour un groupe de sciences, des répertoires vivants de toute la connaissance humaine ; en effet, ils ont été cela, ou à peu près, ce jour-là, pendant deux heures ; mais, un mois plus tard, ils ne le sont plus ; ils ne pourraient pas subir de nouveau l'examen ; leurs acquisitions, trop nombreuses et trop lourdes, glissent incessamment hors de leur esprit, et ils n'en font pas de nouvelles. Leur vigueur mentale a fléchi ; la sève féconde est tarie ; l'homme fait apparaît, et, souvent c'est l'homme fini. Celui-ci, rangé, marié, résigné à tourner en cercle et indéfiniment dans le même cercle, se cantonne dans son office restreint ; il le remplit correctement, rien au-delà. Tel est le rendement moyen ; certainement la recette n'équilibre pas la dépense. En Angleterre et en Amérique, où, comme jadis avant 1789 en France, on emploie le procédé inverse, le rendement obtenu est égal ou supérieur. L'illustre historien nous montre ensuite la différence de notre système avec celui des Anglo-Saxons. Chez eux, l'enseignement ne provient pas du livre, mais de la chose elle-même. L'ingénieur, par exemple, se formant dans un atelier et jamais dans une école, chacun peut arriver exactement au degré que comporte son intelligence, ouvrier ou contremaître s'il est incapable d'aller plus loin, ingénieur si ses aptitudes le permettent. C'est là un procédé autrement démocratique et utile pour la société que de faire dépendre toute la carrière d'un individu d'un concours de quelques heures subi à dix-huit ou vingt ans. À l'hôpital, dans la mine, dans la manufacture, chez l'architecte, chez l'homme de loi, l'élève, admis très jeune, fait son apprentissage, et son stage, à peu près comme chez nous un clerc dans son étude ou un rapin dans son atelier. Au préalable et avant d'entrer, il a pu suivre quelque cours général et sommaire, afin d'avoir un cadre tout prêt pour y loger les observations que tout à l'heure il va faire. Cependant, à sa portée, il y a, le plus souvent, quelques cours techniques qu'il pourra suivre à ses heures libres, afin de coordonner au fur et à mesure les expériences quotidiennes qu'il fait. Sous un pareil régime, la capacité pratique croît et se développe d'elle-même, juste au degré que comportent les facultés de l'élève, et dans la direction requise par sa besogne future par l'œuvre spéciale à laquelle dès à présent il veut s'adapter. De cette façon, en Angleterre et aux États-Unis, le jeune homme parvient vite à tirer de lui-même tout ce qu'il contient. Dès vingt-cinq ans, et bien plus tôt, si la substance et le fonds ne lui manquent pas, il est, non seulement un exécutant utile, mais encore un entrepreneur spontané, non seulement un rouage, mais de plus un moteur. — En France, où le procédé inverse a prévalu et, à chaque génération, devient plus chinois, le total des forces perdues est énorme. Et le grand philosophe arrive à la conclusion suivante sur la disconvenance croissante de notre éducation latine et de la vie : Aux trois étages de l'instruction, pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, la préparation théorique et scolaire sur des bancs, par des livres, s'est prolongée et surchargée, en vue de l'examen, du grade, du diplôme et du brevet, en vue de cela seulement, et par les pires moyens, par l'application d'un régime antinaturel et antisocial, par le retard excessif de l'apprentissage pratique, par l'internat, par l'entraînement artificiel et le remplissage mécanique, par le surmenage, sans considération du temps qui suivra, de l'âge adulte et des offices virils que l'homme fait exercera, abstraction faite du monde réel où tout à l'heure le jeune homme va tomber, de la société ambiante à laquelle il faut l'adapter ou le résigner d'avance, du conflit humain où pour se défendre et se tenir debout, il doit être, au préalable, équipé, armé, exercé, endurci. Cet équipement indispensable, cette acquisition plus importante que toutes les autres, cette solidité du bon sens de la volonté et des nerfs, nos écoles ne la lui procurent pas ; tout au rebours ; bien loin de le qualifier, elles le disqualifient pour sa condition prochaine et définitive. Partant, son entrée dans le monde et ses premiers pas dans le champ de l'action pratique ne sont, le plus souvent, qu'une suite de chutes douloureuses ; il en reste meurtri, et, pour longtemps, froissé, parfois estropié à demeure. C'est une rude et dangereuse épreuve ; l'équilibre moral et mental s'y altère, et court le risque de ne pas se rétablir ; la désillusion est venue, trop brusque et trop complète ; les déceptions ont été trop grandes et les déboires trop forts [5]. Nous sommes-nous éloignés, dans ce qui précède, de la psychologie des foules ? Non, certes. Pour comprendre les idées, les croyances qui y germent aujourd'hui et écloront demain, il faut savoir comment le terrain a été préparé. L'enseignement donné à la jeunesse d'un pays permet de prévoir un peu les destinées de ce pays. L'éducation de la génération actuelle justifie les prévisions les plus sombres. C'est en partie avec l'instruction et l'éducation que s'améliore ou s'altère l'âme des foules. Il était donc nécessaire de montrer comment le système actuel l'a façonnée, et comment la masse des indifférents et des neutres est devenue progressivement une immense armée de mécontents, prête à suivre toutes les suggestions des utopistes et des rhéteurs. L'école forme aujourd'hui des mécontents et des anarchistes et prépare pour les peuples latins les heures de décadence. |
|||||
|
LIVRE 2 - Chapitre 2 [...] [...] Les foules sont un peu comme le sphinx de la fable antique : il faut savoir résoudre les problèmes que leur psychologie nous pose, ou se résigner à être dévoré par elles. 1. Les images, les mots et les formules [...] Avec un petit stock de formules et de lieux communs appris dans la jeunesse, nous possédons tout ce qu'il faut pour traverser la vie sans la fatigante nécessité d'avoir à réfléchir. Si l'on considère une langue déterminée, on voit que les mots dont elle se compose se modifient assez lentement dans le cours des âges ; mais sans cesse changent les images qu'ils évoquent ou le sens qu'on y attache. Et c'est pourquoi je suis arrivé, dans un autre ouvrage, à cette conclusion que la traduction exacte d'une langue, surtout quand il s'agit de peuples morts, est totalement impossible. Que faisons-nous, en réalité, en substituant un terme français à un terme latin, grec ou sanscrit, ou même quand nous cherchons à comprendre un livre écrit dans notre propre langue il y a quelques siècles ? Nous substituons simplement les images et les idées que la vie moderne a suscitées dans notre intelligence aux notions et aux images absolument différentes que la vie ancienne avait fait naître dans l'âme de races soumises à des conditions d'existence sans analogie avec les nôtres. Les hommes de la Révolution, s'imaginant copier les Grecs et les Romains, ne faisaient que donner à des mots anciens un sens qu'ils n'eurent jamais. Quelle ressemblance pouvait exister entre les institutions des Grecs et celles que désignent de nos jours les mots correspondants ? Qu'était alors une république, sinon une institution essentiellement aristocratique formée d'une réunion de petits despotes dominant une foule d'esclaves maintenus dans la plus absolue sujétion ? Ces aristocraties communales, basées sur l'esclavage, n'auraient pu exister un instant sans lui. Et le mot liberté, que pouvait-il signifier de semblable à ce que nous comprenons aujourd'hui, à une époque où la liberté de penser n'était même pas soupçonnée, et où il n'y avait pas de forfait plus grand et d'ailleurs plus rare que de discuter les dieux, les lois et les coutumes de la cité ? Le mot patrie, dans l'âme d'un Athénien ou d'un Spartiate, signifiait le culte d'Athènes ou de Sparte, et nullement celui de Grèce, composée de cités rivales et toujours en guerre. Le même mot de patrie, quel sens avait-il chez les anciens Gaulois divisés en tribus rivales, de races, de langues et de religions différentes, que vainquit si facilement César parce qu'il eut toujours parmi elles des alliées ? Rome seule dota la Gaule d'une patrie en lui donnant l'unité politique et religieuse. [...] Nombreux sont les mots dont le sens a ainsi profondément changé d'âge en âge. Nous ne pouvons arriver à les comprendre comme ils l'étaient jadis qu'après un long effort. Beaucoup de lecture est nécessaire, on l'a dit avec raison, pour arriver seulement à concevoir ce que signifiaient aux yeux de nos arrière-grands-pères des mots tels que le roi et la famille royale. Qu'est-ce alors pour des termes plus complexes ? Les mots n'ont donc que des significations mobiles et transitoires, changeantes d'âge en âge et de peuple à peuple. Quand nous voulons agir par eux sur la foule, il faut savoir le sens qu'ils ont pour elle à un moment donné, et non celui qu'ils eurent jadis ou peuvent avoir pour des individus de constitution mentale différente. Les mots vivent comme les idées. Aussi, quand les foules, à la suite de bouleversements politiques, de changements de croyances, finissent par professer une antipathie profonde pour les images évoquées par certains mots, le premier devoir du véritable homme d'État est de changer ces mots sans, bien entendu, toucher aux choses en elles-mêmes. [...] Le judicieux Tocqueville fait remarquer que le travail du Consulat et de l'Empire consista surtout à habiller de mots nouveaux la plupart des institutions du passé, à remplacer par conséquent des mots évoquant de fâcheuses images dans l'imagination par d'autres dont la nouveauté empêchait de pareilles évocations. La taille est devenue contribution foncière ; la gabelle, l'impôt du sel ; les aides, contributions indirectes et droit réunis ; la taxe des maîtrises et jurandes s'est appelée patente, etc. Une des fonctions les plus essentielles des hommes d'État consiste donc à baptiser de mots populaires, ou au moins neutres, les choses détestées des foules sous leurs anciens noms. La puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses. [...] Art difficile car, dans une même société, les mêmes mots ont le plus souvent des sens différents pour les diverses couches sociales. Elles emploient en apparence les mêmes mots ; mais ne parlent pas la même langue. Dans les exemples qui précèdent, nous avons fait intervenir le temps comme principal facteur du changement de sens des mots. Si nous faisions intervenir aussi la race, nous verrions alors qu'à une même époque, chez des peuples également civilisés mais de races diverses, les mots identiques correspondent fort souvent à des idées extrêmement dissemblables. Ces différences ne peuvent se comprendre sans de nombreux voyages, je ne saurais donc insister sur elles, me bornant à faire remarquer que ce sont précisément les mots les plus employés qui, d'un peuple à l'autre, possèdent les sens les plus différents. Tels, par exemple, les mots démocratie et socialisme, d'un usage si fréquent aujourd'hui. Ils correspondent, en réalité, à des idées et des images complètement opposées dans les âmes latines et dans les âmes anglo-saxonnes. Chez les Latins, le mot démocratie signifie surtout effacement de la volonté et de l'initiative de l'individu devant celles de l'État. Ce dernier est chargé de plus en plus de diriger, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer. C'est à lui que tous les partis sans exception, radicaux, socialistes ou monarchistes, font constamment appel. Chez l'Anglo-Saxon, celui d'Amérique notamment, le même mot démocratie signifie au contraire développement intense de la volonté et de l'individu, effacement de l'État, auquel, en dehors de la police, de l'armée et des relations diplomatiques, on ne laisse rien diriger, pas même l'instruction. Le même mot possède donc chez ces deux peuples des sens absolument contraires. [...] Avec tous ses progrès, la philosophie n'a pu encore offrir aux peuples aucun idéal capable de les charmer. Les illusions leur étant indispensables, ils se dirigent d'instinct, comme l'insecte allant à la lumière, vers les rhéteurs qui leur en présentent. Le grand facteur de l'évolution des peuples n'a jamais été la vérité, mais l'erreur. [...] Les foules n'ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l'erreur, si l'erreur les séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître ; qui tente de les désillusionner est toujours leur victime. [...] Les expériences faites par une génération sont généralement inutiles pour la suivante : et c'est pourquoi les événements historiques invoqués comme éléments de démonstration ne sauraient servir. Leur seule utilité est de prouver à quel point les expériences doivent être répétées d'âge en âge pour exercer quelque influence, et réussir à ébranler une erreur solidement implantée. Notre siècle, et celui qui l'a précédé, seront cités sans doute par les historiens de l'avenir comme une ère de curieuses expériences. À aucun âge, il n'en avait été tenté autant. La plus gigantesque fut la Révolution française. Pour découvrir qu'on ne refait pas une société de toutes pièces sur les indications de la raison pure, il fallut massacrer plusieurs millions d'hommes et bouleverser l'Europe entière pendant vingt ans. Pour prouver expérimentalement que les Césars coûtent cher aux peuples qui les acclament, deux ruineuses expériences furent nécessaires pendant cinquante ans, et malgré leur clarté, elles ne semblent pas avoir été suffisamment convaincantes. La première coûta pourtant trois millions d'hommes et une invasion, la seconde un démembrement et la nécessité des armées permanentes. Une troisième faillit être tentée voici quelques années et le sera sûrement encore. Pour faire admettre que l'immense armée allemande n'était pas, comme on l'enseignait avant 1870, une sorte de garde nationale inoffensive, il a fallu l'effroyable guerre qui nous a coûté si cher. Pour reconnaître que le protectionnisme ruine finalement les peuples qui l'acceptent, de désastreuses expériences seront nécessaires. On pourrait multiplier indéfiniment ces exemples. Dans l'énumération des facteurs capables d'impressionner l'âme des foules, nous pourrions nous dispenser de mentionner la raison, s'il n'était nécessaire d'indiquer la valeur négative de son influence. Nous avons déjà montré que les foules ne sont pas influençables par des raisonnements et ne comprennent que de grossières associations d'idées. Aussi est-ce à leurs sentiments et jamais à leur raison que font appel les orateurs qui savent les impressionner. Les lois de la logique rationnelle n'ont aucune action sur elles. Pour vaincre les foules, il faut d'abord se rendre bien compte des sentiments dont elles sont animées, feindre de les partager, puis tenter de les modifier, en provoquant au moyen d'associations rudimentaires certaines images suggestives ; savoir revenir au besoin sur ses pas, deviner surtout à chaque instant les sentiments qu'on fait naître. Cette nécessité de varier son langage suivant l'effet produit au moment où l'on parle frappe d'avance d'impuissance tout discours étudié et préparé. L'orateur suivant sa pensée et non celle de ses auditeurs perd par ce seul fait toute influence. Les esprits logiques, habitués aux chaînes de raisonnement un peu serrées, ne peuvent s'empêcher d'avoir recours à ce mode de persuasion quand ils s'adressent aux foules, et le manque d'effet de leurs arguments les surprend toujours. « Les conséquences mathématiques usuelles fondées sur le syllogisme, c'est-à-dire sur des associations d'identités, écrit un logicien, sont nécessaires. [...] La nécessité forcerait l'assentiment même d'une masse inorganique si celle-ci était capable de suivre des associations d'identités. » Sans doute ; mais la foule n'est pas plus apte que la masse inorganique à les suivre, ni même à les entendre. Essayez de convaincre par un raisonnement des esprits primitifs, sauvages ou enfants, par exemple, et vous vous rendrez compte de la faible valeur que possède ce mode d'argumentation. |
|||||
|
LIVRE 2 - Chapitre 3 La constitution mentale des foules nous est maintenant connue, et nous savons aussi quels mobiles impressionnent leur âme. Il nous reste à rechercher comment doivent être appliqués ces mobiles, et par qui ils peuvent être utilement mis en œuvre. Dès qu'un certain nombre d'êtres vivants sont réunis, qu'il s'agisse d'un troupeau d'animaux ou d'une foule d'hommes, ils se placent d'instinct sous l'autorité d'un chef, c'est-à-dire d'un meneur. Dans les foules humaines, le meneur joue un rôle considérable. Sa volonté est le noyau autour duquel se forment et s'identifient les opinions. La foule est un troupeau qui ne saurait se passer de maître. Le meneur a d'abord été le plus souvent un mené hypnotisé par l'idée dont il est ensuite devenu l'apôtre. Elle l'a envahi au point que tout disparaît en dehors d'elle, et que toute opinion contraire lui paraît erreur et superstition. Tel Robespierre, hypnotisé par ses chimériques idées, et employant les procédés de l'Inquisition pour les propager. Les meneurs ne sont pas, le plus souvent, des hommes de pensée mais d'action. Ils sont peu clairvoyants et ne pourraient l'être, la clairvoyance conduisant généralement au doute et à l'inaction. Ils se recrutent surtout parmi ces névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords de la folie. Si absurde que soit l'idée qu'ils défendent ou le but qu'ils poursuivent, tout raisonnement s'émousse contre leur conviction. Le mépris et les persécutions ne font que les exciter davantage. Intérêt personnel, famille, tout est sacrifié. L'instinct de la conservation lui-même s'annule chez eux, au point que la seule récompense qu'ils sollicitent souvent est le martyre. L'intensité de la foi confère à leurs paroles une grande puissance suggestive. La multitude écoute toujours l'homme doué de volonté forte. Les individus réunis en foule perdant toute volonté se tournent d'instinct vers qui en possède une. [...] L'influence qu'ils exercent ainsi reste toujours éphémère. Les grands convaincus qui soulèvent l'âme des foules, les Pierre l'Ermite, les Luther, les Savonarole, les hommes de la Révolution, n'ont exercé de fascination qu'après avoir été d'abord subjugués eux-mêmes par une croyance. Ils purent alors créer dans les âmes cette puissance formidable nommée la foi, qui rend l'homme esclave absolu de son rêve. Créer la foi, qu'il s'agisse de foi religieuse, politique ou sociale, de foi en une œuvre, en une personne, en une idée, tel est surtout le rôle des grands meneurs. De toutes les forces dont l'humanité dispose, la foi a toujours été une des plus considérables, et c'est avec raison que l'Évangile lui attribue le pouvoir de soulever les montagnes. Doter l'homme d'une foi, c'est décupler sa force. Les grands événements de l'histoire furent souvent réalisés par d'obscurs croyants n'ayant que leur foi pour eux. Ce n'est pas avec des lettrés et des philosophes, ni surtout avec des sceptiques, qu'ont été édifiées les religions qui ont gouverné le monde, et les vastes empires étendus d'un hémisphère à l'autre. [...] [...] Pendant une grève des employés d'omnibus à Paris, il a suffi d'arrêter les deux meneurs qui la dirigeaient pour la faire aussitôt cesser. Ce n'est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours l'âme des foules. Leur soif d'obéissance les fait se soumettre d'instinct à qui se déclare leur maître. 2. Les moyens d'action des meneurs : l'affirmation, la répétition, la contagion Lorsqu'il s'agit d'entraîner une foule pour un instant et de la déterminer à commettre un acte quelconque : piller un palais, se faire massacrer pour défendre une barricade, il faut agir sur elle par des suggestions rapides. La plus énergique est encore l'exemple. Il est alors nécessaire que la foule soit déjà préparée par certaines circonstances, et que celui qui veut l'entraîner possède la qualité que j'étudierai plus loin sous le nom de prestige. Quand il s'agit de faire pénétrer lentement des idées et des croyances dans l'esprit des foules — les théories sociales modernes, par exemple —, les méthodes des meneurs sont différentes. Ils ont principalement recours aux trois procédés suivants : l'affirmation, la répétition, la contagion. L'action en est assez lente, mais les effets durables. L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un sûr moyen de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Plus l'affirmation est concise, dépourvue de preuves et de démonstration, plus elle a d'autorité. Les livres religieux et les codes de tous les âges ont toujours procédé par simple affirmation. Les hommes d'État appelés à défendre une cause politique quelconque, les industriels propageant leurs produits par l'annonce, connaissent la valeur de l'affirmation. Cette dernière n'acquiert cependant d'influence réelle qu'à la condition d'être constamment répétée, et le plus possible, dans les mêmes termes. Napoléon disait qu'il n'existe qu'une seule figure sérieuse de rhétorique, la répétition. La chose affirmée arrive, par la répétition, à s'établir dans les esprits au point d'être acceptée comme une vérité démontrée. [...] Au bout de quelque temps, oubliant quel est l'auteur de l'assertion répétée, nous finissons par y croire. [...] [...] Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes. [...] La contagion n'exige pas la présence simultanée d'individus sur un seul point ; elle peut se faire à distance sous l'influence de certains événements orientant les esprits dans le même sens et leur donnant les caractères spéciaux aux foules, surtout quand ils sont préparés par les facteurs lointains que j'ai étudiés plus haut. Ainsi, par exemple, l'explosion révolutionnaire de 1848, partie de Paris, s'étendit brusquement à une grande partie de l'Europe et ébranla plusieurs monarchies. L'imitation, à laquelle on attribue tant d'influence dans les phénomènes sociaux, n'est en réalité qu'un simple effet de la contagion. Ayant montré ailleurs son rôle, je me bornerai à reproduire ce que j'en disais il y a longtemps et qui, depuis, a été développé par d'autres écrivains : « Semblable aux animaux, l'homme est naturellement imitatif. L'imitation constitue un besoin pour lui, à condition, bien entendu, que cette imitation soit facile, c'est de ce besoin que naît l'influence de la mode. Qu'il s'agisse d'opinions, d'idées, de manifestations littéraires, ou simplement de costumes, combien osent se soustraire à son empire ? Avec des modèles, on guide les foules, non pas avec des arguments. À chaque époque, un petit nombre d'individualités impriment leur action que la masse inconsciente imite. Ces individualités ne doivent pas cependant s'écarter beaucoup des idées reçues. Les imiter deviendrait alors trop difficile et leur influence serait nulle. C'est précisément pour cette raison que les hommes trop supérieurs à leur époque n'ont généralement aucune influence sur elle. L'écart est trop grand. C'est pour la même raison encore que les Européens, avec tous les avantages de leur civilisation, exercent une influence insignifiante sur les peuples de l'Orient. « La double action du passé et de l'imitation réciproque finit par rendre tous les hommes d'un même pays et d'une même époque à ce point semblables, que même chez ceux qui sembleraient devoir le plus s'y soustraire, philosophes, savants et littérateurs, la pensée et le style ont un air de famille qui fait immédiatement reconnaître le temps auquel ils appartiennent. Un instant de conversation avec un individu quelconque suffit pour connaître à fond ses lectures, ses occupations habituelles et le milieu où il vit. [6] » La contagion est assez puissante pour imposer aux hommes non seulement certaines opinions mais encore certaines façons de sentir. C'est elle qui fait mépriser à une époque telle œuvre, le Tannhduser par exemple, et qui, quelques années plus tard, la fait admirer par ceux-là même qui l'avaient le plus dénigrée. Par le mécanisme de la contagion et très peu par celui du raisonnement se propagent les opinions et les croyances. C'est au cabaret, par affirmation, répétition et contagion que s'établissent les conceptions actuelles des ouvriers. Les croyances des foules de tous les âges ne se sont guère créées autrement. [...] Dans les exemples analogues à ceux que je viens de citer, la contagion, après s'être exercée dans les couches populaires, passe ensuite aux couches supérieures de la société. C'est ainsi que, de nos jours, les doctrines socialistes commencent à gagner ceux qui en seraient pourtant les premières victimes. Devant le mécanisme de la contagion, l'intérêt personnel lui-même s'évanouit. Et c'est pourquoi toute opinion devenue populaire finit par s'imposer aux couches sociales élevées, si visible que puisse être l'absurdité de l'opinion triomphante. Cette réaction des couches sociales inférieures sur les couches supérieures est d'autant plus curieuse que les croyances de la foule dérivent toujours plus ou moins de quelque idée supérieure restée souvent sans influence dans le milieu où elle avait pris naissance. Cette idée supérieure, les meneurs subjugués par elle s'en emparent, la déforment et créent une secte qui la déforme de nouveau, puis la répand de plus en plus déformée dans les foules. Devenue vérité populaire, elle remonte en quelque sorte à sa source et agit alors sur les couches élevées d'une nation. C'est en définitive l'intelligence qui guide le monde, mais elle le guide vraiment de fort loin. Les philosophes créateurs d'idées sont depuis longtemps retournés à la poussière, lorsque, par l'effet du mécanisme que je viens de décrire, leur pensée finit par triompher. Le prestige est en réalité une sorte de fascination qu'exerce sur notre esprit un individu, une œuvre ou une doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme d'étonnement et de respect. Les sentiments alors provoqués sont inexplicables, comme tous les sentiments, mais probablement du même ordre que la suggestion subie par un sujet magnétisé. Le prestige est le plus puissant ressort de toute domination. Les dieux, les rois et les femmes n'auraient jamais régné sans lui. [...] Le Parthénon, dans son état actuel, est une ruine assez dépourvue d'intérêt ; mais il possède un tel prestige qu'on ne le voit plus qu'avec tout son cortège de souvenirs historiques. Le propre du prestige est d'empêcher de voir les choses telles qu'elles sont et de paralyser nos jugements. Les foules toujours, les individus le plus souvent, ont besoin d'opinions toutes faites. Le succès de ces opinions est indépendant de la part de vérité ou d'erreurs qu'elles contiennent ; il réside uniquement dans leur prestige. J'arrive maintenant au prestige personnel. D'une nature fort différente du prestige artificiel ou acquis, il constitue une faculté indépendante de tout titre, de toute autorité. Le petit nombre de personnes qui le possèdent exercent une fascination véritablement magnétique sur ceux qui les entourent, y compris leurs égaux, et on leur obéit comme la bête féroce obéit au dompteur qu'elle pourrait si facilement dévorer. Les grands conducteurs d'hommes, Bouddha, Jésus, Mahomet, Jeanne d'Arc, Napoléon, possédèrent à un haut degré cette forme de prestige. C'est surtout par elle qu'ils se sont imposés. Les dieux, les héros et les dogmes s'imposent et ne se discutent pas : ils s'évanouissent même dès qu'on les discute. [...] |
|||||
|
[1] Gustave Le Bon,
Psychologie des foules,
1895. [2] Gustave Le Bon utilise le terme « race » dans tout son essai pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui la « culture ». (Note F. B.) [3] Savons-nous, pour une seule bataille, comment elle s'est passée exactement ? J'en doute fort. Nous savons quels furent les vainqueurs et les vaincus, mais probablement rien de plus. Ce que M. d'Harcourt, acteur et témoin, rapporte de la bataille de Solférino peut s'appliquer à toutes les batailles : « Les généraux (renseignés naturellement par des centaines de témoignages) transmettent leurs rapports officiels ; les officiers chargés de porter les ordres modifient ces documents et rédigent le projet définitif ; le chef d'état-major le conteste et le refait sur nouveaux frais. On le porte au maréchal, il s'écrie : "Vous vous trompez absolument !" et il substitue une nouvelle rédaction. Il ne reste presque rien du rapport primitif. » M. d'Harcourt relate ce fait comme une preuve de l'impossibilité où l'on est d'établir la vérité sur l'événement le plus saisissant, le mieux observé. [4] 13. Ce n'est pas là d'ailleurs un phénomène spécial aux peuples latins ; on l'observe aussi en Chine, pays conduit également par une solide hiérarchie de mandarins, et où le mandarinat s'obtient aussi par des concours dont la seule épreuve est la récitation imperturbable d'épais manuels. L'armée des lettrés sans emploi est considérée aujourd'hui en Chine comme une véritable calamité nationale. De même dans l'Inde, où, depuis que les Anglais ont ouvert des écoles, non pour éduquer, comme en Angleterre, mais simplement pour instruire les indigènes, il s'est formé une classe spéciale de lettrés, les Babous, qui, lorsqu'ils ne peuvent acquérir une position, deviennent d'irréconciliables ennemis de la puissance anglaise. Chez tous les Babous, munis ou non d'emplois, le premier effet de l'instruction a été d'abaisser immensément le niveau de leur moralité. J'ai longuement insisté sur ce point dans mon livre Les Civilisations de l'Inde. Tous les auteurs qui ont visité la grande péninsule l'ont également constaté. [5] Taine, Le Régime moderne, t. II, 1894. — Ces pages sont à peu près les dernières qu'écrivit Taine. Elles résument admirablement les résultats de sa longue expérience. L'éducation est notre seul moyen d'agir un peu sur l'âme d'un peuple. Il est profondément triste que presque personne en France ne puisse arriver à comprendre quel redoutable élément de décadence constitue notre enseignement actuel. Au lieu d'élever la jeunesse, il l'abaisse et la pervertit. [6] Gustave le Bon, L'Homme et les Sociétés, t. II, 1881, p. 116.
|
|||||