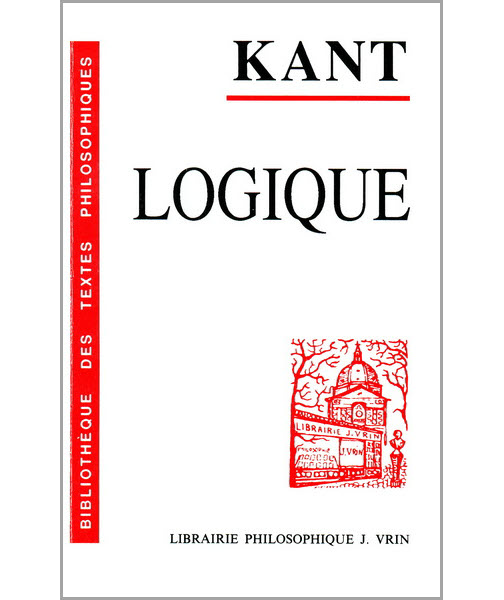1800
Logique [1]
 |
|||||
|
|
|||||
|
1800 |
|||||
|
Logique [1] |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
|
|
p. 9-12 Tout dans la nature, aussi bien dans le monde inanimé que dans celui des vivants, se produit selon des règles, bien que nous ne connaissions pas toujours ces règles. La pluie tombe selon les lois de la pesanteur et chez les animaux, la locomotion se produit aussi selon des règles. Le poisson dans l'eau, l'oiseau dans l'air se meuvent selon des règles. Toute la nature en général n'est strictement rien d'autre qu'une interdépendance des phénomènes selon des règles ; et il n'y a nulle part absence de règles. Si nous croyons constater une telle absence, nous pouvons seulement dire en ce cas que les règles nous sont inconnues. [...] de même que la sensibilité est la faculté des intuitions, de même l'entendement est la faculté de penser, c'est-à-dire de soumettre les représentations des sens à des règles. Aussi son plus vif désir est-il de chercher des règles et son plus vif plaisir est-il de les avoir trouvées. Voici donc la question qui se pose : puisque l'entendement est la source des règles, selon quelles règles procède-t-il lui-même ? Car il ne fait aucun doute que nous ne pouvons penser ou faire usage de notre entendement qu'en nous conformant à certaines règles. Or ces règles, nous pouvons à leur tour les penser en elles-mêmes, c'est-à-dire que nous pouvons les penser en dehors de leur application, ou in abstracto. Quelles sont donc ces règles ? Toutes les règles selon lesquelles l'entendement procède sont ou bien nécessaires ou bien contingentes. Les premières sont celles sans lesquelles tout usage de l'entendement serait impossible ; les secondes sont celles sans lesquelles un certain usage déterminé de l'entendement ne pourrait avoir lieu. Les règles contingentes qui dépendent d'un objet déterminé de la connaissance sont aussi nombreuses que ces objets eux-mêmes. Par exemple, il y a un usage de l'entendement en mathématiques, en métaphysique, en morale, etc. Les règles de cet usage déterminé particulier de l'entendement dans ces sciences sont contingentes, car il est contingent que je pense tel ou tel objet, auquel ces règles particulières se rapportent. Mais si nous mettons de côté toute connaissance que nous devons emprunter aux seuls objets et si nous réfléchissons seulement à l'usage de l'entendement en général, nous découvrons ces règles qui sont absolument nécessaires à tous égards et sans considération des objets particuliers de la pensée, puisque sans elles nous ne pourrions pas penser du tout. C'est pourquoi ces règles peuvent être discernées même a priori, c'est-à-dire indépendamment de toute expérience, puisque, sans tenir compte de la distinction entre les objets, elles renferment simplement les conditions de l'usage de l'entendement en général, que cet usage soit pur ou empirique. Et de là vient aussi que les règles universelles et nécessaires de la pensée en général ne peuvent concerner que sa seule forme et aucunement sa matière. Par conséquent, la science qui contient ces règles universelles et nécessaires est simplement une science de la forme de notre connaissance intellectuelle ou de la pensée. Et nous pouvons donc nous faire une idée de la possibilité d'une telle science, exactement comme d'une grammaire générale qui ne contient rien de plus que la simple forme de la langue en général, sans les mots qui appartiennent à la matière de la langue. Cette science des lois nécessaires de l'entendement et de la raison en général ou, ce qui est la même chose, de la simple forme de la pensée en général, nous la nommons : Logique. [...] Certains logiciens supposent, à vrai dire, des principes psychologiques dans la logique. Mais admettre de tels principes en logique est aussi absurde que de tirer la morale de la vie. Si nous cherchions les principes dans la psychologie, c'est-à-dire dans les observations que nous ferions sur notre entendement, nous verrions simplement comment se produit la pensée et comment elle est assujettie à diverses entraves et conditions subjectives ; ce qui conduirait donc à la connaissance de lois simplement contingentes. Mais en logique il s'agit de lois nécessaires, non de lois contingentes, non de la façon dont nous pensons, mais de la façon dont nous devons penser. Les règles de la logique doivent donc être dérivées non de l'usage contingent, mais de l'usage nécessaire de l'entendement, que l'on trouve en soi-même sans aucune psychologie. Dans la logique, ce que nous voulons savoir, ce n'est pas comment l'entendement est, comment il pense, comment il a procédé jusqu'ici pour penser, mais bien comment il devrait procéder dans la pensée. Elle doit nous enseigner le droit usage de l'entendement, c'est-à-dire celui qui est cohérent avec lui-même. |
|||||
|
p. 22-27 Connaissance objective et subjective [...] avant de tenter de donner une définition de la philosophie, il nous faut au préalable nous enquérir du caractère de différentes connaissances, et puisque la connaissance philosophique fait partie des connaissances rationnelles, il nous faut en particulier définir ce que nous entendons par ces dernières. Les connaissances rationnelles sont opposées aux connaissances historiques. Les unes sont des connaissances provenant de principes (ex principiis), les autres des connaissances provenant de données (ex datis). — Mais une connaissance peut provenir de la raison et cependant être historique ; ainsi, par exemple, si un homme simplement lettré apprend les productions de la raison d'autrui, sa connaissance de tels produits rationnels est simplement historique. De fait, on peut distinguer les connaissances : 1. d'après leur origine objective, c'est-à-dire d'après les sources qui sont seules à rendre possible une connaissance. De ce point de vue, toutes les connaissances sont soit rationnelles [déduction raisonnée], soit empiriques [expérience factuelle] ; 2. d'après leur origine subjective, c'est-à-dire d'après la manière dont une connaissance peut être acquise par l'homme. De ce nouveau point de vue, les connaissances sont rationnelles ou historiques, quelle que soit leur provenance propre. Ainsi quelque chose peut être objectivement une connaissance rationnelle qui subjectivement n'en est pas moins simplement historique. Il est préjudiciable à certaines connaissances rationnelles de n'être sues qu'historiquement, pour d'autres c'est sans importance. Par exemple, le navigateur sait historiquement, d'après ses tables, les règles de la navigation et cela lui suffit. Mais si le juriste ne sait qu'historiquement l'érudition juridique, il est tout à fait inapte à exercer vraiment les fonctions de juge et plus encore celles de législateur. De la distinction indiquée entre les connaissances rationnelles objectivement et subjectivement, il résulte clairement qu'on peut d'une certaine façon apprendre la philosophie sans être capable de philosopher. Donc celui qui veut devenir vraiment philosophe doit s'exercer à faire de sa raison, non un usage d'imitation et pour ainsi dire mécanique, mais un usage libre. Nous avons défini les connaissances rationnelles comme connaissances à partir de principes, et de là suit qu'elles doivent être a priori. Or, il y a deux sortes de connaissances qui toutes deux sont a priori, mais qui n'en présentent pas moins plusieurs différences notables ; ce sont la Mathématique et la Philosophie. On prétend communément que mathématique et philosophie se distinguent l'une de l'autre par l'objet, l'une traitant de la quantité, l'autre de la qualité. Tout cela est faux. Ces sciences ne sauraient se distinguer par l'objet ; car la philosophie s'étend à tout, donc aux quanta également, et la mathématique aussi, dans la mesure du moins où tout a une quantité. C'est uniquement l'espèce différente de connaissance rationnelle ou d'usage de la raison qui constitue la différence spécifique entre ces deux sciences : La Philosophie est la connaissance rationnelle par simples concepts, la mathématique, au contraire, est la connaissance rationnelle par construction des concepts. Nous construisons les concepts quand nous les présentons dans l'intuition a priori sans recours à l'expérience, ou lorsque nous présentons dans l'intuition l'objet qui correspond au concept que nous en avons. — Le mathématicien ne peut jamais se servir de sa raison en usant de simples concepts, le philosophe ne peut jamais user de la sienne en construisant les concepts — En mathématique, on se sert de la raison in concreto, et l'intuition n'est pas empirique, mais on s'y donne a priori quelque chose comme objet de l'intuition. Nous voyons que par là, la mathématique a un avantage sur la philosophie en ceci que ses connaissances sont intuitives, alors que les autres sont au contraire discursives seulement. Mais la raison pour laquelle c'est en mathématiques surtout que sont considérées les quantités, c'est que les quantités peuvent être construites a priori, alors que les qualités au contraire ne se laissent pas présenter dans l'intuition. La philosophie est donc le système des connaissances philosophiques ou des connaissances rationnelles par concepts. Telle est la notion scolastique de cette science. Selon sa notion cosmique, elle est la science des fins dernières de la raison humaine. Cette conception élevée confère à la philosophie dignité, c'est-à-dire valeur absolue. Et, effectivement, elle est même la seule à ne posséder de valeur qu'intrinsèque et à conférer originellement une valeur aux autres connaissances. Assurément on finit toujours par demander : à quoi sert de philosopher, à quoi sert le but finalement visé : la philosophie elle-même, considérée comme science selon son concept scolastique ? Dans ce sens scolastique du mot, la philosophie vise seulement à l'habileté ; au point de vue de son concept cosmique au contraire, à l'utilité. Au premier point de vue, elle est donc une doctrine de l'habileté ; au second, une doctrine de la sagesse — la législatrice de la raison. Et dans cette mesure le philosophe n'est pas un artiste de la raison, mais son législateur. L'artiste de la raison, ou comme Socrate le nomme, le philodoxe, vise simplement la connaissance spéculative sans se demander dans quelle mesure le savoir contribue à la fin dernière de la raison humaine : il donne des règles pour mettre la raison au service de toutes sortes de fins. Le philosophe pratique, le maître de la sagesse par la doctrine et par l'exemple est le vrai philosophe. Car la philosophie est l'idée d'une sagesse parfaite, qui nous désigne les fins dernières de la raison humaine. Dans la philosophie selon sa notion scolastique, il faut faire deux parties : — en premier lieu, une provision suffisante de connaissances rationnelles ; — d'autre part, une organisation systématique de ces connaissances, ou leur connexion dans l'idée d'un tout. Non seulement la philosophie permet une telle organisation strictement systématique, mais elle est la seule science qui possède au sens le plus propre, une organisation systématique et qui donne à toutes les autres sciences une unité systématique. Mais s'agissant de la philosophie selon son sens cosmique, on peut aussi l'appeler une science des maximes suprêmes de l'usage de notre raison, si l'on entend par maxime le principe interne du choix entre différentes fins. Car la philosophie, en ce dernier sens, est même la science du rapport de toute connaissance et de tout usage de la raison à la fin ultime de la raison humaine, fin à laquelle, en tant que suprême, toutes les autres fins sont subordonnées et dans laquelle elles doivent être toutes unifiées.
Le domaine de la philosophie en ce sens cosmopolite se ramène aux questions suivantes : À la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième l'anthropologie. Mais au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie, puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière.
Le philosophe doit donc pouvoir déterminer : Cette dernière détermination est la plus indispensable, c'est aussi la plus difficile, mais le philodoxe ne s'en préoccupe pas.
Il y a principalement deux choses qui sont nécessaires au philosophe : Il faut réunir les deux ; car sans connaissances on ne deviendra jamais philosophe, mais jamais non plus les connaissances ne suffiront à faire un philosophe, si ne vient s'y ajouter une harmonisation convenable de tous les savoirs et de toutes les habiletés jointes à l'intelligence de leur accord avec les buts les plus élevés de la raison humaine. De façon générale, nul ne peut se nommer philosophe s'il ne peut philosopher. Mais on n'apprend à philosopher que par l'exercice et par l'usage qu'on fait soi-même de sa propre raison. Comment la philosophie se pourrait-elle, même à proprement parler, apprendre ? En philosophie, chaque penseur bâtit son oeuvre pour ainsi dire sur les ruines d'une autre ; mais jamais aucune n'est parvenue à devenir inébranlable en toutes ses parties. De là vient qu'on ne peut apprendre à fond la philosophie, puisqu'elle n'existe pas encore. Mais à supposer même qu'il en existât une effectivement, nul de ceux qui l'apprendraient, ne pourrait se dire philosophe, car la connaissance qu'il en aurait demeurerait subjectivement historique. Il en va autrement en mathématiques. Cette science peut, dans une certaine mesure, être apprise ; car ici, les preuves sont tellement évidentes que chacun peut en être convaincu ; et en outre, en raison de son évidence, elle peut être retenue comme une doctrine certaine et stable. Celui qui veut apprendre à philosopher doit, au contraire, considérer tous les systèmes de philosophie uniquement comme une histoire de l'usage de la raison et comme des objets d'exercice de son talent philosophique. Le vrai philosophe doit donc faire, en pensant par lui-même, un usage libre et personnel de sa raison et non imiter servilement. Mais il doit se garder également d'en faire un usage dialectique, c'est-à-dire un usage qui n'a d'autre fin que de donner à sa connaissance une apparence de vérité et de sagesse. C'est là procédé de simple sophiste, mais tout à fait incompatible avec la dignité du philosophe qui connaît et enseigne la sagesse. Car la science n'a de réelle valeur intrinsèque que comme instrument de sagesse. Mais à ce titre, elle lui est à ce point indispensable qu'on pourrait dire que la sagesse sans la science n'est que l'esquisse d'une perfection à laquelle nous n'atteindrons jamais. Celui qui hait la science, mais qui aime d'autant plus la sagesse, s'appelle un misologue. La misologie naît ordinairement d'un manque de connaissance scientifique à laquelle se mêle une certaine sorte de vanité. Il arrive cependant parfois que certains tombent dans l'erreur de la misologie. Ceux-ci ont commencé par pratiquer la science avec beaucoup d'ardeur et de succès, mais ils n'ont finalement trouvé dans leur savoir aucun contentement. La philosophie est l'unique science qui sache nous procurer cette satisfaction intime, car elle referme, pour ainsi dire, le cercle scientifique et procure enfin aux sciences ordre et organisation. En vue de nous exercer à penser par nous-mêmes et à philosopher, il nous faudra donc avoir égard davantage à la méthode mise en oeuvre dans l'usage de notre raison qu'aux thèses elles-mêmes qu'elle nous aura permis d'établir. |
|||||
|
Perfections logiques et esthétiques p. 34-36, 38-42 Toute notre connaissance comporte une double relation ; d'abord une relation à l'objet, ensuite une relation au sujet. Au premier point de vue, elle se rapporte à la représentation ; au second, à la conscience, condition universelle de toute connaissance en général — (à proprement parler, la conscience c'est une représentation qu'une autre représentation est en moi). En toute connaissance, il faut distinguer la matière, c'est-à-dire l'objet, et la forme, c'est-à-dire la manière dont nous connaissons l'objet [Aristote]. Si par exemple un sauvage voit une maison au loin, dont il ne sait pas à quoi elle sert, il ne s'en représente pas moins exactement le même objet qu'un autre homme, qui sait parfaitement qu'elle est destinée à l'habitation humaine. Mais au point de vue de la forme, cette connaissance d'un seul et même objet est différente chez les deux hommes. Chez l'un, elle est une simple intuition, chez l'autre, elle est intuition et concept en même temps. La variété dans la forme de la connaissance repose sur une condition qui accompagne toute connaissance : la conscience. Si j'ai conscience de la représentation, elle est claire ; si je n'en ai pas conscience, elle est obscure. Puisque la conscience est la condition essentielle de toute forme logique de la connaissance, la logique ne peut et ne doit avoir affaire qu'à des représentations claires et non obscures. En logique nous ne voyons pas comment naissent les représentations ; mais simplement comment elles s'accordent avec la forme logique. De façon générale, la logique ne peut pas non plus traiter des simples représentations et de leur possibilité. Elle laisse cela à la métaphysique. Elle-même s'occupe simplement des règles de la pensée dans les concepts, jugements, raisonnements, moyens par lesquels la pensée s'exerce. Assurément, il se produit quelque chose avant qu'une représentation devienne concept. Nous le montrerons en son lieu. Mais nous ne chercherons pas comment naissent les représentations. À vrai dire, la logique traite aussi de la connaissance, puisque dans le connaître, il y a déjà la pensée. Mais une représentation n'est pas encore une connaissance, c'est la connaissance qui présuppose toujours la représentation. Et cette dernière ne se laisse absolument pas définir. Car on ne pourrait répondre à la question qu'est-ce que la représentation ? qu'en recourant toujours encore à une autre représentation dans la définition. [...] Sur la distinction qui vient d'être proposée entre connaissances intuitives et discursives ou entre intuitions et concepts se fonde la différence entre la perfection esthétique et la perfection logique de la connaissance. Une connaissance peut être parfaite, soit selon les lois de la sensibilité, soit selon les lois de l'entendement ; dans le premier cas, elle est esthétiquement parfaite, dans le second logiquement parfaite. Ces deux sortes de perfection, esthétique et logique, sont donc distinctes ; la première relève de la sensibilité, la seconde de l'entendement. La perfection logique de la connaissance repose sur son accord avec l'objet, donc sur des lois qui ont validité universelle, et elle peut par conséquent être également estimée d'après des normes a priori. La perfection esthétique consiste dans l'accord avec le sujet, et elle repose sur la sensibilité particulière de l'homme. Aussi dans la perfection esthétique, il n'y a pas de place pour des lois ayant validité objective universelle, en référence auxquelles on pourrait l'estimer a priori de façon universellement valable pour tout être pensant en général. Néanmoins comme il y a également des lois universelles de la sensibilité qui, à défaut de valoir objectivement pour tout être pensant, ont tout de même une validité objective pour l'humanité entière, on peut concevoir également une perfection esthétique, qui renferme le principe d'une satisfaction subjectivement universelle. C'est la beauté : ce qui plaît aux sens dans l'intuition et précisément pour cette raison peut être l'objet d'une satisfaction universelle, puisque les lois de l'intuition sont des lois universelles de la sensibilité. [...]
Dans cet effort pour lier la perfection esthétique à la perfection logique dans nos connaissances, nous ne devons pas perdre de vue les règles suivantes : Pour rendre encore plus manifestes les différences essentielles qui existent entre la perfection logique et la perfection esthétique de la connaissance, non seulement de façon générale, mais à divers points de vue particuliers nous allons les comparer selon les quatre moments principaux de la quantité, qualité, relation et modalité d'après lesquels on estime la perfection de la connaissance. Une connaissance est parfaite 1) selon la quantité, si elle est universelle ; 2) selon la qualité, si elle est distincte ; 3) selon la relation, si elle est vraie et enfin 4) selon la modalité, si elle est certaine. Donc considérée aux points de vue qui viennent d'être indiqués, une connaissance sera logiquement parfaite selon la quantité si elle possède l'universalité objective (universalité du concept ou de la règle) — selon la qualité, si elle possède la distinction objective (distinction dans le concept) — selon la relation, si elle a la vérité objective — et enfin, selon la modalité, si elle a la certitude objective. À ces perfections logiques correspondent les perfections esthétiques suivantes, au point de vue de ces quatre moments principaux : 1) l'universalité esthétique — Elle consiste en l'applicabilité d'une connaissance à une multitude d'objets, qui servent d'exemples, auxquels l'application en peut être faite et grâce à quoi elle devient utilisable dans un but de vulgarisation. 2) la distinction esthétique — C'est la distinction dans l'intuition, où, au moyen d'exemples, un concept pensé abstraitement est exposé et expliqué in concreto. 3) la vérité esthétique — Une vérité simplement subjective, qui consiste uniquement dans l'accord de la connaissance avec le sujet et les lois de l'apparence sensible et qui par suite n'est rien de plus qu'une apparence universelle. 4) la certitude esthétique — Elle se fonde sur ce qui est nécessaire d'après le témoignage des sens, c'est-à-dire ce qui est validé par la sensation et l'expérience. |
|||||
|
p. 54-56 Une perfection majeure de la connaissance et même la condition essentielle et inséparable de toute sa perfection, c'est la vérité. La vérité, dit-on, consiste dans l'accord de la connaissance avec l'objet. Selon cette simple définition de mot, ma connaissance doit donc s'accorder avec l'objet pour avoir valeur de vérité. Or le seul moyen que j'ai de comparer l'objet avec ma connaissance c'est que je le connaisse. Ainsi ma connaissance doit se confirmer elle-même ; mais c'est bien loin de suffire à la vérité. Car puisque l'objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier c'est si ma connaissance de l'objet s'accorde avec ma connaissance de l'objet. Les anciens appelaient diallèle un tel cercle dans la définition. Et effectivement, c'est cette faute que les sceptiques n'ont cessé de reprocher aux logiciens ; ils remarquaient qu'il en est de cette définition de la vérité comme d'un homme qui ferait une déposition au tribunal et invoquerait comme témoin quelqu'un que personne ne connaît, mais qui voudrait être cru en affirmant que celui qui l'invoque comme témoin est un honnête homme. Reproche absolument fondé, mais la solution du problème en question est totalement impossible pour tout le monde. En fait, la question qui se pose ici est de savoir si, et dans quelle mesure il y a un critère de la vérité certain, universel et pratiquement applicable. Car tel est le sens de la question : qu'est-ce que la vérité ? Pour être à même de trancher cette importante question, il nous faut soigneusement distinguer dans notre connaissance ce qui appartient à sa matière et se rapporte à l'objet, de ce qui concerne la simple forme comme la condition sans laquelle une connaissance ne serait, de façon générale, pas une connaissance.
Eu égard à cette distinction entre l'aspect objectif, matériel et l'aspect subjectif, formel, de notre connaissance,
la question précédente se subdivise dans les deux questions que voici : Un critère matériel et universel de la vérité n'est pas possible — il est même en soi contradictoire. Car en tant qu'universel, valable pour tout objet en général, il devrait ne faire acception d'absolument aucune distinction entre les objets tout en servant cependant, justement en tant que critère matériel, à cette distinction-même, pour pouvoir déterminer si une connaissance s'accorde précisément à l'objet auquel elle est rapportée et non pas à un objet quelconque en général, ce qui ne voudrait proprement rien dire. Car la vérité matérielle doit consister dans cet accord d'une connaissance avec cet objet déterminé auquel elle est rapportée. En effet une connaissance qui est vraie si elle est rapportée à un objet, peut-être fausse si elle est rapportée à un autre. Il est donc absurde d'exiger un critère matériel universel de la vérité qui devrait à la fois faire abstraction et ne pas faire abstraction de toute différence entre les objets. En revanche, si ce sont de critères formels universels qu'il s'agit, il est aisé de décider qu'il peut parfaitement y en avoir. Car la vérité formelle consiste simplement dans l'accord de la connaissance avec elle-même en faisant complètement abstraction de tous les objets et de toute différence entre eux. Et par conséquent les critères formels universels de la vérité ne sont rien d'autre que les caractères logiques universels de l'accord de la connaissance avec elle-même, ou ce qui est la même chose — avec les lois universelles de l'entendement et de la raison. Ces critères formels universels ne sont assurément pas suffisants pour la vérité objective, mais ils doivent cependant être considérés comme sa conditio sine qua non. Car avant de se demander si la connaissance s'accorde avec l'objet, il faut d'abord se demander si la connaissance s'accorde avec elle-même (selon la forme). Et telle est l'affaire de la logique.
Les critères formels de la vérité en logique sont : [...] p. 58 Avec l'autre mode de raisonnement, positif et direct (modus ponens), la difficulté vient de ce qu'on ne peut connaître apodictiquement [avec certitude] la totalité des conséquences et que par conséquent, par ce mode de raisonnement, on n'est conduit qu'à une connaissance vraisemblablement et hypothétiquement vraie (hypothèse) selon la supposition que là où beaucoup de conséquences sont vraies, toutes les autres peuvent également être vraies. Nous pourrons donc poser ici trois principes comme critères universels de la vérité, simplement formels ou logiques ; ce sont : 1) le principe de contradiction et d'identité (principium contradictionis et identitatis) par lequel la possibilité interne d'une connaissance est déterminée pour des jugements problématiques [incertains (Ex. : Demain il pleuvra.)] ; 2) le principe de raison suffisante (principium rationis sufficientis) sur lequel repose la réalité (logique) d'une connaissance ; le fait qu'elle soit fondée comme matière pour des jugements assertoriques [certains (Ex. : Il pleut.)] ; 3) le principe du tiers exclu (principium exclusi medii inter duo contradictoria) sur lequel se fonde la nécessité (logique) d'une connaissance ; — le fait qu'il soit nécessaire que nous jugions ainsi et non autrement, c'est-à-dire que le contraire soit faux — principe pour des jugements apodictiques [indubitable (Ex. : Tous les triangles ont trois côtés.)] . * * * Le contraire de la vérité est la fausseté ; quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. Un jugement erroné — car l'erreur comme la vérité n'a lieu que dans les jugements — est par conséquent un jugement qui prend l'apparence de la vérité pour la vérité elle-même. [...] p. 63
D'une manière générale, les règles et conditions universelles pour éviter l'erreur sont : |
|||||
|
Opinion, croyance, savoir et préjugés p. 73-79, 81 La vérité est propriété objective de la connaissance ; le jugement par lequel quelque chose est représenté comme vrai — le rapport à un entendement et par conséquent à un sujet particulier — est subjectif, c'est l'assentiment [2]. Pris dans sa généralité, l'assentiment comporte deux espèces : celle de la certitude et celle de l'incertitude. L'assentiment certain ou la certitude est lié à la conscience de la nécessité ; l'assentiment incertain au contraire ou l'incertitude est lié à la conscience de la contingence ou de la possibilité du contraire — Cette dernière sorte d'assentiment à son tour est soit insuffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement, soit objectivement insuffisante, mais subjectivement suffisante. La première se nomme opinion ; il faut appeler la seconde croyance. On voit donc qu'il y a trois espèces ou modes (modi) d'assentiment : l'opinion, la croyance et le savoir. — L'opinion est un jugement problématique, la croyance un jugement assertorique et le savoir un jugement apodictique. Car ce qui est pour moi simplement objet d'opinion, j'ai conscience dans mon jugement de le considérer comme problématique seulement ; ce que je crois, comme assertorique, c'est-à-dire comme nécessaire non objectivement, mais subjectivement (valant pour moi seulement) ; enfin ce que je sais, comme apodictiquement certain, c'est-à-dire comme universellement et objectivement nécessaire (valant pour tous), à supposer même que l'objet lui-même auquel se rapporte cet assentiment certain, soit une vérité simplement empirique. Car cette distinction concernant l'assentiment selon les trois modes qui viennent d'être désignés ne concerne que la faculté de juger dans son rapport aux critères subjectifs de subsomption d'un jugement sous des règles objectives. Ainsi par exemple, notre assentiment à l'immortalité serait simplement problématique en tant que nous agissons seulement comme si nous étions immortels ; mais il serait assertorique, dans la mesure où nous croyons que nous sommes immortels ; enfin il serait apodictique dans la mesure où nous saurions tous qu'il y a une autre vie après celle-ci. Par conséquent, entre opinion, croyance et savoir, il y a une différence essentielle que nous allons maintenant préciser et détailler. 1) Opinion L'opinion ou l'assentiment fondé sur une connaissance qui n'est suffisante ni subjectivement ni objectivement, peut-être considérée comme un jugement provisionnel (sub conditione suspensiva ad interim) dont il n'est pas facile de se passer. Il faut commencer par l'opinion avant d'admettre et d'affirmer ; pourvu qu'on se garde de voir dans une opinion plus qu'une simple opinion. — C'est par l'opinion que nous commençons la plupart du temps dans toutes nos connaissances. Parfois nous avons un obscur pressentiment de la vérité ; une chose nous paraît comporter des caractères de la vérité ; — nous pressentons déjà sa vérité avant de la connaître avec une certitude déterminée. Mais où est le domaine propre de la simple opinion ? — Ce n'est pas dans les sciences, qui renferment des connaissances a priori ; donc ni en mathématiques, ni en métaphysique, ni en morale, mais uniquement dans des connaissances empiriques — en physique, en psychologie et autres disciplines de ce genre. Car il est en soi absurde d'avoir une opinion a priori. Et de ce fait rien ne serait plus ridicule que d'avoir de simples opinions en mathématiques par exemple. Ici, tout comme en métaphysique et en morale : ou bien on sait, ou bien on ne sait pas. Il n'y a donc jamais que les objets d'une connaissance empirique qui puissent être choses d'opinion, connaissance à vrai dire possible en soi, mais impossible pour nous uniquement à cause des conditions et limitations empiriques de notre faculté d'expérience et du degré de cette faculté dont nous disposons en conséquence. Ainsi par exemple, l'éther des physiciens modernes est un simple objet d'opinion. Car de celui-ci, aussi bien que de toute opinion en général, quelle qu'elle puisse être, j'aperçois que peut-être le contraire pourrait être prouvé. Mon assentiment par conséquent est ici insuffisant aussi bien objectivement que subjectivement, bien que, considéré en lui-même, il puisse être complet. 2) Croyance La croyance ou l'assentiment pour une raison qui est objectivement insuffisante, mais subjectivement suffisante se rapporte à des objets concernant lesquels non seulement nous ne pouvons rien connaître, mais même nous ne pouvons avoir une opinion ; bien plus, nous ne pouvons même pas alléguer la probabilité à leur propos, nous pouvons simplement être certains qu'il n'est pas contradictoire de penser de tels objets tels que nous les pensons. Reste un libre assentiment, qui est seulement nécessaire à un point de vue pratique a priori donné ; donc un assentiment que j'assume pour des raisons morales et à propos de quelque chose dont je suis certain que le contraire ne saurait être prouvé * . * La croyance n'est pas une source particulière de connaissance. C'est une sorte d'assentiment dont on a conscience qu'il est imparfait, et, si on la considère comme restreinte à une sorte particulière d'objets (qui ressortissent à la seule croyance), elle diffère de l'opinion non par le degré , mais par la relation qu'elle entretient, en tant que connaissance, avec l'action. Ainsi par exemple, un commerçant pour entreprendre une affaire a besoin non seulement d'avoir l'opinion qu'il a quelque chose à y gagner, mais de le croire, c'est-à-dire que son opinion soit suffisante pour qu'il se risque dans une entreprise incertaine. [...] Donc les matières de croyance ne sont pas : I) des objets de la connaissance empirique. Ce qu'on appelle la croyance historique ne peut donc être proprement nommée croyance, ni, en tant que telle, opposée au savoir puisqu'elle peut être elle-même un savoir. L'assentiment à un témoignage n'est distinct ni en degré ni en espèce de l'assentiment auquel on parvient par l'expérience personnelle. II) Ce ne sont pas non plus des objets de connaissance rationnelle (connaissance a priori) que leur connaissance soit théorique, comme en mathématique et en métaphysique, ou pratique, en morale. À vrai dire il est possible de croire sur un témoignage à des vérités rationnelles mathématiques en partie parce qu'ici l'erreur est difficilement possible, en partie parce qu'elle peut être également détectée sans peine ; mais assurément il n'est pas possible de les savoir de cette façon. Quant aux vérités rationnelles d'ordre philosophique, elles ne sauraient en aucune façon être objets de croyance ; elles ne peuvent être qu'objets de savoir ; car la philosophie ne tolère en elle aucune simple persuasion. — Et en ce qui concerne en particulier les objets de la connaissance rationnelle pratique en morale — droits et devoirs —, ils peuvent tous aussi peu donner lieu à une simple croyance. On doit être tout à fait certain si une chose est légitime ou non, conforme ou non au devoir, permise ou interdite. On ne peut rien hasarder dans l'incertitude en matière de morale, rien décider qui risque de contrevenir à la loi. Ainsi par exemple il ne suffit pas que le juge croie simplement que celui qui est accusé d'un crime l'a réellement commis. Il doit le savoir (juridiquement), ou alors il agit sans conscience. III) Sont seulement matière à croyance des objets tels que l'assentiment qu'on leur donne est nécessairement libre, c'est-à-dire n'est pas déterminé par des fondements de vérité objectifs, indépendants de la nature et de l'intérêt du sujet. Aussi, en raison de ses fondements simplement subjectifs, la croyance ne procure aucune conviction qui puisse être communiquée et qui exige l'assentiment universel comme la conviction qui vient du savoir. Il n'y a que moi-même qui puisse être certain de la validité et de l'immuabilité de ma croyance pratique, et ma croyance à la vérité d'une proposition ou à la réalité d'une chose, est ce qui, dans sa relation à moi, tient lieu d'une connaissance sans être soi-même une connaissance. Est moralement incroyant celui qui n'admet pas ce qu'il est impossible de savoir, mais moralement nécessaire de supposer. Cette sorte d'incroyance est toujours fondée sur un manque d'intérêt moral. Plus la disposition morale d'un homme est affirmée, plus sa croyance est également ferme et vive en tout ce qu'il se sent contraint d'admettre et de supposer par intérêt moral dans une nécessaire intention pratique. 3) Savoir L'assentiment issu d'un fondement de connaissance qui est suffisant aussi bien objectivement que subjectivement, — ou la certitude — est soit empirique soit rationnel, selon qu'il se fonde sur l'expérience — qu'elle soit personnelle ou partagée avec autrui — ou sur la raison. Cette distinction se rapporte donc aux deux sources d'où provient l'ensemble de notre connaissance : l'expérience et la raison. La certitude rationnelle à son tour est soit certitude mathématique, soit certitude philosophique ; la première est intuitive, la seconde discursive. La certitude mathématique s'appelle aussi évidence, parce qu'une connaissance intuitive est plus claire qu'une connaissance discursive. Donc bien que la connaissance rationnelle, qu'elle soit mathématique ou philosophique, soit en elle-même également certaine, l'espèce de la certitude est différente dans les deux cas. La certitude empirique est originaire (originarie empirica), lorsque ma certitude provient de mon expérience personnelle, elle est dérivée (derivative empirica) lorsqu'elle provient de l'expérience d'autrui. Cette dernière est aussi communément appelée certitude historique. La certitude rationnelle se distingue de la certitude empirique par la conscience de la nécessité qui s'y attache ; elle est donc une certitude apodictique tandis que la certitude empirique est seulement assertorique. On est rationnellement certain de ce qu'on aurait pu discerner a priori sans aucune expérience. De là vient qu'il est possible que nos connaissances portent sur des objets d'expérience et que cependant la certitude à laquelle elles donnent lieu soit à la fois empirique et rationnelle, dans la mesure où c'est à partir des principes a priori que nous connaissons une proposition empiriquement certaine. Nous ne pouvons avoir une certitude rationnelle de tout, mais partout où cela est possible nous devons la préférer à la certitude empirique. [...] [...] L'assentiment complet fondé sur des raisons subjectives, qui, au point de vue pratique, valent autant que des raisons objectives, est de ce fait conviction non seulement logique, mais pratique (je suis certain). Et cette conviction pratique ou cette croyance rationnelle morale est souvent plus ferme que tout savoir. Dans le cas du savoir, on écoute encore des raisons contraires ; non dans le cas de la croyance, car dans ce dernier cas il ne s'agit pas de raisons objectives, mais de l'intérêt moral du sujet. [...] [...] p. 85-91 Préjugés Les principales sources de préjugés sont : l'imitation, l'habitude, et l'inclination. L'imitation a une influence générale sur nos jugements ; car il y a une forte raison de tenir pour vrai ce que d'autres ont donné pour tel. D'où le préjugé : ce que tout le monde fait est bien. — Quant aux préjugés qui sont nés de l'habitude, ils ne peuvent être déracinés qu'à la longue, si l'entendement voit ses jugements progressivement retenus et ajournés par des raisons contraires et se trouve de ce fait reconduit peu à peu à une façon de penser opposée. — Mais si un préjugé dû à l'habitude est en même temps provoqué par l'imitation, il est difficile de guérir l'homme qui en est atteint. — Un préjugé par imitation peut aussi être appelé le penchant à l'usage passif de la raison ou à l'usage mécanique de la raison se substituant à son action spontanée selon des lois. À vrai dire, la raison est un principe actif qui ne doit rien emprunter à la simple autorité d'autrui, ni même à l'expérience quand il y va de son usage pur. Mais très nombreux sont ceux que la paresse conduit à préférer suivre la trace d'autrui plutôt que de fatiguer leurs propres facultés mentales. De tels gens ne sauraient jamais être que des copies d'autrui, et si tous étaient de cette sorte, aucun changement ne se serait jamais produit dans le monde. D'où la nécessité et l'importance de ne pas confiner la jeunesse, comme on le fait d'habitude, dans la simple imitation. Il ne manque pas de choses qui contribuent à nous habituer à la maxime de l'imitation et à faire ainsi de la raison un sol fertile en préjugés. Au nombre de ces auxiliaires de l'imitation, on trouve : 1) Les formules — Ce sont des règles dont l'expression sert de modèle à l'imitation. — Elles sont du reste tout à fait utiles pour tirer au clair des thèses embrouillées, et c'est pourquoi l'esprit le plus éclairé s'emploie à en inventer de telles. 2) Les sentences, expression très concise d'une signification qui frappe, au point qu'il semble qu'on n'en saurait saisir le sens en moins de mots. Des sentences de ce genre (dicta), qui doivent toujours être empruntées à quelqu'un d'autre à qui l'on attribue une certaine infaillibilité, servent sous la foi de cette autorité, de règle et de loi. Les paroles de la Bible s'appellent sentences. 3) Les apophtegmes, c'est-à-dire des propositions qui se recommandent et maintiennent souvent leur autorité à travers les siècles comme produits d'un jugement mûr à cause de l'énergie des pensées qu'ils renferment. 4) Les canons — Ce sont des maximes générales qui servent de fondement aux sciences et qui signifient quelque chose de sublime et de médité. On peut encore les exprimer de manière sentencieuse, pour qu'ils plaisent davantage. 5) Les proverbes — Ce sont des règles populaires du bon sens ou des expressions qui en désignent les jugements populaires. Comme de telles expressions purement provinciales ne servent d'apophtegmes et de canons qu'aux gens du commun, on ne doit pas les rencontrer chez des gens d'une éducation plus distinguée. Des trois sources générales des préjugés précédemment indiqués, et plus spécialement de l'imitation naissent maints préjugés particuliers parmi lesquels nous voulons ici relever ceux-ci comme étant les plus communs. 1) Préjugés de l'autorité — Parmi ceux-ci, il faut compter : a) Le préjugé de l'autorité de la personne. — Lorsque, dans les matières qui se fondent sur l'expérience et le témoignage, nous bâtissons notre connaissance sur l'autorité d'autrui, nous ne nous rendons ainsi coupables d'aucun préjugé ; car dans ce genre de choses, puisque nous ne pouvons faire nous-mêmes l'expérience de tout ni le comprendre par notre propre intelligence, il faut bien que l'autorité de la personne soit le fondement de nos jugements. — Mais lorsque nous faisons de l'autorité d'autrui le fondement de notre assentiment à l'égard de connaissances rationnelles, alors nous admettons ces connaissances comme simple préjugé. Car c'est de façon anonyme que valent les vérités rationnelles ; il ne s'agit pas alors de demander : qui a dit cela ? mais bien qu'a-t-il dit ? Peu importe si une connaissance a une noble origine ; le penchant à suivre l'autorité des grands hommes n'en est pas moins très répandu tant à cause de la faiblesse des lumières personnelles que par désir d'imiter ce qui nous est présenté comme grand. À quoi s'ajoute que l'autorité personnelle sert, indirectement, à flatter notre vanité. Ainsi les sujets d'un puissant despote s'enorgueillissent de ce qu'il les traite tous en même façon, du fait que l'inférieur peut s'imaginer égal au supérieur, dans la mesure où, face à la puissance illimitée de leur souverain, l'un et l'autre ne sont rien ; de la même façon, les admirateurs d'un grand homme s'estiment égaux dans la mesure où les avantages que l'un peut avoir sur l'autre doivent être tenus pour insignifiants au regard des mérites du grand homme. — Aussi les grands hommes fort admirés ne favorisent pas peu, pour plus d'une raison, le penchant au préjugé de l'autorité de la personne. b) Le préjugé de l'autorité du grand nombre. — C'est le vulgaire qui est le plus porté à ce préjugé. Car comme il est incapable de juger des mérites, des capacités et connaissances de la personne, il s'en tient volontiers au jugement de la masse, supposant que ce que tous disent doit bien être vrai. Cependant ce préjugé n'a trait, chez lui, qu'aux choses historiques ; en matière de religion, où il est directement concerné, il s'en rapporte au jugement des gens instruits. De façon générale, il est remarquable que l'ignorant ait un préjugé en faveur de l'érudition, tandis que l'érudit à son tour a au contraire un préjugé en faveur du sens commun. Lorsque l'érudit, après avoir déjà parcouru suffisamment le cercle des sciences, n'a pas trouvé dans ses efforts la satisfaction attendue, il finit par devenir méfiant à l'endroit de l'érudition, spécialement à l'égard de ces spéculations où les concepts ne peuvent être rendus sensibles, par exemple en métaphysique. Mais comme il croit ferme que la clé de la certitude sur certains sujets doive se trouver quelque part, il la cherche alors dans le sens commun, après l'avoir si longtemps cherché en vain dans la voie de l'enquête scientifique. Mais cet espoir est très fallacieux, car si la raison cultivée n'aboutit à rien dans la connaissance de certaines choses, il est certain que la raison inculte y parviendra tout aussi peu. En métaphysique, l'appel aux verdicts du sens commun est en tout cas tout à fait inadmissible, car ici aucun cas ne peut être présenté in concreto. Mais, à vrai dire, il en va autrement en morale. Non seulement en morale toutes les règles peuvent être données in concreto, mais la raison pratique se révèle même de façon générale plus clairement et plus correctement par l'organe de l'usage commun que de l'usage spéculatif de l'entendement. De là vient que l'entendement commun juge souvent, en matière de moralité, plus correctement que l'entendement spéculatif. c) Le préjugé de l'autorité de l'âge. — Ici le préjugé de l'Antiquité est l'un des plus considérables. À vrai dire nous avons absolument raison de juger favorablement de l'Antiquité ; mais c'est seulement la raison de l'estimer avec mesure ; nous n'avons que le tort de dépasser souvent les limites en faisant des anciens les trésoriers de la connaissance et des sciences, d'ériger la valeur relative de leurs écrits en valeur absolue et de nous confier aveuglément à leur conduite. Surestimer ainsi les anciens revient à ramener l'entendement à son enfance et à négliger de mettre en oeuvre nos propres talents. — Nous serions même grandement dans l'erreur, si nous croyions que tous les anciens ont écrit de façon aussi classique que ceux dont les écrits sont parvenus jusqu'à nous. En fait, comme le temps passe tout au crible et ne retient que ce qui a valeur intrinsèque, ce n'est pas sans raison que nous pouvons admettre que nous ne possédons que les meilleures oeuvres des anciens. Il y a plusieurs causes qui produisent et maintiennent les préjugés de l'Antiquité. I) — Lorsque quelque chose surpasse l'attente que nous avions formée sur la base d'une règle générale, nous commençons par nous en étonner et il arrive souvent que cet étonnement se transforme en admiration. C'est ce qui se produit dans le cas des Anciens quand on trouve chez eux quelque chose qu'on ne cherchait pas, eu égard aux circonstances du temps où ils vivaient. II) — Une autre cause tient au fait que la connaissance des Anciens et de l'antiquité prouve une érudition et une culture qui inspire toujours respect, si communes et insignifiantes puissent être en elles-mêmes les choses qu'on a gagnées à l'étude des anciens. III) — Une troisième cause est la gratitude dont nous nous sentons redevables aux anciens de ce qu'ils nous ont ouvert la voie de maintes connaissances. Il paraît équitable de leur en témoigner une estime particulière, mais il nous arrive souvent de dépasser la mesure. IV) — Enfin une quatrième cause est à chercher dans une certaine jalousie de nos contemporains. Qui est incapable de se mesurer avec les modernes exalte les anciens à leurs frais, pour que les modernes soient incapables de s'élever au-dessus de lui. Le contraire de ceci est le préjugé de la nouveauté. — Il arrive parfois que l'autorité de l'antiquité et le préjugé en sa faveur sont en baisse ; en particulier au début de ce siècle lorsque l'illustre Fontenelle se battit dans le camp des modernes. - Dans les connaissances qui peuvent être étendues, il est tout à fait naturel que nous fassions davantage confiance aux modernes qu'aux anciens. Mais ce jugement lui-même n'est fondé qu'à titre de jugement provisoire ; si nous en faisons un jugement définitif, c'est un préjugé. 2) Préjugés d'amour-propre ou égoïsme logique, qui font qu'on tient l'accord de son propre jugement avec les jugements d'autrui pour un critère superflu de la vérité — Ils sont le contraire des préjugés d'autorité puisqu'ils se manifestent dans une certaine prédilection pour ce qui est un produit de notre propre entendement, par exemple de notre propre système. Est-il bon ou opportun de permettre aux préjugés de se maintenir ou même de les favoriser ? Il est surprenant qu'à notre époque on puisse encore poser de telles questions, en particulier celle de savoir s'il faut favoriser les préjugés. Favoriser les préjugés de quelqu'un, cela revient tout juste à le tromper dans une bonne intention. — Laisser intacts des préjugés, passe encore ; car qui peut faire son affaire de découvrir les préjugés de chacun et de l'en défaire ? Mais qu'il ne doive pas être opportun de travailler de toutes ses forces à les extirper, c'est une tout autre question. Des préjugés anciens et fortement enracinés sont à coup sûr malaisés à combattre, car ils répondent d'eux-mêmes et sont pour ainsi dire leurs propres juges. On cherche aussi à s'excuser de laisser les préjugés en place en prétendant qu'il n'est pas sans inconvénient de les extirper. Mais admettons toujours ces inconvénients — ils n'en amèneront que plus de bien dans la suite. |
|||||
|
Probabilité, vraisemblance, doute, dogmatisme et hypothèse p. 91-96 Probabilité et vraisemblance À la doctrine de la certitude de notre connaissance appartient également la doctrine de la connaissance du probable, qu'il faut considérer comme une approximation de certitude. Par probabilité il faut entendre un assentiment fondé sur des raisons insuffisantes, mais qui ont un plus grand rapport avec les raisons suffisantes que les raisons du contraire. — Par cette définition, nous distinguons la probabilité (probabilitas) de la simple vraisemblance (verisimilitudo), assentiment fondé sur des raisons insuffisantes, en tant que celles-ci l'emportent sur les raisons du contraire. [...] Dans le cas de la probabilité, le fondement de l'assentiment est donc objectivement valable ; dans le cas de la simple vraisemblance au contraire il n'est que subjectivement valable. La vraisemblance est simple force de persuasion ; la probabilité est une approximation de la certitude. — Dans le cas de la probabilité, il doit toujours y avoir un étalon qui permet de l'évaluer. Cet étalon est la certitude. [...] Les moments de la probabilité peuvent être soit homogènes, soit hétérogènes. S'ils sont homogènes, comme dans les connaissances mathématiques, ils doivent être nombrés ; s'ils sont hétérogènes, comme dans les connaissances philosophiques, ils doivent être pesés, c'est-à-dire évalués d'après leur effet ; ce dernier devant à son tour être évalué d'après l'emprise sur les obstacles rencontrés dans l'esprit. Les moments hétérogènes ne donnent pas de rapport à la certitude, ils n'en donnent que d'une vraisemblance à une autre. De là suit que c'est seulement le mathématicien qui peut déterminer le rapport de raisons insuffisantes aux raisons suffisantes ; le philosophe doit se contenter de la vraisemblance, assentiment suffisant de façon simplement subjective et pratique. Car dans les connaissances philosophiques, à cause de l'hétérogénéité des raisons, la probabilité ne peut être évaluée ; ici les poids ne sont pas tous, pourrait-on dire, estampillés. C'est donc seulement de la probabilité mathématique que l'on peut dire proprement qu'elle est plus que demi-certitude. Doute et dogmatisme Le doute est une raison contraire ou un simple obstacle à l'assentiment qui peut être considéré soit subjectivement, soit objectivement. — Subjectivement, le doute est parfois considéré comme l'état d'un esprit indécis ; et objectivement comme la connaissance de l'insuffisance des raisons de l'assentiment. À ce dernier point de vue, il se nomme : objection, c'est-à-dire une raison objective de tenir pour fausse une connaissance tenue pour vraie. [...] Il y a un principe du doute consistant dans la maxime de traiter les connaissances de façon à les rendre incertaines et à montrer l'impossibilité d'atteindre à la certitude. Cette méthode de philosophie est la façon de penser sceptique ou le scepticisme. Elle est opposée à la façon de penser dogmatique ou au dogmatisme, qui est une confiance aveugle dans le pouvoir qu'a la raison a priori par simples concepts sans critique, simplement en considération de son succès apparent. Les deux méthodes sont fallacieuses si elles sont généralisées. Car il y a bien des connaissances à l'égard desquelles nous ne pouvons pas procéder dogmatiquement ; — et d'un autre côté le scepticisme, en renonçant à affirmer toute connaissance, anéantit tous nos efforts pour assurer la possession d'une connaissance du certain. Mais autant ce scepticisme est nuisible, autant est utile et opportune la méthode sceptique, si l'on entend seulement par là la façon de traiter quelque chose comme incertain et de le conduire au plus haut degré de l'incertitude dans l'espoir de trouver sur ce chemin la trace de la vérité. Cette méthode est donc à proprement parler une simple suspension du jugement. Elle est fort utile au procédé critique par lequel il faut entendre cette méthode de philosophie qui consiste à remonter aux sources des affirmations et objections, et aux fondements sur lesquels elles reposent, méthode qui permet d'espérer atteindre à la certitude. En mathématiques et en physique, le scepticisme n'a pas lieu d'être. La seule connaissance qui puisse lui donner place est celle qui n'est ni mathématique, ni empirique, celle qui est purement philosophique. Le scepticisme absolu fait tout passer pour apparence. Donc il distingue apparence et vérité et doit par conséquent posséder un critère de distinction ; par suite, supposer une connaissance de la vérité, en quoi il se contredit. Hypothèse Nous remarquions précédemment à propos de la probabilité qu'elle était une approximation de la certitude. — Or tel est tout spécialement le cas des hypothèses qui ne nous permettent jamais d'atteindre à une certitude apodictique, mais seulement à un degré plus ou moins élevé de probabilité. Une hypothèse est un assentiment du jugement à la vérité d'un principe en considération du caractère suffisant de ses conséquences, ou plus brièvement : l'assentiment à une supposition prise pour principe. [...] [...] il y a dans chaque hypothèse quelque chose qui doit être apodictiquement certain, à savoir :
1)
la possibilité de la supposition elle-même.
2)
la conséquence.
3)
l'unité. Il y a des sciences qui ne permettent aucune hypothèse ; ainsi la mathématique et la métaphysique. Mais dans la science de la nature, des hypothèses sont utiles et indispensables. |
|||||
|
p. 99-100 § 1. Concept en général. Différence entre concept et intuition. Toutes les connaissances c'est-à-dire toutes les représentations rapportées consciemment à un objet sont ou bien des intuitions, ou bien des concepts. — L'intuition est une représentation singulière (represencatio singularis), le concept est une représentation générale (representatio per notas communes) ou réfléchie (representatio discursiva). La connaissance par concept s'appelle la pensée (cognitio discursiva). Remarques : 1) Le concept est opposé à l'intuition, car c'est une représentation générale [3] ou une représentation de ce qui est commun à plusieurs objets, donc une représentation en tant qu'elle peut être contenue en différents objets. 2) C'est une simple tautologie de parler de concepts universels ou communs ; c'est une faute qui repose sur une division incorrecte des concepts en universels, particuliers, et singuliers. Ce ne sont pas les concepts eux-mêmes, c'est seulement leur usage qui peut-être ainsi divisé. § 2. Matière et forme des concepts. En tout concept il faut distinguer matière et forme. — La matière des concepts est l'objet ; leur forme, l'universalité. § 3. Concept empirique et pur. Le concept est soit empirique, soit pur (vel empiricus vel intellectualis). — Un concept pur est celui qui n'est pas tiré de l'expérience, mais qui provient de l'entendement, même dans son contenu. L'Idée est un concept de la raison, dont l'objet ne peut se rencontrer dans l'expérience. Remarques : 1) Le concept empirique provient des sens par comparaison des objets de l'expérience et ne reçoit de l'entendement que la forme de la généralité. — La réalité de ces concepts repose sur l'expérience réelle dont ils procèdent quant au contenu. — La question de savoir si de purs concepts d'entendement (conceptus puri), qui, en tant que tels, proviennent uniquement de l'entendement, indépendamment de toute expérience, c'est à la métaphysique d'en traiter. 2) Les concepts rationnels ou Idées ne peuvent pas conduire à des objets réels, puisque tous ces derniers doivent être contenus dans une expérience possible. Mais ils servent à la raison à guider l'entendement dans sa relation à l'expérience et dans l'usage le plus parfait de ses règles, ou également à montrer que toutes les choses possibles ne sont pas des objets de l'expérience et que les principes de la possibilité de cette dernière ne valent pas pour les choses en soi, ni même pour les objets de l'expérience considérés comme choses en soi. [...] |
|||||
|
p. 110-115 § 17. Définition du jugement en général. Un jugement est la représentation de l'unité de la conscience de différentes représentations, ou la représentation de leurs rapports en tant qu'elles constituent un concept. § 18. Matière et forme des jugements. Tout jugement possède, à titre d'éléments constitutifs essentiels, une matière et une forme — La matière consiste dans les connaissances données et liées pour l'unité de la conscience dans le jugement ; — la forme du jugement consiste dans la détermination de la manière dont les différentes représentations, en tant que telles, appartiennent à une conscience. § 19. Objet de la réflexion logique, — la simple forme des jugements. La logique faisant abstraction de toute différence réelle ou objective de la connaissance, ne peut pas plus avoir affaire à la matière des jugements qu'au contenu des concepts. Elle doit donc borner son examen à la différence des jugements au point de vue de leur simple forme. § 20. Formes logiques des jugements : quantité, qualité, relation et modalité. [...] § 21. Quantité des jugements : universels, particuliers, singuliers. [...] § 22. Qualité des jugements : affirmatifs, négatifs, indéfinis. [...] § 23. Relation des jugements : catégoriques, hypothétiques, disjonctifs. [...] § 24. Jugements catégoriques. [...] § 25. Jugements hypothétiques. [...] |
|||||
|
[1] Emmanuel Kant, Logique (1800), Vrin 1997 (trad. G. Guillermit). [2] « L'assentiment est un événement dans notre entendement qui peut reposer sur des fondements objectifs, mais qui doit avoir également des causes subjectives dans l'esprit de celui qui juge... L'assentiment ou la validité subjective du jugement relativement à la conviction (qui a en même temps une valeur objective) comporte les trois degrés que voici : l'opinion, la croyance et le savoir. L'opinion est un assentiment accompagné d'une conscience de son insuffisance aussi bien subjective qu'objective. Si l'assentiment est seulement subjectivement suffisant, tout en étant tenu pour objectivement insuffisant, il se nomme croyance. Enfin l'assentiment suffisant aussi bien subjectivement qu'objectivement s'appelle savoir. » Emmanuel Kant, Critique de la raison pure (1800), GF © 2006.
[3]
Le concept, représentation générale, Critique de la raison pure, — A 106, p. 119 :
|
|||||