
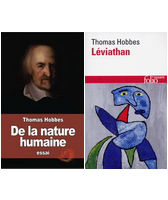
1640 et 1651
Le Léviathan
SOMMAIRE
 |
|
||||
|
|
|||||
|
1640 et 1651 |
|||||
|
Le Léviathan |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
Les qualités sensibles [1] Ch. I 6. Comme il n'est point nécessaire pour mon objet actuel d'entrer dans un détail anatomique et minutieux des facultés du corps, je me contenterai de les réduire à trois, la faculté nutritive, la faculté motrice ou de se mouvoir, et la faculté générative ou de se propager. 7. Quant aux facultés de l'esprit, il y en a deux espèces : connaître et imaginer, ou concevoir et se mouvoir. Commençons par la faculté de connaître. Pour comprendre ce que j'entends par la faculté de connaître, il faut se rappeler qu'il y a continuellement dans notre esprit des images ou des concepts des choses qui sont hors de nous, en sorte que si un homme vivait et que tout le reste du monde fût anéanti, il ne laisserait pas de conserver l'image des choses qu'il aurait précédemment aperçues ; en effet chacun sait par sa propre expérience que l'absence ou la destruction des choses une fois imaginées ne produit point l'absence ou la destruction de l'imagination elle-même. L'image ou représentation des qualités des êtres qui sont hors de nous est ce qu'on nomme le concept, l'imagination, l'idée, la notion, la connaissance de ces êtres : la faculté ou le pouvoir par lequel nous sommes capables d'une telle connaissance est ce que j'appelle ici pouvoir cognitif ou conceptif, ou pouvoir de connaître ou de concevoir. Ch. II 4. Comme dans la vision, l'image, composée de couleur et de figure, est la connaissance que nous avons des qualités de l'objet de ce sens, il n'est pas difficile à un homme d'être dans l'opinion que la couleur et la figure sont les vraies qualités de l'objet, et par conséquent que le son ou le bruit sont les qualités de la cloche ou de l'air. Cette idée a été si longtemps reçue que le sentiment contraire doit paraître un paradoxe étrange ; cependant, pour maintenir cette opinion, il faudrait supposer des espèces visibles et intelligibles allant et venant de l'objet ; ce qui est pire qu'un paradoxe, puisque c'est une impossibilité. Je vais donc tâcher de prouver clairement les principes suivants. — Que le sujet auquel la couleur et l'image sont inhérentes n'est point l'objet ou la chose vue. — Qu'il n'y a réellement hors de nous rien de ce que nous appelons image ou couleur. — Que cette image ou couleur n'est en nous qu'une apparence du mouvement, de l'agitation ou du changement que l'objet produit sur le cerveau, sur les esprits ou sur la substance renfermée dans la tête. — Que comme dans la vision, de même dans toutes les conceptions qui nous viennent des autres sens, le sujet de leur inhérence n'est point l'objet, mais l'être qui sent. 9. Comme la couleur n'est point inhérente à l'objet, mais n'est que l'action de cet objet sur nous, causée par un mouvement tel que nous l'avons décrit, de même le son n'est pas dans l'objet que nous entendons, mais dans nous-mêmes. Une preuve de cette vérité, c'est que, de même qu'un homme peut voir double ou triple, il peut aussi entendre deux ou trois fois par le moyen des échos multipliés, lesquels échos sont des sons comme leur générateur. Or ces sons, n'étant pas dans le même lieu, ne peuvent pas être inhérents au corps qui les produit. Rien ne peut produire ce qui n'est pas en lui-même ; le battant n'a pas de son en lui-même, mais il a du mouvement et en produit dans les parties internes de la cloche ; de même la cloche a du mouvement, mais n'a pas de son ; elle donne du mouvement à l'air ; cet air a du mouvement, mais non du son ; il communique ce mouvement au cerveau par l'oreille et les nerfs ; le cerveau a du mouvement et non du son ; l'impulsion reçue par le cerveau rebondit sur les nerfs qui émanent de lui, et alors elle devient une apparence que nous appelons le son. Si nous étendons nos expériences sur les autres sens il sera facile de s'apercevoir que l'odeur et la saveur d'une même substance ne sont pas les mêmes pour tous les hommes, et nous en conclurons qu'elles ne résident point dans la substance que l'on sent ou que l'on goûte, mais dans les organes. Par la même raison, la chaleur que le feu nous fait éprouver est évidemment en nous, et elle est très différente de la chaleur qui existe dans le feu ; car la chaleur que nous éprouvons est ou un plaisir ou une douleur suivant qu'elle est douce ou violente, tandis qu'il ne peut y avoir ni plaisir ni douleur dans les charbons. Cela suffit pour nous prouver la quatrième et dernière proposition, à savoir que, de même que dans la vision, dans toutes les conceptions qui résultent des autres sens, le sujet de leur inhérence n'est point dans l'objet, mais dans celui qui sent. 10. Il suit encore de là que tous les accidents ou toutes les qualités que nos sens nous montrent comme existant dans le monde n'y sont point réellement, mais ne doivent être regardés que comme des apparences ; il n'y a réellement dans le monde, hors de nous, que les mouvements par lesquels ces apparences sont produites. Voilà la source des erreurs de nos sens, que ces mêmes sens doivent corriger ; car de même que mes sens me disent qu'une couleur réside dans l'objet que je vois directement, mes sens m'apprennent que cette couleur n'est point dans l'objet, lorsque je le vois par réflexion [dans un miroir]. |
|||||
|
État de guerre [2] Les humains n'éprouvent aucun plaisir (mais plutôt un grand déplaisir) à demeurer en présence les uns des autres s'il n'y a pas de puissance capable de les tenir tous en respect. Car chacun cherche à s'assurer qu'il est évalué par son voisin au même prix qu'il s'évalue lui-même ; et à tout signe de mépris, chaque fois qu'on le sous-estime, chacun s'efforce naturellement, dans la mesure où il l'ose (ce qui, parmi ceux qu'aucune puissance commune ne tient tranquilles, est suffisant pour qu'ils s'exterminent les uns les autres), d'obtenir par la force que ses contempteurs admettent qu'il a une plus grande valeur, et que les autres l'admettent par l'exemple. En sorte qu'on trouve dans la nature humaine trois causes principales de conflit : premièrement, la compétition ; deuxièmement, la défiance ; troisièmement, la gloire. La première pousse les hommes à attaquer pour le profit, la seconde pour la sécurité et la troisième pour la réputation. Dans le premier cas ils utilisent la violence pour se rendre maîtres de la personne d'autres hommes, femmes, enfants, et du bétail ; dans le second, pour les défendre ; dans le troisième, pour des détails, comme un mot, un sourire, une opinion différente et tout autre signe qui les sous-estime, soit directement dans leur personne, soit, par contrecoup, dans leur parenté, leurs amis, leur nation, leur profession ou leur nom. Par cela il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, leur condition est ce qu'on appelle la guerre ; et celle-ci est telle qu'elle est une guerre de chacun contre chacun. En effet, la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de combattre, mais dans cet espace de temps pendant lequel la volonté d'en découdre par un combat est suffisamment connue ; et donc, la notion de temps doit être prise en compte dans la nature de la guerre, comme c'est le cas dans la nature du temps qu'il fait. Car, de même que la nature du mauvais temps ne consiste pas en une ou deux averses, mais en une tendance au mauvais temps, qui s'étale sur plusieurs jours, de même, en ce qui concerne la nature de la guerre, celle-ci ne consiste pas en une bataille effective, mais en la disposition reconnue au combat, pendant tout le temps qu'il n'y a pas d'assurance du contraire. Tout autre temps est la paix. Donc, toutes les conséquences du temps de guerre, où chacun est l'ennemi de chacun, sont les mêmes que celles du temps où les humains vivent sans autre sécurité que celle procurée par leur propre force, ou leur propre ingéniosité. Dans une telle situation, il n'y a de place pour aucune entreprise parce que le bénéfice est incertain, et, par conséquent, il n'y a pas d'agriculture, pas de navigation, on n'utilise pas les marchandises importées par mer, il n'y a ni vastes bâtiments ni engins servant à déplacer et déménager ce qui nécessite beaucoup de force ; il n'y a aucune connaissance de la surface terrestre, aucune mesure du temps, ni arts ni lettres, pas de société ; et, ce qui est pire que tout, il règne une peur permanente, un danger de mort violente. La vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. Il peut paraître étrange à celui qui n'a pas bien pesé ces choses, que la nature dissocie ainsi les humains en les rendant capables de s'attaquer et de s'entre-tuer les uns les autres ; celui-là peut ne pas accepter une telle déduction faite à partir des passions et il désire peut-être que la même chose lui soit confirmée par l'expérience. Qu'il s'observe donc lui-même quand, pour partir en voyage, il s'arme et cherche à être bien accompagné ; quand, allant se coucher, il boucle ses portes ; quand, jusque dans sa propre maison, il verrouille ses coffres, et cela tout en sachant qu'il y a des lois et des agents publics armés pour punir tous les torts qu'on pourrait lui faire. Quelle opinion se fait-il de ses semblables quand il voyage tout armé, de ses concitoyens quand il boucle ses portes, et de ses enfants, de ses domestiques quand il verrouille ses coffres ? N'accuse-t-il pas autant le genre humain par ses actes que je le fais par mes mots ? Pourtant, ni lui ni moi n'accusons ainsi la nature humaine. Les désirs et les autres passions humaines ne sont pas en eux-mêmes des péchés. Pas plus que ne le sont les actions engendrées par les passions, pour autant qu'il n'y a pas de loi faisant savoir qu'il est interdit de les accomplir. Tant que les lois n'ont pas été faites, on ne peut les connaître, et aucune loi ne peut être faite tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la personne qui la fera. Incidemment, on peut penser qu'il n'y eut jamais un temps comme celui-ci, non plus qu'un semblable état de guerre. Et je crois que, de façon générale, il n'en a jamais été ainsi à travers le monde, mais qu'il y a beaucoup d'endroits où l'on vit ainsi. En effet, chez les sauvages de nombreux endroits de l'Amérique, à l'exception du gouvernement des petites familles dont la concorde dépend de la lubricité naturelle, il n'y a pas de gouvernement du tout, et ils vivent en ce moment même à la manière des animaux, comme je l'ai dit plus haut. Quoi qu'il en soit, on peut se faire une idée de ce qu'est le genre de vie là où n'existe aucune puissance commune à craindre, par le genre de vie dans lequel sombrent, lors d'une guerre civile, ceux qui vivaient précédemment sous un gouvernement pacifique. Mais s'il n'y eut jamais d'époque où les individus particuliers se trouvaient les uns les autres en état de guerre, il n'en reste pas moins qu'en tout temps les rois et les personnes détentrices de l'autorité souveraine, en raison de leur indépendance, s'envient en permanence et se mettent dans l'état et l'attitude des gladiateurs, pointant leurs armes l'un vers l'autre et s'épiant l'un l'autre, avec leurs forteresses, leurs armées, leurs canons massés aux frontières de leurs royaumes. Mais, puisque par ces moyens ils protègent les entreprises de leurs sujets, cette situation n'engendre pas la misère qui accompagne la liberté des individus particuliers. Ceci aussi est une conséquence de cette guerre de chacun contre chacun : que rien ne peut être injuste. Les notions du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucune puissance commune, il n'y a pas de loi ; là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. En temps de guerre, la force et la tromperie sont les deux vertus cardinales. Justice et injustice ne sont aucunement des facultés du corps ou de l'esprit. Si elles l'étaient, ce serait celles d'un humain seul au monde, comme le sont ses sensations et ses passions. Ce sont des qualités relatives à l'humain en société, non à l'humain solitaire. C'est aussi une conséquence de ce même état qu'il n'y a ni propriété, ni pouvoir, ni distinction du tien et du mien, et que ce qui peut appartenir à chacun, c'est ce qu'il peut obtenir et conserver aussi longtemps qu'il le pourra. Tel est donc le misérable état du genre humain dans lequel il se trouve par nature ; il lui est pourtant possible d'en sortir, pour une part par les passions et, pour une autre part, par sa raison. |
|||||
|
Léviathan [3] Le seul moyen d'établir pareille puissance commune, capable de défendre les humains contre les invasions des étrangers et les préjudices commis aux uns par les autres et, ainsi, les protéger de telle sorte que, par leur industrie propre et les fruits de la terre, ils puissent se suffire à eux-mêmes et vivre satisfaits, est de rassembler toute leur puissance et toute leur force sur un homme ou sur une assemblée d'hommes qui peut, à la majorité des voix, ramener toutes leurs volontés à une seule volonté ; ce qui revient à dire : désigner un homme, ou une assemblée d'hommes, pour porter leur personne ; et chacun fait sienne et reconnaît être lui-même l'auteur de toute action accomplie ou causée par celui qui porte leur personne, et relevant de ces choses qui concernent la paix commune et la sécurité ; par là même, tous et chacun d'eux soumettent leurs volontés à sa volonté, et leurs jugements à son jugement. C'est plus que le consentement ou la concorde ; il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, faite par convention de chacun avec chacun, de telle manière que c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu : j'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. Cela fait, la multitude, ainsi unie en une personne une, est appelée un état, en latin civitas. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt (pour parler avec plus de déférence) de ce dieu mortel, auquel nous devons, sous le dieu immortel, notre paix et notre défense. En effet, en vertu du pouvoir [authority] conféré par chaque individu dans l'État, il dispose de tant de puissance et de force assemblées en lui que, par la terreur qu'elles inspirent, il peut conformer la volonté de tous en vue de la paix à l'intérieur et de l'entraide face aux ennemis de l'étranger. En lui réside l'essence de l'État qui est (pour le définir) une personne une dont les actes ont pour auteur, à la suite de conventions mutuelles passées entre eux-mêmes, chacun des membres d'une grande multitude, afin que celui qui est cette personne puisse utiliser la force et les moyens de tous comme il l'estimera convenir à leur paix et à leur défense commune. Celui qui est dépositaire de cette personne est appelé souverain et l'on dit qu'il a la puissance souveraine ; en dehors de lui, tout un chacun est son sujet. Il existe deux moyens pour parvenir à cette puissance souveraine. Le premier, par la force naturelle : tout comme un homme le fait de ses enfants afin qu'ils se soumettent, et leurs enfants, à son gouvernement, en tant qu'il peut les exterminer s'ils refusent ; ou bien que, par la guerre, il assujettisse ses ennemis à sa volonté, leur laissant la vie sauve à cette condition même. Le second est quand les humains sont d'accord entre eux pour se soumettre à un homme quelconque, ou à une assemblée d'hommes, volontairement, lui faisant confiance pour qu'il les protège contre tous les autres. Ce dernier peut être appelé un État politique et État d'institution ; et le premier, un État d'acquisition. [...] |
|||||
|
[1] Thomas Hobbes, De la nature humaine (1940), UQAC © 2002, pp. 13, 15 et 17. [2] Thomas Hobbes, Léviathan, Gallimard © 2000, pp. 223-228.
|
|||||