
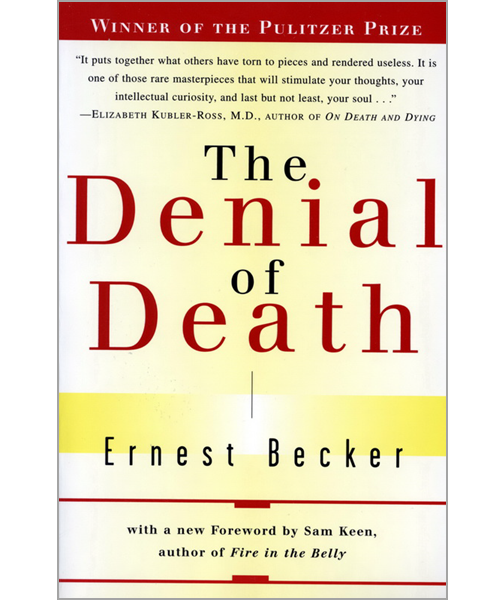
1973
Nier la mort [1]
 |
|
||||
|
|
|||||
|
1973 |
|||||
|
Nier la mort [1] |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
p. 53 [...] nous savons maintenant que l'animal humain est caractérisé par deux grandes peurs dont les autres animaux sont exempts : la peur de la vie et la peur de la mort. Dans les sciences humaines, c'est surtout Otto Rank qui a mis ces peurs en évidence. Il a fondé tout son système de pensée sur elles, et il a montré à quel point elles étaient essentielles à la compréhension de l'homme. À peu près à la même époque que Rank, Heidegger a placé ces peurs au centre de la philosophie existentielle. Il a soutenu que le fondement de l'anxiété humaine est l'angoisse sur être-au-monde, ainsi que l'angoisse d'être-au-monde, c'est-à-dire à la fois la peur de la mort et la peur de la vie, de l'expérience et de l'individuation. L'homme est réticent à s'aventurer dans l'immensité du monde, dans les dangers de la réalité ; il recule pour ne pas se perdre dans les appétits dévorants des autres, pour ne pas perdre le contrôle dans les griffes des hommes, des bêtes et des machines. En tant qu'organisme animal, l'homme perçoit le type de planète sur laquelle il a été jeté, la frénésie cauchemardesque et démoniaque dans laquelle la nature a libéré des milliards d'appétits dévorants de toutes sortes — sans parler des tremblements de terre, des météores et des ouragans, qui semblent avoir leur propre soif infernale. Chaque corps, pour se développer harmonieusement, ne cesse de dévorer d'autres vies. Les appétits semblent innocents parce qu'ils appartiennent à la nature, mais tout organisme pris dans la myriade d'objectifs concourants de cette planète est une victime potentielle de cette même innocence — et il se restreint sur la vie de peur de perdre la sienne. La vie peut aspirer quelqu'un, saper ses énergies, le submerger, lui faire perdre le contrôle de soi, lui donner tant d'expériences nouvelles si rapidement qu'il sera rompu ; elle le fera sortir du lot, émerger sur un terrain dangereux, le chargera de nouvelles responsabilités qui nécessitent une grande force, l'exposera à de nouvelles éventualités hasardeuses. Par-dessus tout, il y a le danger d'un faux pas, d'un accident, d'une maladie fortuite et, bien sûr, de la mort, de l'aspiration finale, de la submersion totale et de l'anéantissement. |
|||||
|
p. 17 Pour survivre, les animaux ont dû être protégés par des réactions de peur, non seulement des autres animaux, mais de la nature elle-même. Ils ont dû constater le véritable rapport entre leurs pouvoirs limités et le monde dangereux dans lequel ils étaient immergés. La réalité et la peur vont de pair naturellement. Comme le nourrisson humain est dans une situation encore plus vulnérable, il est insensé de supposer que la réaction animale de peur aurait disparu pour une espèce aussi faible et sensible. Il est plus raisonnable de penser qu'elle se serait plutôt accentuée, comme le pensaient certains des premiers darwiniens : des premiers hommes, de ceux qui étaient les plus effrayés, il y avait ceux qui étaient les plus réalistes sur leur précarité dans la nature ; ils ont transmis à leur progéniture un réalisme qui avait une grande valeur de survie. Le résultat fut l'émergence de l'homme tel que nous le connaissons : un animal hyper-anxieux qui invente constamment des raisons anxiogènes, même là où il n'y a pas lieu de s'inquiéter. |
|||||
|
p. 55 Nous comprenons ainsi que si l'enfant devait céder au caractère écrasant de la réalité éprouvée, il ne serait pas capable d'agir avec l'équanimité dont nous avons besoin dans notre monde non instinctif. L'une des premières choses que l'enfant doit faire est donc d'apprendre à sortir de la stupeur, agir sans crainte, à laisser derrière lui la peur et les trépidations. Il peut alors agir avec une certaine assurance inconsciente, lorsqu'il a naturalisé son monde. Nous disons « naturalisé », mais nous voulons dire dénaturalisé, falsifié, avec la vérité embrouillée, le désespoir de la condition humaine refoulé, un désespoir que l'enfant entrevoit dans ses terreurs nocturnes, et ses phobies et névroses diurnes. Il évite le désespoir en construisant des défenses qui lui permettent d'éprouver un sentiment fondamental de valeur personnelle, de sens, de pouvoir. Elles lui permettent de sentir qu'il contrôle sa vie et sa mort, qu'il vit et agit réellement en tant qu'individu volontaire et libre, qu'il a une identité unique et façonnée par lui-même, qu'il est quelqu'un — pas seulement un accident fébrile germé sur une planète-maison chaude que Carlyle appela un temps « antichambre du malheur » ("hall of doom"). Nous appelons notre style de vie le mensonge vital, et nous comprenons mieux maintenant pourquoi nous avons dit qu'il était vital : il s'agit d'une malhonnêteté nécessaire et fondamentale à l'égard de soi-même et de l'ensemble de la situation. La révolution freudienne de la pensée aboutit en réalité à cette révélation, et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous nous acharnons encore contre Freud. Nous ne voulons pas admettre que nous sommes fondamentalement malhonnêtes par rapport à la réalité ; que nous ne contrôlons pas vraiment notre propre vie. Nous ne voulons pas reconnaître que nous ne sommes pas autonomes, que nous dépendons toujours de quelque chose qui nous dépasse, d'un système d'idées et de pouvoirs dans lequel nous sommes intégrés, et qui nous soutient. Ce pouvoir n'est pas toujours apparent. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse ouvertement d'un dieu ou d'une personne plus forte. Il peut s'agir d'une activité captivante, d'une passion, du dévouement à un jeu, d'un mode de vie, qui, comme un réseau confortable, maintient la personne en équilibre et dans l'ignorance de soi, du fait qu'elle ne se fonde pas par elle-même. Nous avons tous tendance à recourir à des pratiques de l'oubli de soi, ignorant la source des énergies où nous puisons réellement ; ignorant le type de mensonge que nous avons façonné pour vivre sereinement en toute sécurité. Augustin avait analysé la question de façon magistrale, tout comme Kierkegaard, Scheler et Tillich de nos jours. Ils ont vu que l'homme pouvait se pavaner et se vanter autant qu'il voulait, mais qu'il tirait en réalité son « courage d'être » d'un dieu, d'une série de conquêtes sexuelles, d'un Big Brother, d'un drapeau, du prolétariat, du fétichisme, de l'argent et de l'importance du solde bancaire. p. 66 L'ironie de la condition humaine c'est que le besoin le plus profond est d'être libéré de l'angoisse de la mort et de l'anéantissement ; mais c'est la vie elle-même qui éveille ce besoin alors que nous devons limiter notre expansion vitale. p. 270 Aucune vie organique ne peut s'étendre librement dans toutes les directions ; chacun doit se restreindre soi-même dans certains domaines, payer une quelconque amende sévère par ses peurs et ses limitations naturelles. On peut dire, avec Adler, que la maladie mentale est due aux « problèmes de la vie », mais il faut se rappeler que c'est la vie elle-même qui est le problème insurmontable. p. 133 En expliquant le pouvoir précis qui cimente les groupes, Freud pouvait également montrer pourquoi ils ne craignent pas le danger. Les membres n'ont pas l'impression d'être seuls avec leur petitesse et leur impuissance, puisqu'ils disposent des pouvoirs du leader-héros auquel ils s'identifient. Le narcissisme naturel — le sentiment que la personne à côté de vous va mourir, mais pas vous — est renforcé par la confiance dans le pouvoir du leader. Il n'est pas étonnant que des centaines de milliers d'hommes soient sortis des tranchées sous les tirs foudroyants de la Première Guerre mondiale. Ils étaient, pour ainsi dire, en partie hypnotisés. Il n'est pas étonnant que les hommes imaginent des victoires contre toute attente : ne sont-ils pas investis des pouvoirs omnipotents de la figure tutélaire ? Les hommes s'interrogent depuis toujours : pourquoi les groupes sont-ils si aveugles et si stupides ? Parce qu'ils exigent des illusions, répondait Freud, ils « donnent toujours la priorité à l'irréel au détriment de la réalité ». Et nous savons pourquoi. Le monde réel est simplement trop terrible pour y consentir ; il dit à l'homme qu'il est un petit animal fébrile qui mourra et se décomposera. L'illusion change tout ; elle révèle l'importance vitale de l'homme pour l'univers, elle le rend en quelque sorte immortel. Qui transmet cette illusion, si ce n'est les parents en transmettant le macro-mensonge de la causa sui culturelle ? Les masses attendent des leaders qu'ils leur donnent exactement la contre-vérité dont elles ont besoin ; le leader poursuit les illusions qui triomphent du complexe de castration et les amplifie en une victoire véritablement héroïque. En outre, il permet un nouveau rapport au monde, l'expression de pulsions interdites, de désirs secrets et de fantasmes. Dans le groupe, tous les comportements sont permis parce que le chef l'autorise. C'est comme si l'on redevenait l'enfant tout-puissant, encouragé par ses parents à se faire plaisir ; ou comme dans une psychothérapie où l'analyste vous soustrait à toute censure sur vos pensées et sentiments. Dans le groupe, chaque homme se sent comme un héros omnipotent qui peut donner libre cours à ses appétits sous l'oeil bienveillant du père. C'est ainsi que se manifeste le sadisme terrifiant de l'activité de groupe. |
|||||
|
p. 98 La nouvelle idée de Freud, celle de l'instinct de mort, est un artifice qui lui permet de conserver intacte la théorie précédente de l'instinct en attribuant le mal humain à un substrat organique plus profond que le simple conflit entre l'ego et la sexualité. Il soutenait désormais qu'il existait une pulsion intrinsèque de mort et de vie, ce qui lui permettait d'expliquer l'agression violente, la haine et le mal d'une manière nouvelle, mais toujours biologique : l'agressivité humaine résulte de la fusion de l'instinct de vie et de l'instinct de mort. L'instinct de mort représente le désir de mourir de l'organisme, mais l'organisme peut détourner sa propre pulsion de mort en la redirigeant vers l'extérieur. Le désir de mourir est alors remplacé par le désir de tuer, alors l'homme vainc son propre instinct de mort en tuant les autres. Il s'agissait donc d'un nouveau dualisme simple qui mettait de l'ordre dans la théorie de la libido et qui permettait à Freud de la conserver comme rempart à sa principale tâche prophétique : proclamer que l'homme est fermement ancré dans le règne animal. Freud pouvait encore conserver son allégeance fondamentale à la physiologie, à la chimie et à la biologie, ainsi que ses espoirs d'élaborer une science psychologique brève, simple et entière. Certes, en parlant de désamorcer l'instinct de mort en tuant les autres, Freud a fait le lien entre sa propre mort et la boucherie pratiquée par l'humanité. Mais il y est parvenu au prix d'une intrusion continuelle des instincts dans les explications du comportement humain. Une fois de plus, nous voyons comment la fusion d'une vision véridique et d'une explication fallacieuse a rendu si difficile le décryptage de Freud. Il semble avoir été incapable de toucher directement l'explication existentielle, d'établir à la fois la continuité de l'homme et sa différence avec les animaux inférieurs sur la base de sa protestation contre la mort plutôt que sur la base de son besoin instinctif de s'y conformer. La peur de l'agression humaine, la facilité avec laquelle l'animal gouverné par l'éros massacre d'autres êtres vivants, s'expliquerait par une telle théorie de façon encore plus simple et directe. La mise à mort est une solution symbolique à la limitation biologique ; elle résulte de la fusion du niveau biologique (angoisse animale) et du niveau symbolique (peur de la mort) chez l'animal humain. Comme nous le verrons dans la section suivante, personne n'a expliqué cette dynamique plus élégamment que Rank : « La peur de la mort de l'ego est atténuée par le meurtre, le sacrifice de l'autre. Par la mort de l'autre, on justifie sa propre mort, on s'affranchit de l'injustice de mourir, d'être tué. » |
|||||
|
p. 12 Les recherches anthropologiques et historiques ont également commencé au XIXe siècle pour dresser le tableau de l'héroïsme depuis l'antiquité et les temps primitifs. Le héros était l'homme qui pouvait entrer dans le monde des esprits — le monde des morts — et en revenir vivant. Il avait ses descendants dans les cultes mystérieux de la Méditerranée orientale. C'étaient des cultes de mort et de résurrection. Le héros divin de chacun des cultes était revenu de la mort. Et, comme nous le savons aujourd'hui grâce à la recherche sur les mythes et rituels anciens, le christianisme lui-même était un concurrent des autres cultes mystérieux. Il s'est imposé, notamment, parce qu'il présentait aussi un guérisseur ressuscité d'entre les morts, pourvu de puissances surnaturelles. Le grand triomphe de Pâques réside dans cette joyeuse proclamation : « Le Christ est ressuscité ! », écho de la même joie que les dévots des mystérieux cultes manifestaient pendant les cérémonies de la victoire sur la mort. Ces cultes, comme G. Stanley Hall l'a si bien dit, étaient une tentative d'atteindre « un bain d'immunité » du plus grand mal qui soit : la crainte de la mort. Toutes les religions historiques se sont consacrées au même problème : comment supporter la fin de la vie ? Des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme ont formulé l'astuce ingénieuse consistant à faire semblant de ne pas vouloir renaître, ce qui est une sorte de magie négative : prétendre ne pas vouloir ce que l'on veut vraiment. Lorsque la philosophie a pris le relais de la religion, elle a également pris le relais du problème central de la religion, et la mort est devenue la véritable « muse de la philosophie », depuis ses débuts en Grèce jusqu'à Heidegger et l'existentialisme moderne. p. 82 Il existe un type d'homme qui a un grand mépris pour l'immédiateté, qui essaie de cultiver son intériorité, de fonder sa fierté sur quelque chose de plus profond et d'intérieur, de créer une distance entre lui et le commun des mortels. Kierkegaard appelle ce type d'homme l'introverti. Il se préoccupe un peu plus de ce que signifie être une personne avec l'individualité et la singularité. Il aime la solitude et se retire périodiquement pour réfléchir ; peut-être pour nourrir des idées sur son moi intime, ce qu'il pourrait être. Voilà, en fin de compte, le seul vrai problème de la vie, la seule préoccupation valable de l'homme : quel est son véritable talent, son don secret, sa vocation authentique ? En quoi l'individu est-il vraiment unique, et comment peut-il exprimer cette unicité, lui donner forme, la dédier à quelque chose qui le dépasse ? Comment cette personne peut-elle prendre son intimité, le grand mystère qu'elle ressent au coeur d'elle-même, ses émotions, ses aspirations, et les utiliser pour vivre de manière plus distincte, pour s'enrichir et enrichir l'humanité de son talent particulier ? À l'adolescence, la plupart d'entre nous sont confrontés à ce dilemme que nous exprimons soit par des mots et des pensées, soit par la douleur sourde d'un désir inassouvi. Mais en général, la vie nous aspire dans des activités standardisées. Le système de héros sociaux dans lequel nous sommes nés trace les voies de notre héroïsme, des voies auxquelles nous nous conformons, auxquelles nous nous façonnons afin de plaire aux autres, de devenir ce qu'ils attendent de nous. Et au lieu de travailler sur notre intimité, nous la recouvrons et l'oublions progressivement, tout en devenant des hommes purement externes, jouant avec succès le jeu du héros standardisé dans lequel nous tombons par hasard, par lien familial, par réflexe patriotique, ou par le simple besoin de se nourrir et de procréer. p. 152 Lorsque l'on fusionne avec le soi en transcendant les parents ou le groupe social, on essaie, concrètement, d'ajouter davantage de sens à notre vie. Nous ne comprenons pas la complexité de l'héroïsme si nous ne saisissons pas ce point ; nous ne saisissons pas la personne dans sa totalité — une saisie, non seulement dans le soutien du pouvoir que le dépassement de soi lui donne, mais une saisie de tout son être dans la joie et l'amour. Le désir d'immortalité n'est pas un simple réflexe de l'angoisse de la mort, mais un élan de tout l'être vers la vie. Cette expansion naturelle de la créature explique peut-être à elle seule pourquoi le transfert est une passion si universelle. De ce point de vue également, nous comprenons l'idée de Dieu comme l'accomplissement logique du côté agapè de la nature de l'homme. p. 216 Les deux projets, celui du corps et celui de la culture, se rejoignent dans un échec mutuel retentissant. Il n'est donc pas étonnant que la dépression de la ménopause soit un phénomène propre aux sociétés dans lesquelles les femmes vieillissantes sont privées d'une place utile permanente, du véhicule de l'héroïsme qui transcende le corps et la mort. Il n'est pas étonnant non plus qu'au lieu de l'éternité de la vie que l'on est en droit de considérer comme acquise dans le cadre d'un schéma assuré d'autoperpétuation, la personne déprimée se sente au contraire condamnée à une éternité de destruction. De ce point de vue, nous devons admettre qu'en fin de compte, l'accent mis sur le rôle social comme clé du syndrome est correct, car c'est le niveau supérieur des problèmes qui absorbe le niveau corporel. L'héroïsme transforme la peur de la mort en la sécurité de l'autoperpétuation, à tel point que l'on peut joyeusement faire face à la mort et même la courtiser dans le cadre de certaines idéologies. p. 268 Une personne passe des années à s'épanouir, à développer son talent, ses dons uniques, à perfectionner son jugement sur le monde, à élargir et aiguiser son appétit, à apprendre à supporter les déceptions de la vie, à devenir mature, aguerrie — enfin une créature unique dans la nature, dotée d'une certaine dignité et d'une certaine noblesse et transcendant la condition animale ; elle n'est plus contrôlée, elle n'est plus entièrement un réflexe, elle n'est plus sortie d'un quelconque moule. Et puis, le vrai drame, comme l'a écrit André Malraux dans La condition humaine : c'est qu'il faut soixante ans de souffrances et d'efforts inouïs pour faire un tel individu, et qu'il ne soit destiné qu'à mourir. Ce douloureux paradoxe n'échappe certainement pas à la personne elle-même. Elle se sent atrocement unique, et pourtant elle sait que cela ne fait aucune différence en ce qui concerne la fin ultime. Quelle que soit sa longévité, elle est vouée au même destin que la sauterelle. |
|||||
|
[1] Ernest Becker, The Denial of Death, First Free Press Paperbacks © 1997 (trad. F. Brooks).
|
|||||