|
Ce n'est pas la tyrannie qui est difficile
c'est la République
Ce n'est pas la Tyrannie qui est difficile. Non. C'est plutôt la République qui est difficile. Car l'injustice trouve promptement des amis et des
soutiens en tous ceux qui ont horreur de la lumière et qui prennent l'égalité comme une injure. Cette armée furieuse est toujours là, à guetter
l'occasion. Et il y a plus d'une occasion.
Toute guerre et toute menace de guerre met la République en demeure de se faire tyrannique. Toute grève aussi, dès
qu'elle s'étend et qu'elle trouble l'ordre des échanges. Bien plus évidemment encore, tout essai de guerre civile met la République au défi de
garder ses principes.
« Impossibles, absurdes principes ! » Tel est le cri de l'adversaire, il ne cesse de prédire, par toutes ces causes, la mort de la
République. À première vue, et la guerre étant ainsi menée, on découvre que les agents provocateurs ont un immense pouvoir. Le même homme, qui
annonce que la République ne saura pas garder la paix, ne se prive pas d'alarmer les foules, d'insulter les ennemis, les alliés, toute la terre,
curieux qu'il est de voir comment les Droits de l'Homme s'en tireront. Le même saura bien, par quelques déclamateurs payés, susciter la grève en
morte-saison, et de fil en aiguille, l'impossible révolution contre les mitrailleuses. D'où ce conseil ridicule, qui me paraît pourtant le
meilleur : « Ne faites rien. Résignez-vous. Gardez patiemment cette République honteuse d'elle-même, cette République qui frappe
toujours sur les petits. Vous n'aurez peut-être jamais mieux. En ce moment si vous exigez mieux, vous aurez pire. »
Ce moment est éternel. Jamais la paix ne s'établira d'elle-même. Toujours les menaces et les défis passeront dans l'air. Toujours les voleurs
crieront que la propriété n'est pas protégée. Toujours les riches prouveront, comptes sur table, que les travailleurs ont trop d'argent. Toujours
il sera difficile de défendre une République qui n'a pour elle que ses principes, et encore qui ne les applique pas. Quel murmure des
mécontents ! Quel contraste avec les cyniques tyrannies, qui montrent avec orgueil la paix publique chez eux. Et en effet le tyran ne permet
pas qu'on soit mécontent. Mais il faut dire aussi que les citoyens, devant l'obstacle infranchissable, aiment mieux se croire contents, se laisser
enchanter, s'enchanter eux-mêmes. Et, bref, ce qui rend la vie difficile aux Républiques, c'est premièrement l'opposition des Républicains. Au
contraire ce qui rend la vie facile aux tyrannies, c'est que les citoyens renoncent bientôt à exercer la critique politique, travail difficile et
qu'ils voient sans espoir. Les principes sont trop loin ; on se lasse de les invoquer. On revient à la misanthropie, doctrine si naturelle,
et qui donne raison au tyran. « L'homme n'est pas assez bon, dit le professeur de tyrannie, pour qu'on puisse le mettre en République. L'homme
n'invoque l'égalité que contre ceux dont il est jaloux ; l'homme suit son intérêt, son plaisir, ses passions. Les hommes se dévoreraient entre
eux s'ils ne sentaient au-dessus d'eux un pouvoir féroce et un fouet toujours levé. »
J'ai connu des hommes fort attentifs, et dévoués d'avance à toute vérité, qui s'étonnaient que les principes républicains fussent si aisément
réfutés, si difficilement prouvés. Et en effet la thèse misanthropique, qui est celle du tyran, est évidente par soi. Dès qu'on laisse aller les
choses, dès qu'on se laisse aller soi-même, tout marche comme le professeur de tyrannie l'annonçait ; l'homme n'est bon que forcé. Au lieu
que l'autre thèse, selon laquelle, au contraire, l'homme n'est bon que libre, suppose dans les hommes une résolution d'être libre, ce qui est
surmonter les intérêts et les passions. Affaire de courage, et de pur courage, car l'expérience prouvera qu'à cette vie libre on ne gagne ni
argent, ni pouvoir, ni même sûreté. Il faut donc tenir fidèlement, et sans preuves, contre tant de preuves ; car l'avare gagne toujours
et fraude sans risques ; et le lâche se met à l'abri toujours à condition de vanter son propre courage ; et le tyran ne manque jamais
d'amis alors que l'homme libre est en danger de perdre tous ses amis, et d'être blâmé par sa femme, ses enfants et tous ses proches, toujours très
sensibles aux preuves sonnantes.
C'est par ces causes que la République est trois fois reniée, trois fois maudite, trois fois trahie chaque jour, et par ses meilleurs amis, avant
que le coq ait chanté. Soit. Mais que le chant du coq, alors, nous avertisse ; et courons prêter la main à ces principes en apparence
impalpables, en réalité si lourds à porter, et qui ne paient pas les porteurs.
|
|

Alain, De la foi - 18 novembre 1921, Propos sur la religion XXVI, P.U.F. © 1938.
Extrait de
,
pp. 333-334.
L'Imitation de Jésus-Christ : célèbre ouvrage de piété du XVe siècle, maintes fois traduit,
notamment par Corneille et Lamennais. Ibid.
Allusion à ce passage du Ménon (de
) où
conduit un jeune esclave ignorant à retrouver par lui-même la solution d'un problème de géométrie. Ibid.
Alain, L'homme devant l'apparence - 19 janvier 1924, # 139, Propos sur la religion LXIV, P.U.F. © 1938.
Extrait de
, pp. 481-482.
Extrait audio de
(lecture Jean-Pierre Lorit) CD1-[16].
Alain, Propos sur la politique (Propos 60, août 1930) P.U.F. © 1951.
Extrait de
,
p. 333.
Alain, Éléments de philosophie (livre 2, note du chapitre 16), Gallimard © 1941.
Extrait de
,
pp. 332-333.
Alain, Propos # 2063, 11 novembre 1911.
Extrait de
,
pp. 61-62.
Alain, Propos sur l'éducation # 724, 28 février 1908.
Extrait de
,
pp. 29-31.
Alain, Propos # 375, 8 mars 1907.
Extrait de
,
pp. 24-25.
Alain, Propos # 653, 19 décembre 1907.
Extrait de
,
pp. 28-29.
Alain, Propos # 1337, 13 novembre 1909.
Extrait de
,
pp. 43-44.
Alain, Propos # 1756, 7 janvier 1911.
Extrait de
,
pp. 55-57.
Alain, Propos # 34, 22 mars 1906.
Extrait de
,
pp. 12-13.
Alain, Propos # 54, 11 avril 1906.
Extrait de
,
pp. 13-15.
Alain, Propos # 827, 12 juin 1908.
Extrait de
,
pp. 33-34.
Alain, Propos # 1473, 30 mars 1910.
Extrait de
,
pp. 46-48.
[
avait-il lu ce texte avant d'intituler son livre
?  ] ]
Alain, Propos # 1534, 30 mai 1910.
Extrait de
,
pp. 48-50.
[Et qui doit enseigner à l'enseignant ? Et qui enseignera à l'enseignant de l'enseignant ? et
à l'enseignant de l'enseignant de l'enseignant ? ...]
Alain, Propos # 2805, 25 novembre 1913.
Extrait de
,
pp. 85-86.
Alain, Propos # 1336, 12 novembre 1909.
Extrait de
,
pp. 40-42.
Alain, Propos # 2184, 11 mars 1912.
Extrait de
,
pp. 85-86.
Alain, Propos # 71, 28 avril 1906.
Extrait de
,
pp. 63-64.
,
écrivain ayant tenté d'appliquer la théorie de l'évolution de
Darwin à la critique littéraire.
(N.d.E.,
, p. 15.)
S.-W. Patson, vraisemblablement
,
médecin et physicien anglais.
(N.d.E.,
, p. 16.)
Alain, Propos # 258, 9 novembre 1906.
Extrait de
,
pp. 19-21.
Alain, Le Devoir d'obéissance - 4 septembre 1912, Propos # 149, Politique, Prologue XII.
Extrait de
,
p. 308.
Inclus sur
CD1-[5].
Alain, Culture générale - 18 mai 1921, Propos sur l'éducation XLV (1932).
Extrait de
,
p. 91.
Inclus sur
,
CD1-[8].
Alain, Il y a savoir et savoir - 25 novembre 1921, Ibid. XVIII (1932).
Extrait de
,
p. 48.
Inclus sur
,
CD1-[12].
Alain, Le Figuier - 5 janvier 1924, Propos sur la religion LXI.
Extrait de
,
pp. 572-573.
Inclus sur
,
CD1-[15].
Alain, [Penser n'est pas croire] On parle d'instruction, de réflexion, de culture - 14 décembre 1929,
Propos sur des philosophes XIX, PUF 1961.
Extrait de
,
p. 36.
Inclus sur
,
CD2-[5].
Alain, Les cours magistraux sont temps perdu - 17 octobre 1931, Propos sur l'éducation XXXVII (1932).
Extrait de
,
p. 79.
Inclus sur
,
CD2-[8].
Alain, Dieu incertain - 3 août 1932, Propos sur la religion LXXIX.
Extrait de
,
pp. 1095-1097.
Inclus sur
,
CD2-[9].
Alain, Ce n'est pas la tyrannie qui est difficile - 18 mai 1935 (Politique IIIe Partie, XCV).
Extrait de
,
p. 1257-1259.
Inclus sur
,
CD2-[11].

|

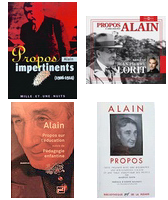
![]() L'esprit ne doit jamais obéissance
L'esprit ne doit jamais obéissance
![]()
![]() L'inconscient : une idolâtrie du corps
L'inconscient : une idolâtrie du corps
![]()
![]() La morale, c'est bon pour les riches !
La morale, c'est bon pour les riches !
![]()
![]() Les cours magistraux sont temps perdu
Les cours magistraux sont temps perdu
![]()
![]() Ce n'est pas la tyrannie qui est difficile, c'est la République
Ce n'est pas la tyrannie qui est difficile, c'est la République
![]()